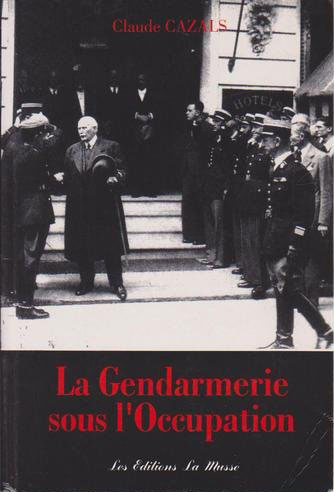
Depuis sa lointaine origine, en 1191, sous le capétien Philippe Auguste, la Gendarmerie nationale, héritière de la Maréchaussée, a connu les vicissitudes liées aux drames de notre histoire sans jamais cesser, au prix d’un lourd tribut, de remplir sa mission traditionnelle de protection des personnes et des biens.
L’épreuve de l’Occupation, entre 1940 et 1945, est l’une de celles qui ont le plus marqué l’institution confrontée à une situation complexe et redoutable. Le métier des gendarmes n’était pas alors facile. Partagés entre le devoir d’obéissance et l’exigence patriotique, ils s’exposaient, quel que soit leur choix, à de graves dangers. Gendarme à la brigade de Thaninges (Haute-Savoie) en 1943, Henri Berthomieu évoque le climat qui régnait à l’époque :
« Nous étions, indique-t-il, menacés de toute part, par l’occupant, par les collaborateurs, par certains de nos chefs, par les gens du service d’ordre légionnaire, par la milice et même parfois par certains maquisards qui ignoraient nos relations avec la Résistance. »
En cas de connivence avec les patriotes traqués par les Allemands ou le régime de Vichy, ils encouraient des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation, ce qui n’excluait pas l’arrestation, voire des mesures extrêmes comme la déportation ou la mort. De même, s’ils affichaient du zèle dans la répression contre les résistants, la menace implacable de représailles planait sur eux.
Le bilan tragique de l’année 1944 au cours de laquelle plus de cinq cents gendarmes ont trouvé la mort, victimes de la barbarie nazie, des combats de la Libération, d’actions contre les maquisards, de l’épuration sauvage et judiciaire, prouve combien était périlleuse la voie qu’ils avaient choisie.
LA GENDARMERIE SOUS L’OCCUPATION
« Ils portaient, comme un digne et redoutable honneur,
Maurice Schumann.
l’uniforme de l’Armée française au milieu de l’ennemi. »
J’ai tenu à Paris, pendant toute la durée de l’occupation allemande, le poste de grande responsabilité de chef de la section Gendarmerie des territoires occupés. C’est à ce titre que le colonel Cazals m’a demandé de présenter son ouvrage qu’il a intitulé : « La Gendarmerie sous l’Occupation ».
Créée à la fin du 12e siècle par le roi Philippe Auguste, sous le nom de Maréchaussée, la Gendarmerie est le plus vieux corps de l’Armée française. Si au cours des siècles, les épreuves ne lui ont pas été ménagées, aucune n’a été aussi redoutable que celle qu’elle a subie au cours des années allant de 1940 à 1945.
Pendant cette période, placée dans une situation exceptionnelle sans précédent, son organisation et son existence mêmes ont été gravement menacées. Elle s’est trouvée confrontée à des problèmes qui ont ébranlé son unité. Des centaines d’officiers, gradés et gendarmes ont été emprisonnés, déportés ou exécutés, du fait de leur résistance à l’occupant.
Cependant, curieusement, une sorte de voile semble recouvrir cette partie de son histoire, pourtant si riche en événements. Celle-ci n’a en effet, jusqu’à ce jour, fait l’objet d’aucune étude exhaustive.
À quoi cela tient-il ?
Certainement tout d’abord au fait que, conséquence d’une guerre particulièrement cruelle, la Gendarmerie a dû par priorité panser des blessures profondes et retrouver son équilibre dangereusement mis en cause et, en outre, faire face à des tâches nouvelles (mise sur pied de prévôtés pour les troupes opérant dans les parties du territoire français non encore libérées et constitution d’unités dans les zones d’occupation en Allemagne et en Autriche) ; ensuite, au fait qu’elle a été rapidement et successivement impliquée dans des conflits en Indochine et en Algérie, conflits au cours desquels elle a dû engager des effectifs importants et subir de lourdes pertes. L’attention des jeunes générations de la Gendarmerie s’est portée normalement vers une actualité où elles avaient leur large place et cela au détriment des événements passés. Le temps s’écoulant a fait ensuite progressivement son œuvre d’oubli.
L’ouvrage du colonel Cazals comble une lacune regrettable. La tâche de son auteur a été difficile car beaucoup d’hommes ayant servi dans la Gendarmerie pendant l’Occupation et qui auraient pu lui apporter leur témoignage sont dispersés ou disparus. Mais, sans se laisser rebuter par ces difficultés, le colonel Cazals a recueilli pendant plusieurs années, avec ténacité et un esprit toujours en éveil, une documentation très étendue et d’une grande qualité. La rigueur et l’impartialité caractérisent l’analyse puis la synthèse qu’il a faite des témoignages rassemblés, car s’il a mis en exergue l’œuvre courageuse accomplie dans son ensemble par la Gendarmerie au profit de ses concitoyens, il n’a pas caché non plus les zones d’ombre. Mais pour juger de ces dernières avec toute la sérénité qui convient à un historien, il a su reconstituer l’atmosphère de l’époque. Et sa conclusion, que je partage entièrement, est qu’à part un nombre réduit de dévoyés, la grande majorité des militaires de la Gendarmerie ont résisté constamment et cela dès le début de l’Occupation, par tous les moyens et dans toute la mesure du possible, aux exigences des autorités allemandes et aux diverses autorités de Vichy.
Avec la normalisation de la situation, la Gendarmerie a retrouvé rapidement son identité et son unité et, comme par le passé, elle demeure un solide rempart de l’État.
L’œuvre du colonel Cazals n’aurait pu être réalisée sans le profond attachement que cet officier supérieur conserve pour une Arme qu’il a servie avec distinction.
Dans l’intérêt de la Gendarmerie, je souhaite à cet ouvrage qui fait honneur à son auteur, une large diffusion et tout le succès qu’il mérite.
AVANT PROPOS
Pierre Charles Sérignan,
Général de division (C.R.).
Depuis sa lointaine origine, en 1191, sous le capétien Philippe Auguste, la Gendarmerie nationale, héritière de la Maréchaussée, a connu les vicissitudes liées aux drames de notre histoire sans jamais cesser, au prix d’un lourd tribut, de remplir sa mission traditionnelle de protection des personnes et des biens.
L’épreuve de l’Occupation, entre 1940 et 1945, est l’une de celles qui ont le plus marqué l’institution confrontée à une situation complexe et redoutable. Le métier des gendarmes n’était pas alors facile. Partagés entre le devoir d’obéissance et l’exigence patriotique, ils s’exposaient, quel que soit leur choix, à de graves dangers. Gendarme à la brigade de Thaninges (Haute-Savoie) en 1943, Henri Berthomieu évoque le climat qui régnait à l’époque :
« Nous étions, indique-t-il, menacés de toute part, par l’occupant, par les collaborateurs, par certains de nos chefs, par les gens du service d’ordre légionnaire, par la milice et même parfois par certains maquisards qui ignoraient nos relations avec la Résistance. »
En cas de connivence avec les patriotes traqués par les Allemands ou le régime de Vichy, ils encouraient des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation, ce qui n’excluait pas l’arrestation, voire des mesures extrêmes comme la déportation ou la mort. De même, s’ils affichaient du zèle dans la répression contre les résistants, la menace implacable de représailles planait sur eux.
Le bilan tragique de l’année 1944 au cours de laquelle plus de cinq cents gendarmes ont trouvé la mort, victimes de la barbarie nazie, des combats de la Libération, d’actions contre les maquisards, de l’épuration sauvage et judiciaire, prouve combien était périlleuse la voie qu’ils avaient choisie.
Le sort de la Gendarmerie, indissociable de celui de ses membres, n’a pas suscité une grande curiosité de la part des historiens qui ne lui ont consacré aucune étude d’ensemble. Sans doute, quelques ouvrages mettent en exergue le comportement de personnels de tous grades qui se sont distingués dans la lutte contre l’occupant, cependant ils ne révèlent qu’un aspect d’une réalité aux multiples facettes.
Paradoxalement, au sein de la Gendarmerie, la discrétion prédomine à l’égard d’une période pourtant cruciale de son existence, riche d’enseignements. Le général Giguet ne le dissimule pas qui écrit en 1984 :
« Quarante années ont passé, pendant lesquelles un voile, que dis-je, un rideau de fer, a été maintenu dans la Gendarmerie sur une époque qui fût pour l’Arme, dans son ensemble, la plus difficile qui se puisse imaginer. »
Dans les écoles de formation où la place réservée à l’enseignement de l’histoire est modeste on ne relate, des années dites « noires », que les épisodes valorisants.
Pourquoi cette mémoire refoulée ? L’indifférence. Peut-être ? Le souci de ne pas raviver des blessures encore mal cicatrisées. Certainement. Il y a semble-t-il surtout la crainte de porter ombrage au prestige de l’institution en évoquant une période que l’on associe à la défaite, à la trahison et à la déportation.
Une manifestation, parmi d’autres, de ce syndrome : la censure cinématographique, en 1956, en donne l’illustration, lorsqu’elle oblige Alain Resnais à effacer, d’un coup de gouache, sur l’affiche de son film « Nuit et Brouillard » adapté de Jean Cayrol, un plan du camp de Pithiviers où apparaissait un képi de gendarme. Il n’obtient le visa qu’au prix de cette rectification.
Depuis son origine jusqu’à nos jours, y compris sous l’Occupation, la Gendarmerie a suffisamment donné de preuves de son attachement au bien public pour ne pas avoir à redouter l’épreuve de la vérité.
À partir de 1980, une évolution se dessine qui laisse augurer une approche plus objective des réalités. Dans son ouvrage « Les gendarmes » Pierre Miquel souligne que « l’Occupation et le régime de Vichy devaient porter à l’Arme universelle des coups cruels ». Plus explicite dans son propos, le général Puthoste écrit en 1982 :
« Je ne veux pas escamoter le drame de la Gendarmerie sous l’Occupation. Il vaut mieux être sincère en reconnaissant que le corps a commis des actes dont il n’a pas lieu de tirer gloire. »
De manière tout à fait officielle, le 26 juin 1992, en présence du ministre de la Défense, et sur le front des troupes, à l’occasion du baptême de la 9e promotion des officiers de la Gendarmerie nationale « chef d’escadron Martin » fusillé par les nazis à Cologne, le 7 octobre 1943, M. Jean-Pierre Dintilhac, directeur général de la Gendarmerie, exprime sans ambages son sentiment sur le rôle joué par la Gendarmerie entre 1940 et 1944 :
« Aujourd’hui, affirme-t-il dans son allocution, il convient de ne pas oublier. Mieux, il faut reconnaître, je le crois, les souffrances que la Gendarmerie, comme d’autres services de l’État, a pu occasionner, volontairement parfois, involontairement le plus souvent, à toutes les victimes innocentes, combattants de l’ombre, déportés pour des motifs politiques ou raciaux, requis pour le S.T.O. Mais il faut, en même temps, pour que cette démarche soit conforme à la vérité, que soit reconnu le rôle éminent rempli par des milliers de militaires de la Gendarmerie, otages du Gouvernement et de l’occupant qui, malgré les risques évidents qu’ils couraient pour eux et leur famille ont su choisir l’honneur plutôt que la honte… »
Autre reflet de la volonté de transparence qui se manifeste depuis quelques années : la Revue historique des Armées publie en 1991, fait sans précédent depuis la Libération, des articles écrits par des officiers de l’Arme qui n’éludent aucun des aspects de l’activité de la Gendarmerie de l’État français.
Pour que la clarification soit complète, il reste à exhumer des archives les données, au moins numériques, sur l’épuration de la Gendarmerie passées jusqu’à présent sous silence. Leur connaissance serait de nature à corriger les critiques injustifiées que d’aucuns, quelquefois, portent hâtivement sur l’ensemble de ce corps.
Quant aux acteurs, d’une manière générale, pour diverses raisons, ils sont peu loquaces. Excès de modestie pour les uns. Plus nombreux qu’on ne le croit, bien que n’étant pas affiliés à des mouvements de résistance, ils ont affirmé, en maintes circonstances, leur opposition à l’ennemi. Très souvent, les services rendus étaient ignorés d’ailleurs de ceux qui en avaient bénéficié. Scrupules pour les autres. Comment ne pas comprendre le silence des personnels qui ont été chargés de besognes ingrates dont ils ont été les exécutants forcés. Quel gendarme, commandé pour participer à une exécution capitale, voudrait relater un souvenir aussi cruel ? Quel officier, désigné pour siéger dans une juridiction d’exception, accepterait d’évoquer les jugements sans appel auxquels on l’a associé ? Quel exécutant, requis pour arrêter des Juifs ou les conduire aux frontières du Reich, ultime étape avant les camps de la mort, oserait témoigner ?
Un demi-siècle s’est presque écoulé depuis l’Occupation, pourtant on connaît mal, quand on ne l’ignore pas, le drame sans précédent vécu par la Gendarmerie entre 1940 et 1945. Le temps est venu, dépassant tous les tabous, d’en examiner la trame pour tenter de dresser un premier bilan. Aussi est-ce une vue, la plus détaillée possible, de la Gendarmerie dans la tourmente de l’Occupation, que nous voudrions présenter au lecteur. Elle montrera l’usage que le régime de l’État français en a fait et la manière dont les gendarmes se sont comportés. Elle mettra en évidence ombres et lumières car la recherche de la vérité ne s’accommode ni du silence ni de la complaisance.
Dans leur grande majorité, les gendarmes ont servi avec l’humble volonté de contribuer, là où ils se trouvaient, comme ils le pouvaient, à l’effort d’une France en quête de sa liberté s’efforçant, au travers de circonstances dont ils n’étaient pas maîtres, de maintenir l’intégrité, l’identité et l’honneur de l’institution.
Des égarés ont failli, rarement mercenaires ou collaborateurs, le plus souvent prisonniers d’une conception dogmatique de la discipline, influencés par la peur ou la propagande. Leur cas ne peut qu’inspirer de la compassion.
Si l’on se réfère à l’opinion émise en 1952 par le général Martin, directeur général de la Gendarmerie d’août 1943 à août 1944, toute entreprise ayant pour objet de retracer l’histoire de l’institution pendant l’Occupation est vouée à l’échec car, d’après lui, les faits qui se sont produits « n’ont laissé aucune trace écrite. »
Son point de vue rejoint celui d’un de ses anciens chefs de bureau. Alors que ce dernier, dans les années cinquante, exerce de hautes responsabilités dans l’Arme, il reçoit la visite d’un universitaire de renom désireux de consulter les archives de la Gendarmerie des années 1940 à 1944. Il lui indique, d’une part, qu’il ne trouverait pas grand-chose car périodiquement elles sont en partie incinérées, de l’autre, que les écrits disponibles ne refléteraient pas la réalité ayant été rédigés, pour la plupart, de telle manière qu’aucune personne ne puisse être mise en cause par l’occupant.
Ces assertions qui postulent l’inexistence ou le manque de fiabilité des sources écrites ne reposent sur aucun fondement sérieux.
Le décret du 5 décembre 1902 sur l’administration et la comptabilité des corps de la Gendarmerie, toujours en vigueur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, distingue les archives confidentielles et non confidentielles. Les premières, selon leur nature, sont détruites dans un délai compris entre 1 et 20 ans. La Gendarmerie verse les secondes à l’administration des domaines dans un laps de temps qui s’échelonne entre 1 et 5 ans.
Par suite des circonstances, dès le mois d’août 1944, depuis Rennes où elle se trouve momentanément, la nouvelle direction de la Gendarmerie déroge aux règles en usage en prescrivant, à tous les commandants de formations, de procéder au blocage et à la mise sous scellé de la totalité des archives correspondant à la période de l’Occupation ennemie. Le 2 novembre, elle donne l’ordre de les acheminer sur Paris en vue de leur exploitation pour les besoins de l’épuration interne.
À l’exception des archives saisies dans plusieurs départements (Lot, Loire, etc.) par des organisations de résistance, qui n’ont jamais été restituées et que détiennent des particuliers, mis à part également des correspondances découvertes au siège de la police allemande à Paris, confiées au Centre de documentation juive contemporaine, toutes les autres sont déposées, soit au Centre administratif de la Gendarmerie au Blanc, soit aux Archives nationales ou encore au Service historique de l’armée à Vincennes, enfin dans les Services d’archives départementales. Il est donc inexact d’affirmer qu’il ne subsiste aucune trace des événements de l’époque.
Différents documents (rapports, comptes rendus, procès-verbaux, etc.) ont certes été falsifiés pour protéger des personnes menacées. Sans en sous-estimer le nombre, on ne saurait cependant contester la validité de la majeure partie des correspondances établies.
Témoignages, enquêtes, archives diverses, constituent l’assise de ce travail, fruit de longues investigations et cependant incomplet. Il ne prétend pas être œuvre d’historien mais simplement une contribution à la connaissance de la Gendarmerie pendant le temps du chagrin. À ceux qui voudront bien le lire, l’auteur devait ces explications liminaires.
I – LES PRÉMICES DE L’OCCUPATION
CHAPITRE 1 – L’EFFORT DE GUERRE
On ne saurait examiner la situation de la Gendarmerie de l’État français, pendant l’Occupation, sans décrire préalablement la physionomie de celle de la 3e République dans les onze mois qui précèdent l’armistice.
En 1939, trois textes de base fixent les attributions, les droits et les devoirs de la Gendarmerie : la loi du 28 germinal An VI (17 avril 1798), les décrets du 20 mai 1903 et du 17 juillet 1933.
Comme le précise sa charte fondamentale, la loi du 28 germinal An VI, « le corps de la Gendarmerie est une force instituée pour assurer, dans l’intérieur de la République, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. »
Héritière de la Maréchaussée, force militaire qui fut pendant des siècles le seul corps exerçant dans notre pays un rôle de police, la Gendarmerie a la charge de faire respecter la loi au sein des populations placées sous sa surveillance. Concrètement, elle participe à la police judiciaire, d’essence répressive, qui consiste à rechercher les infractions à la loi pénale, à les constater, à en rassembler les preuves et à en découvrir les auteurs. Si une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction.
Elle concourt également à la police administrative, essentiellement préventive, qui vise à empêcher le désordre sous toutes ses formes. Dans ce cadre, elle effectue des missions de maintien de l’ordre, de secours, de protection, d’aide et d’assistance.
Elle joue, aussi, un rôle de premier plan dans l’activité militaire générale : préparation et exécution de la mobilisation, responsabilité en temps de guerre de la prévôté aux armées où elle détache officiers et sous-officiers.
Enfin, elle a une vocation interministérielle, toutefois elle consacre la plus grande partie de son activité au profit des départements de la Justice, de l’Intérieur et de la Guerre.
Du point de vue de sa compétence, son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire mais elle tend plus particulièrement à assurer la sécurité des campagnes et des voies de communication.
Au plan fonctionnel, comment la Gendarmerie est-elle mise en mouvement ? Normalement, elle intervient d’initiative, spontanément. Le gendarme ne reçoit d’ordre que de ses chefs, agissant eux-mêmes dans la plénitude des droits et des devoirs que la loi leur a donnés. Ce mode d’intervention, le plus habituel, est appelé « service ordinaire ». Il s’oppose au service dit « extraordinaire » que les gendarmes effectuent sur réquisition, à la demande des autorités expressément désignées par la loi (préfets, magistrats, etc.) et dans les cas prévus (ordre public, etc.). Les demandes de concours écrites en vue de remplir des missions conformes à ses attributions entrent dans cette catégorie de service.
Forte de 54 000 hommes, dont 1 514 officiers, en août 1939, la Gendarmerie relève du ministère de la Défense nationale et de la Guerre. Bien que n’étant pas par destination une troupe de manœuvre et de combat, elle est, comme de nos jours, une organisation militaire.
Son insertion dans les armées se réalise par deux organismes : la sous-direction de la Gendarmerie et l’inspection d’Arme. Une sous-direction rattachée à la direction du Contentieux, de la Justice militaire et de la Gendarmerie, encore désignée sous l’appellation de 10e direction, assure le commandement supérieur sous l’autorité d’un directeur civil secondé par un général sous-directeur issu de l’Arme.
La 10e direction, installée à Paris, au numéro 10 de la rue Saint-Dominique, dans l’un des immeubles du ministère, occupe au troisième étage une quinzaine de pièces exiguës et encombrées d’archives.
Pour la première fois dans l’histoire de l’Arme, le 1er juin 1939, le Gouvernement nomme au poste de directeur un magistrat de l’ordre administratif, M. Léonard, proche collaborateur d’Édouard Daladier. Il succède à M. Oudinot, conseiller à la cour d’appel de Paris. Le colonel Fossier, nouveau sous-directeur, remplace le général Deprez.
Depuis 1934, un membre du Conseil supérieur de la guerre portant le titre d’inspecteur général de la Gendarmerie exerce le contrôle des différents commandements. Pour l’année 1939, la mission incombe au général d’armée Bourret qui dispose d’un petit état-major comprenant deux officiers de Gendarmerie. On retiendra le nom du capitaine Robelin, nommé ultérieurement sous-directeur de la Garde. Membre de l’O.R.A., la Gestapo l’arrête, en juillet 1944, et l’assassine le 19 août, après l’avoir sauvagement martyrisé.
Autres rouages du commandement supérieur : les officiers généraux placés à la tête des arrondissements d’inspection de Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy et Alger pour l’Afrique du Nord, chargés du contrôle du service.
Dans le domaine de l’organisation, la Gendarmerie sous la 3e République comprend : la gendarmerie départementale, la Garde républicaine mobile, la Garde républicaine de Paris, la Gendarmerie d’Afrique du Nord et la Gendarmerie coloniale.
Première par le nombre, avec ses 26 000 hommes implantés jusqu’au niveau du canton où les unités éclatées sont au contact des gens et vivent de leur vie, la gendarmerie départementale assume les missions traditionnelles de police judiciaire, administrative et militaire. Sa cellule organique, la brigade, constituée de 5 à 10 hommes, est la plus petite unité ayant à sa tête un chef responsable : maréchal des logis-chef, adjudant ou adjudant-chef. La section, commandée par un officier subalterne est constituée par l’ensemble des brigades d’un arrondissement. Au chef-lieu de département, on trouve la compagnie placée sous les ordres d’un chef d’escadron ayant sous son autorité les commandants de section et de brigade. Enfin, la légion qui forme corps regroupe plusieurs compagnies et s’étend dans les limites de la division militaire. Son chef, du grade de colonel, outre ses responsabilités administratives, veille à l’efficacité du service accompli par les échelons subordonnés.
Créée par le décret du 10 septembre 1926, à partir des pelotons mobiles de la Gendarmerie, la Garde républicaine mobile (G.R.M.), force spécialisée dans le maintien de l’ordre mais aussi auxiliaire de la gendarmerie départementale, totalise 21 000 hommes, en 1939, répartis dans 492 pelotons, constituant 175 compagnies, 57 groupes et 15 légions dont une en Algérie.
L’uniforme de la G.R.M. se distingue de celui de la G.D. uniquement par la couleur des attributs « or » pour les officiers et les gradés au lieu « d’argent ». Le bandeau de képi des gardes est rouge.
La G.R.M. participe également à l’instruction militaire de la jeunesse et des réserves. Le plan de mobilisation, élaboré en 1937, prévoit qu’en cas de conflit la G.M.R. envoie aux armées, en unités constituées, des groupes, compagnies ou pelotons en vue de leur emploi, soit à la surveillance des frontières, soit en réserve générale. Une partie des formations de la G.R.M. non affectées de la sorte fournit l’encadrement des unités de réserve d’infanterie et de cavalerie. Le reliquat est maintenu en disponibilité, pour les besoins de la sécurité intérieure. Ainsi, la G.R.M. concourt à la fois à la sécurité publique et à la Défense nationale.
De même essence que la G.R.M., le groupe spécial autonome de Versailles, en garnison au camp de Satory, seule unité blindée de la Gendarmerie, constitue avec ses 400 hommes répartis dans deux compagnies de chars et une d’automitrailleuses une réserve gouvernementale utilisée en cas de crise grave.
Autre composante de la Gendarmerie : la Garde républicaine de Paris qui effectue principalement des missions de sécurité et des services d’honneur au profit des hautes autorités de l’État. Placés sous les ordres d’un colonel, ses 3 000 hommes forment 3 bataillons d’infanterie et 4 escadrons de cavalerie.
La Gendarmerie d’Afrique du Nord, avec 4 légions dont une de G.R.M., compte 3 500 hommes.
Le potentiel de la Gendarmerie coloniale implantée sur nos différentes possessions, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique, s’élève à 927 hommes fractionnés en 16 détachements, prévôtés et missions diverses.
Les personnels de la Gendarmerie se recrutent parmi les militaires et anciens militaires. L’école d’application de la Gendarmerie installée à Versailles, rue d’Anjou, dans une annexe de l’école des chars, forme les officiers. Y sont admis, en principe chaque année, sur concours, en nombre variable, selon les besoins d’encadrement, des officiers-élèves capitaines et lieutenants provenant des corps de troupe. Dans des conditions analogues l’école ouvre aussi ses portes à des gradés de Gendarmerie en qualité d’élèves-officiers.
Hormis le cas particulier des officiers, les autres candidats à la Gendarmerie, qui satisfont aux conditions morales requises, subissent un examen préalable comportant une dictée, une rédaction et une épreuve de calcul. S’ils obtiennent la moyenne, la direction prononce leur admission dans l’Arme et les incorpore dans des pelotons de G.R.M. Elèves-gendarmes, ils acquièrent les connaissances nécessaires pour remplir leurs futures fonctions. À l’issue de la formation, d’une durée de 6 mois, s’ils totalisent le nombre de points exigés, ils reçoivent un certificat de titularisation puis prêtent serment avant d’être affectés en brigade.
Tel est, dans ses grandes lignes, le profil de la Gendarmerie au début de l’été 1939 alors que de lourds nuages annonciateurs d’orages s’amoncellent sur l’Europe.
* *
*
L’imminence d’un conflit avec l’Allemagne, en août 1939, ne fait plus de doute. La Gendarmerie adopte son organisation du temps de guerre. Sur instruction du Gouvernement, elle rappelle ses permissionnaires. Les gendarmes d’Afrique du Nord et des colonies que la mesure surprend en métropole, au lieu d’être maintenus sur place, comme ils l’avaient été en 1914, reçoivent l’ordre de rejoindre leurs postes.
Le 21 août prend fin, à l’école d’application de la Gendarmerie, le stage réservé aux 30 officiers-élèves regroupant des Saint-Maxentais et des Saumurois admis au mois de mai. La promotion, baptisée Rhin-Moselle-Gendarmerie, bénéficie d’un congé de fin d’études. Les événements l’écourtent puisque, dans la dernière semaine d’août, les nouveaux officiers et leurs cadres reçoivent une affectation de mobilisation dans des unités d’infanterie ou de cavalerie. L’école ferme officiellement ses portes le 1er septembre.
Le déclenchement des mesures de prémobilisation met à contribution la Gendarmerie comme le prévoit la loi du 13 juillet 1937 portant organisation générale de l’armée. Du succès de la phase initiale de la mobilisation dépend la capacité de réaction de la nation face à une agression. Tout retard dans la mise sur pied des forces est de nature à compromettre l’efficacité de la riposte.
À travers tout le pays, dès le 21 août, aidés par des estafettes civiles, les gendarmes sillonnent les communes pour remettre des convocations aux réservistes et apposer les affiches ordonnant l’appel aux armes. Le 23, la mesure n° 103 convoque les cadres prémobilisateurs des régiments de série « B ». Le 24, une autre mesure ordonne aux réservistes, détenteurs d’un ordre ou fascicule de mobilisation portant en surcharge le chiffre 4, de se mettre immédiatement en route pour rejoindre leurs unités d’affectation. Le 26, les porteurs de fascicule n° 6 sont rappelés à leur tour.
À partir du 27 août, la Gendarmerie met sur pied des détachements prévôtaux prélevés, en majeure partie, dans les formations de gendarmerie départementale. La G.R.M. fournit une compagnie à 3 pelotons pour garder le Grand Quartier général.
Les prévôtés remplissent aux armées des missions de police conformément à l’instruction sur le service en campagne de la Gendarmerie. Ce document, élaboré en 1911, déjà désuet en 1918, est complètement périmé en 1939. Néanmoins, les gendarmes l’adaptent aux circonstances.
La mise en place des prévôtés s’échelonne du mois d’août 1939 au mois d’avril 1940 en raison de la création tardive des grandes unités cuirassées comme les 3e et 4e division ou la 3e division légère mécanique.
Le journal de marche de la compagnie de gendarmerie départementale de l’Aveyron note :
« Le 27 août 1939, le capitaine Clément commandant la section de Villefranche-de-Rouergue et le lieutenant Campion de la section d’Espalion gagnent Montpellier pour aller, l’un à la prévôté du 1er corps d’armée, l’autre à la prévôté de la 31e division d’infanterie. Ces prévôtés, poursuit le rédacteur, embarquent le 31 août et le 1er septembre pour leur lieu de cantonnement. »
En février 1940, la légion de Montpellier met sur pied la prévôté de la 3e division légère mécanique, commandée par le capitaine Ficini, qui comprend 3 gradés et 27 gendarmes. Elle rejoint la division à l’entraînement au camp de Caudry puis à celui de Sissonne.
Une fois le dispositif réalisé, on compte 150 prévôtés réparties dans les quartiers généraux de 106 divisions, 26 corps d’armées, 9 armées et 9 détachements de liaison auprès du corps expéditionnaire britannique, soit plus de 3 500 gendarmes dont 150 officiers et 300 gradés.
En outre, la Gendarmerie renforce les états-majors des grandes unités auprès desquels elle détache des officiers notamment tous les brevetés (échelon G.Q.C., division, corps d’armée, armée). D’autres, provenant de la G.R.M., prennent le commandement d’escadrons dans les G.R.D.I. et les G.R.C.A. (groupe de reconnaissance de division d’infanterie et de corps d’armée), éléments montés ou motorisés chargés, avant toute opération d’envergure, de rechercher du renseignement sur zone.
À partir du 26 août, 6 000 gardes républicains mobiles rejoignent, pour les encadrer, des formations mobilisées de l’armée de Terre : unités de forteresse, centres de mobilisation de régiments d’infanterie et de cavalerie, bataillons d’Afrique, bataillons de mitrailleurs, etc.
Les sous-officiers titulaires du brevet de chef de section ou de peloton reçoivent des commandements correspondant à leur qualification ou secondent des officiers de réserve. Quelques-uns sont promus sous-lieutenant à titre temporaire.
La tâche des uns et des autres n’est pas aisée car les unités sont formées de troupes anciennes appartenant aux formations de série « B », sous-encadrées et sous-équipées. Les noyaux actifs (personnels d’active) sont calculés au plus juste.
Le moral des gardes est bon. Le manque d’expérience des cadres de réserve ne paraît pas l’affecter. Plus grave, les dotations réglementaires ne sont pas réalisées. L’armement est souvent anachronique. Et puis, comme le révèle le général Dufieux, inspecteur de l’infanterie, les gardes ne sont pas toujours bien préparés pour remplir leur mission :
« À la 18e division (9e armée) où l’on manque de sous-officiers, note-t-il dans un rapport, on les a remplacés par des gardes républicains mobiles qui sont loin de bien diriger les hommes… »
Toujours à la fin du mois d’août 1940, des G.R.M. encadrent 16 compagnies frontalières dérivées de 16 pelotons de G.R.M. appartenant aux 4e, 7e et 8e légion. L’état-major de l’armée a décidé leur création en 1936 pour permettre de couvrir rapidement la ligne Maginot pendant les opérations de mobilisation. Elles s’intègrent dans un dispositif comprenant des blindés légers et 59 pelotons de la G.R.M. Un noyau actif de 40 officiers, gradés et gardes constitue l’ossature de chaque compagnie qui comprend 80 auxiliaires, tous volontaires, recrutés dès le temps de paix par la gendarmerie départementale. Ces unités, équipées de voitures, de side-cars et d’un armement léger, prennent position dans les secteurs frontaliers qui leur sont assignés. Ainsi, la 535e compagnie, dérivée du 2e peloton de la 11e compagnie de G.R.M., surveille le secteur compris entre Altenstadt, Wissembourg et Weiler.
La mission de couverture de la frontière dévolue à la G.R.M. absorbe 3 000 hommes. Elle prend fin à la mi-octobre. À cette occasion, le général commandant la région de Metz lui adresse ses félicitations et ses remerciements :
« Chargés à l’extrême-avant, écrit-il, d’une mission délicate et périlleuse qui pouvait être une mission de sacrifice, ils y ont fait face avec une intelligence, un dévouement et un courage qui ne se sont jamais démentis… »
En outre, le commandement décerne aux G.R.M. les quatorze premières Croix de guerre.
Toujours au profit du corps de bataille, l’état-major de l’armée place 300 hommes de la G.R.M. dans les réserves générales.
À Strasbourg, une compagnie de la 4e légion de G.R.M. participe activement à la surveillance de la ville totalement évacuée vers le sud-ouest à partir du 1er septembre 1939. Elle y reste jusqu’au 14 juin 1940. Pendant son séjour, on n’y déplore aucune exaction. Repliés sur Saint-Dié, les gardes sont employés au maintien de l’ordre jusqu’au 26 juin. Ils s’opposent en particulier au pillage de la gare et des magasins.
Le 25 août, l’inspection générale de la Gendarmerie cesse toute activité. Le général Bourret prend le commandement de la 5e armée et rejoint son P.C. à Saverne (Alsace) où le précède le capitaine Robelin affecté au 3e bureau.
Fin septembre, le ministère crée une inspection générale de la Gendarmerie de l’intérieur. Le général Bucheton, ancien directeur de 1928 à 1932, en prend la tête. Jusqu’en juillet 1940, inlassablement, il visite les unités, stimule l’énergie des cadres et les oriente dans l’accomplissement des tâches nouvelles nées de la guerre qui, chaque jour, posent aux gendarmes des problèmes différents. Le mythe de la 5e colonne entraîne investigations sur investigations. Le climat d’espionnite qui se développe dans le pays oblige les gendarmes à la vigilance et au contrôle des informations qui affluent dans les brigades.
Le vendredi 1er septembre, à l’aube, la Wehrmacht envahit la Pologne. À 10 heures, un conseil des ministres se tient à l’Élysée. Le Gouvernement décrète la mobilisation générale. Immédiatement la radio d’État porte l’événement à la connaissance des Français. Toutes les brigades reçoivent le télégramme fixant au samedi 2 septembre le 1er jour de la mobilisation des armées de Terre, de Mer et de l’Air.
La Gendarmerie s’investit totalement dans l’exécution des mesures prévues au plan de mobilisation. Sur l’ensemble du territoire, en des points déterminés à l’avance, mairies, gares, postes… les gendarmes apposent les affiches de mobilisation générale, détenues dans les brigades dès le temps de paix, enjoignant à tous les Français soumis aux obligations militaires de rejoindre leurs unités d’affectation. Dans les délais fixés, 4 millions de réservistes gagnent les centres de mobilisation qui leur sont assignés. Partout, sur les routes, dans les gares, dans les centres de réquisition où sont rassemblés les véhicules et matériels destinés aux armées, les gendarmes veillent au bon ordre des opérations.
Depuis son origine, la Gendarmerie a participé à la quasi-totalité des guerres nationales. Pour perpétuer cette tradition, courant octobre 1939, la sous-direction propose à l’état-major de l’armée la création d’une unité blindée. Le haut-commandement hésite à donner son accord car la réalisation d’un tel projet risque d’affaiblir la Gendarmerie dont les charges s’accroissent (surveillance du territoire, maintien de l’ordre, etc.). Or un maximum d’effectif est nécessaire à l’intérieur, en dehors de la zone des armées. Finalement, il accepte mais exige que le nombre de gendarmes détachés dans cette unité soit uniquement celui nécessaire à l’encadrement et à l’exécution des missions de combat. Le complément devant être fourni par des militaires mobilisés.
La Gendarmerie met ainsi sur pied le « 45e bataillon de chars légers de la Gendarmerie » à partir du groupe spécial de Satory. Le 26 octobre, la sous-direction lance un appel à volontaires qui suscite un grand enthousiasme. Les postulants provenant de la G.D., de la G.R.M. et de la G.R.P. rejoignent Satory en décembre 1939.
Le 505e régiment de chars de combat de Vannes complète l’effectif. Le grand séminaire de Versailles, transformé en cantonnement, les accueille. À la fin de l’année, le bataillon comprend 19 officiers, 266 gradés et gendarmes que renforcent 1 officier du service de santé, 2 officiers, 10 sous-officiers d’infanterie, 269 caporaux et chasseurs mobilisés.
Le bataillon, articulé en trois compagnies de combat et une d’échelon, s’entraîne, sans relâche, dans la région de Satory, malgré des moyens très insuffisants. Le 22 février 1940, il ne dispose que de 3 chars légers Hochkiss H 35 sur les 48 prévus et d’une dizaine de véhicules automobiles. À partir de la mi-mars, la réalisation des dotations de guerre s’accélère. Pourtant, des équipements essentiels font défaut. Les chars, dépourvus de moyens de transmission radioélectriques, ne communiquent entre eux que par fanions, comme ceux de la grande guerre !
Le 15 avril, avant que la 1re compagnie ne parte en avant-garde pour manœuvrer dans la région d’Heuringhem (Pas-de-Calais), le président du comité des retraités de la Gendarmerie et de la Garde républicaine de Versailles et Seine-et-Oise lui remet une oriflamme à l’occasion d’une prise d’arme organisée à Satory. Le reste du bataillon, commandé par le chef d’escadron Bezanger, quitte son cantonnement le 28 avril après avoir été inspecté par le directeur M. Léonard. Il se concentre près de Reims, à Boult-sur-Suip et à Bazancourt, où le rejoint la 1re compagnie.
Début novembre 1939, pour combler dans la gendarmerie départementale les vacances provoquées par le départ aux armées (prévôtés) de nombreux cadres et gendarmes, la direction fait appel à des réservistes. Elle autorise les anciens sous-officiers de l’Arme ainsi que des volontaires issus de la population civile à prendre des engagements, pour la durée de la guerre, au titre des corps de G.D. Les intéressés, admis en qualité de gendarmes auxiliaires, prêtent serment et recomplètent les brigades en sous-effectif. Dans les mêmes conditions, des officiers de Gendarmerie, dégagés des obligations militaires, peuvent reprendre du service. Ceux qui, en activité, atteignent la limite d’âge de leur grade ont la possibilité de rester à leur poste pour des périodes de 6 mois renouvelables.
Pour maintenir le potentiel de la G.R.M. à un niveau suffisant, dans la zone de l’intérieur, une circulaire du 30 janvier 1940 prévoit l’admission, comme gardes auxiliaires, des militaires volontaires des classes 1916 à 1930.
Le 17 mai 1940, un décret porte création, pour la durée des hostilités, de sections de gardes territoriaux organisées, suivant les besoins, par communes et chargées de prendre part à l’action de protection du territoire contre l’ennemi, en arrière du front.
L’état-major de l’armée les rattache aux brigades de Gendarmerie dans le ressort desquelles elles sont levées et les place sous l’autorité des commandants de compagnie.
Malgré l’afflux de volontaires qui se présentent par milliers dans les brigades, la dégradation de la situation militaire est telle qu’il faut interrompre le processus de leur mise sur pied. Parmi les sections créées initialement, quelques-unes, dans la Haute-Marne et la Haute-Saône, participent, courant juin, aux côtés de gendarmes départementaux, à des actions retardatrices en liaison avec des unités du corps de bataille.
À Paris, pour les besoins du maintien de l’ordre et de la défense du secteur de sûreté couvrant l’approche de l’agglomération, le commandement regroupe dans une brigade mixte de Gendarmerie, aux ordres du général Gest, la Garde républicaine, les 21e, 22e, 23e légions de G.R.M., des éléments du groupe spécial de Satory, les pelotons motorisés n° 37, 38, 39, 40. Au début de juin 1940, les autorités militaires y adjoignent un bataillon du génie, un groupe d’artillerie et un bataillon de chars appartenant à l’infanterie commandés par le chef de bataillon Bossard.
D’août 1939 à mai 1940, la Gendarmerie continue d’exécuter normalement son service et de mettre au point son dispositif du temps de guerre que les hostilités ne vont pas tarder à mettre à l’épreuve.
* *
*
À 5 h 30, le 10 mai 1940, Hitler déclenche l’offensive contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Pendant que la Luftwaffe bombarde méthodiquement les objectifs stratégiques des pays alliés (gares, aérodromes, nœuds de communication, ponts…), les panzerdivisions déferlent sur le terrain. La ligne Maginot est tournée. La charnière des Ardennes éclate. La Meuse franchie, c’est la percée fulgurante entre Namur et Sedan qu’impuissantes nos forces ne réussissent pas à contenir.
Le sort des gendarmes, présents sur le théâtre des opérations, à quelque titre que ce soit, se confond dès lors avec celui des militaires des corps de troupe engagés dans la bataille.
Partout, ils se battent résolument et se signalent par des actions courageuses que récompensent citations individuelles et collectives. Le 45e bataillon de chars légers est cité à l’ordre de l’armée pour sa brillante conduite :
« Belle unité de chars de combat composée d’éléments de la Gendarmerie, animée comme cette dernière du sentiment élevé du devoir et remarquablement imprégnée par la noblesse de la discipline. Sous le commandement du chef de bataillon Bézanger a participé brillamment à tous les combats de la 3e division cuirassée, en mai et juin 1940, jusqu’au sacrifice total de tous ses chars, remplissant les missions confiées avec une ingénieuse ardeur et un sens technique très sûr. S’est plus spécialement distinguée, au cours de plusieurs contre-attaques, en liaison avec l’infanterie, dans la trouée au sud de Sedan. A mérité pleinement une place d’honneur dans les annales de gloire de la Gendarmerie. »
La 14e compagnie de la 1re légion de G.R.M. obtient une citation, à l’ordre de la division, non moins élogieuse :
« Le 21 mai 1940, se dirigeant sur Beauvais s’est heurtée à des éléments ennemis à Nolette et a livré un combat de nuit de cinq heures pour forcer le passage de la Somme. Rejetée vers le nord, le 22 mai a assuré, contre un ennemi supérieur en moyens, la défense de la coupure de la Liane à Pont-de-Briques. Du 28 mai au 4 juin a participé à la défense de Dunkerque où seulement un peloton a pu être embarqué. »
Dans les zones où se déroulent des combats, compagnies et pelotons motocyclistes de la G.R.M., malgré le désarroi général, font preuve de discipline et d’abnégation.
Les gendarmes des prévôtés accomplissent leurs tâches avec autant de conviction. La prévôté de la 14e D.I., du général de Lattre de Tassigny, se signale par son action méthodique et courageuse qui lui permet de maintenir constamment en ordre les mouvements de la division. Celle du 18e corps d’armée assure avec sang froid, du 10 au 15 mai, malgré d’incessantes attaques aériennes, l’évacuation de la population civile de toute la zone du corps d’armée. La prévôté du 24e corps d’armée rend des services appréciés en rétablissant sur les routes le trafic bloqué par les convois de réfugiés, notamment à Gien du 15 au 18 juin 1940 où, sous des bombardements violents, elle garantit la circulation sur les ponts de la Loire. L’intensité de la bataille dans le secteur de la 18e D.I. empêche la prévôté de remplir ses missions, son capitaine la transforme en unité combattante.
Sur le front des Alpes, où l’Italie entre en guerre le 10 juin, une poignée de gendarmes se distingue aux côtés des chasseurs alpins. Le 28, la brigade d’Abriès est citée à l’ordre de la 4e demi-brigade tandis que le commandant d’unité, le chef Woerhlé, est nommé à titre exceptionnel chevalier de la Légion d’honneur. Le libellé de la citation à l’ordre de l’armée qui motive sa nomination témoigne de son audace :
« À rendu pendant de longs mois de précieux services au commandement dans la difficile recherche des renseignements en haute-montagne. Le 20 juin, s’est joint à une section de combat engagée en première ligne, dans le Haut-Guil, contre un ennemi très supérieur en nombre. A combattu sans peur et sans repos. Le 23 juin a participé, comme volontaire, à une patrouille de 6 hommes qui a capturé trois officiers et quarante gradés ou alpini. Magnifique exemple de courage et d’ardeur patriotique. En paix, comme en guerre, a honoré par ses actes son arme d’élite. »
Sur la stèle commémorative érigée après la guerre pour honorer ses défenseurs, la commune d’Abriès n’a pas oublié ses gendarmes. On peut y lire :
« À un contre douze, les chasseurs du 87e B.C.A. du 107e B.C.A., les alpins du 92e B.A.F., les gendarmes d’Abriès, les canonniers du 172e R.A.M., du 93e R.A.M. ont sauvé Abriès de l’invasion. Juin 1940. »
À la signature de l’armistice, fin juin, les pertes de la Gendarmerie s’élèvent à 377 tués parmi lesquels 26 officiers et à plus d’un millier de blessés.
Le 45e bataillon de chars légers, encerclé le 17 juin par une panzerdivision, dans la région de Tavernay, est décimé. À lui seul, il totalise 30 tués, 4 disparus et 59 blessés. Les Allemands emmènent son chef en captivité ainsi que tous les équipages rescapés.
Sur un total de 1 830 000 prisonniers internés, on dénombre 5 000 militaires de la Gendarmerie de tous grades y compris un général, le général Nicolet, prévôt de la 5e armée, capturé à la mi-juin et détenu dans la forteresse de Koenigstein. Sa libération intervient en juillet 1941, en même temps que celle de plusieurs officiers et sous-officiers, dans le cadre de négociations engagées par la Gendarmerie avec les autorités allemandes.
Le 22 juin, dans les Vosges, des troupes allemandes cernent la prévôté du 13e corps d’armée. Elles dirigent les gendarmes sur le camp de prisonniers de Neuf-Brisach où sont déjà regroupés 450 autres gardes et départementaux. Les intéressés y restent jusqu’au 4 août, date de leur acheminement vers le fronstalag 140 à Belfort.
L’histoire mouvementée du gendarme Godignon, de la brigade de Doyet (Allier), affecté à la prévôté du 13e corps d’armée, mérite que l’on s’y attarde un moment. Le 13 janvier 1941, probablement à la suite d’une erreur, les Allemands l’incorporent dans un convoi de 1 500 républicains espagnols déportés au camp de Mathausen. Pendant plusieurs mois, il partage, avec ses compagnons vêtus de la tenue rayée bleue et blanc, le calvaire de l’univers concentrationnaire : cruauté des gardiens S.S., travail dans la carrière de granit de Linz, spectacle des exécutions sommaires. Libéré après plusieurs démarches de la mission Scapini, il rentre très affaibli dans sa brigade le 28 octobre 1941. Dès son retour, il établit à l’intention du commandement un rapport détaillé sur le sort réservé aux déportés et les sévices qu’il a personnellement subis. Ce document, retrouvé par l’historien Pierre Miquel au Service historique de l’armée à Vincennes, prouve que, dès 1941, les autorités françaises n’étaient pas dans l’ignorance de ce qui se passait dans les camps de la mort.
Les Allemands capturent la prévôté de la 3e D.L.M., le 24 juin, au carrefour de la Couronne, près d’Angoulême. Cette formation, encerclée dans la nasse de Dunkerque, avait pourtant réussi à embarquer pour l’Angleterre le 2 juin. Débarquée à Plymouth, elle réembarque quelques jours après à destination de Brest. Puis, c’est le repli vers le sud-ouest. Après avoir désarmé tous les prisonniers, les Allemands les rassemblent près de la Gendarmerie. Les évasions, à ce moment-là, sont encore relativement faciles, ce qui n’exclut pas des risques pour les candidats à la liberté. Cependant, le nombre de ceux qui osent tenter leur chance est dérisoire. La majorité des captifs persiste à croire, à tort, à une libération imminente. Quelques gendarmes ne se résignent pas à la servitude. Le 26 juin, quatre d’entre eux, le chef Cazals, les gendarmes Malafosse, Terras et Poudac sur un effectif de 24 faussent compagnie à leurs gardiens. Après avoir franchi les lignes ennemies, ils rejoignent Ribérac où ils retrouvent leur officier, le capitaine Ficini, évadé comme eux. Individuellement ils rejoignent ensuite leurs brigades respectives. Curieusement, lorsqu’ils postuleront en 1945 pour la médaille des évadés, le colonel D…, inspecteur de la région de Gendarmerie transmettra leur demande avec avis défavorable :
« Le gendarme X… est resté captif quelques heures seulement. Il ne remplit pas « du moins à mon sens » les conditions imposées par l’article 6 de l’ordonnance du 7 janvier 1944. En conséquence, j’émets un avis défavorable à la présente demande. »
Néanmoins, les instances supérieures en décideront autrement.
Sur les 12 000 militaires de la Gendarmerie qui, à des titres divers, ont participé aux hostilités, plus de 7 000 échappent à la capture et parviennent à rejoindre, soit isolément, soit en unités constituées, la zone non occupée.
Quelques compagnies et pelotons de la G.R.M. comme d’ailleurs des prévôtés, transitent préalablement par l’Angleterre, après un embarquement périlleux à Dunkerque. Le gendarme Mongeau, de la brigade d’Hiersac (Charente), qui servait à titre de volontaire dans un détachement prévôtal de liaison d’une division britannique formée en France, près de la frontière belge, narre ainsi son aventure :
« Incorporés à l’état-major avec des policiers britanniques, nous étions à peine organisés au moment de l’attaque de l’aviation allemande en Belgique. Nous sommes allés en avant vers le centre de la Belgique où nous avons été bombardés et complètement disloqués avant d’avoir pu organiser notre défense. Nous étions pris dans la foule des réfugiés qui venaient vers la France. L’ordre est venu de nous replier sur Dunkerque. Notre embarquement s’est fait sur la plage de Braysune avec des chaloupes de sauvetage récupérées sur des bateaux coulés. Le chenal était garni de mines magnétiques. Il était impossible d’utiliser des moyens métalliques. En Angleterre, j’ai été dirigé avec quatre autres gendarmes venant de diverses unités vers un camp près de Londres. Le général de Gaulle avait commencé son recrutement, mais on nous a dit que les gendarmes seraient plus utiles en France et nous avons été dirigés directement vers Brest où nous devions rejoindre un regroupement de troupes anglaises qui n’existait pas au lieu indiqué. Et nous avons été livrés à nous-mêmes. La France était occupée partout. Un commerçant nous a prêté sa voiture pour nous rendre chacun dans notre brigade. J’ai été déposé à Angoulême où mon commandant de brigade est venu me récupérer. »
Après avoir assuré la réussite de la mobilisation générale, la Gendarmerie a montré au combat, comme elle l’avait déjà fait dans le passé, que le caractère militaire dont elle s’est toujours prévalue n’était pas usurpé. De même que leurs aînés au cours de la grande guerre, les prévôts ont rempli leurs missions sans défaillance. Comme lui en faisait obligation la loi du 13 juillet 1937, la G.R.M. a encadré les formations mobilisées. Le sentiment d’infériorité qu’elle ressentait vis-à-vis des autres armes, en qualité de nouvelle venue, a rapidement disparu. Ses personnels ont courageusement subi l’épreuve du feu.
Ces quelques motifs de satisfaction, aussi légitimes soient-ils, ne peuvent faire oublier les conséquences désastreuses de la guerre dont les effets atteignent la Gendarmerie.
CHAPITRE 2 – LA DÉSORGANISATION
Après une guerre éclair de six semaines, l’ennemi règne en maître sur la capitale et étend son emprise sur 21 000 communes qui couvrent 40 des 87 départements métropolitains. La menace de pillage guette notre économie touchée de plein fouet par le désastre. Dans leur majorité, les Français cèdent à la résignation.
La Gendarmerie ne sort pas indemne des hostilités. Dans la plus grande partie des territoires occupés, par suite de l’éclatement de son dispositif, elle ne dispose plus des moyens nécessaires pour remplir ses missions.
La G.R.M. est complètement disloquée. Le processus débute fin août 1939 avec l’évacuation de toutes les casernes qu’elle occupe à proximité de la frontière franco-allemande. Il se poursuit par le détachement aux armées de cadres et d’unités constituées. Il s’achève à partir de la mi-juin 1940 avec le reflux vers le sud des formations en provenance de la zone des combats. Aucune organisation ne préside à ce mouvement effectué sous la pression de l’ennemi. Toute coordination s’avère impossible. Les personnels détachés à l’encadrement des unités du corps de bataille suivent le sort des militaires. Au flot des réfugiés qui déferle sur les routes de l’exode se mêlent des isolés et des petits éléments de la G.R.M. ayant perdu le contact avec leurs unités de rattachement.
À la signature de l’armistice, seules quelques formations de la G.R.M. sont encore présentes dans leur garnison en zone occupée. Les unes parce qu’elles ont reçu l’ordre de ne pas se replier, c’est le cas des 21e, 22e et 23e légions implantées dans la région parisienne, du groupe spécial de Satory ou encore de compagnies, de la 5e légion, chargées de rester sur le terrain après le départ des unités de l’armée de Terre pour assurer l’ordre et empêcher tout acte de pillage. Les autres parce qu’elles n’ont pu quitter leurs lieux d’emploi ou les positions qu’elles occupaient, surprises par l’avance des troupes allemandes.
Dès la fin juin 1940, les légions de G.D. de la zone sud rassemblent les éléments épars de la G.R.M. repliés et forment des pelotons.
L’état de désorganisation de la gendarmerie départementale, s’il ne prend pas les mêmes formes que celui de la G.R.M., n’en est pas moins grave.
Sur décision gouvernementale, à partir du 12 mai 1940, les légions de G.D. se retirent de toutes les zones où pénètre l’ennemi. Totalement improvisé, leur retrait se déroule dans la confusion. À la réception de l’ordre de décrochage, les gendarmes, en raison de la proximité de l’ennemi, ne disposent que de courts délais pour se préparer. Les instructions, très laconiques, se limitent à l’indication d’un point de destination et à quelques consignes particulières. Ils doivent emporter l’armement, les munitions, les archives courantes et incinérer les documents confidentiels. Le sort des familles n’est même pas évoqué. Pour le transport, les ordres prévoient le recours à la réquisition, ce qui explique l’utilisation de moyens hétéroclites : voitures légères, camionnettes, camions, motocyclettes, sides-car. Toutes les brigades n’utilisent pas la voie terrestre. Quelques-unes empruntent le réseau ferroviaire. On verra même des gendarmes en provenance des départements du Nord et du Pas-de-Calais arriver à Brest et à Cherbourg par voie maritime.
Les brigades reçoivent l’ordre d’emmener à leur suite les jeunes gens âgés de 18 à 21 ans, les hommes mobilisables jusqu’à 48 ans qui n’ont pas été rappelés sous les drapeaux, les gardes territoriaux, là où ils ont été mis sur pied, à condition qu’ils soient armés et dotés d’un uniforme. Les sections non équipées, c’est le cas le plus général, sont dissoutes.
Les unités partent sur des itinéraires encombrés où les embûches se succèdent : mitraillages de l’aviation, propagation de rumeurs alarmistes, accidents de la circulation, difficultés de ravitaillements, etc.
Les conditions du repli des brigades, en 1940, ne ressemblent en rien à celles de la Première Guerre mondiale. En 1914, elles sont regroupées au plus près de leurs circonscriptions puis organisées en détachements de circonstance (escadrons à cheval, compagnies à pied, pelotons cyclistes) en vue d’exécuter, dans des secteurs qu’elles connaissent, des missions au profit des armées : escortes de convois d’artillerie, protection d’ouvrages d’art, surveillance aux avant-postes, police militaire, en arrière et sur le flanc des troupes, en complément des prévôtés. Au contraire, en 1940, le commandement les envoie à plusieurs centaines de kilomètres de leurs garnisons où elles renforcent les unités de gendarmerie départementale.
Le repli de la G.D. génère de sérieuses difficultés. La compagnie des Ardennes est une des premières à recevoir l’ordre de mouvement le 12 mai, au moment de l’attaque allemande sur la Meuse. Dans la soirée, les brigades se dirigent vers Rethel où s’effectue un regroupement partiel. Lorsqu’elles y arrivent, au petit matin, le 13 mai, les bombardements de l’aviation allemande font rage depuis 24 heures. Un incident retarde le départ du chef d’escadron Thiébault commandant la compagnie, du capitaine commandant la section de Rethel et de plusieurs gendarmes. La population vient leur livrer l’équipage d’un chasseur allemand abattu par la D.C.A. Profitant d’une accalmie, des civils réfugiés dans les caves de la caserne, pendant les attaques aériennes, se précipitent sur les aviateurs pour les molester. Les gendarmes s’interposent. Finalement, ils ne pourront s’éloigner de la ville que dans l’après-midi. Ils amènent avec eux les deux prisonniers pour les remettre ultérieurement aux autorités militaires. Après avoir atteint le gîte d’étape de Montcornet (Aisne), toutes les brigades prennent le cap du midi de la France.
Un an plus tard, l’affaire des aviateurs rebondit. Le chef d’escadron Thiébault, admis à la retraite en août 1940, se retire à Paris. Au mois d’août 1941, il reçoit une lettre de son successeur à Charleville-Mézières. Celui-ci l’informe que les Allemands viennent d’arrêter le commandant de section de Rethel et l’adjudant commandant la brigade. On leur reproche d’avoir infligé de mauvais traitements aux prisonniers capturés le 13 mai. Quelques jours après, un officier de la Garde républicaine le prévient que la Police allemande le recherche pour les mêmes faits. N’ayant rien à se reprocher, il ne se dérobe pas à ses responsabilités. La Gestapo l’interpelle à son domicile et le conduit dans ses bureaux rue Récamier. Incarcéré à la prison de la Santé, les Allemands le jugent le 5 novembre 1941. Ils le condamnent à deux ans de prison, puis le transfèrent en Allemagne le 10 novembre. Détenu dans les geôles de Rheinbach, Sarrebrück et Deux-Ponts, il ne recouvre la liberté que le 6 novembre 1943.
Les compagnies du Nord et du Pas-de-Calais commencent leur retraite le 15 mai 1940 pour rejoindre Le Mans où les attend un officier de la sous-direction chargé de leur fixer un point de destination définitif.
À Paris, déclarée ville ouverte, l’évacuation des gendarmes départementaux débute le 13 juin, la veille de l’arrivée des troupes allemandes. À bord de camions et de voitures légères, ils gagnent Tours, franchissent la Loire en vue de rejoindre Bordeaux où, leur a-t-on dit, ils sont susceptibles d’embarquer pour l’Afrique du Nord. En cours de route, ils reçoivent l’ordre de changer d’itinéraire et de rejoindre le département de l’Allier.
Pour assurer l’ordre public et prévenir toute manifestation d’hostilité de la population parisienne à l’égard de l’armée allemande, sur le point d’investir la capitale, le Gouvernement laisse sur place les 3 légions de G.R.M. qui y sont en garnison, la Garde républicaine de Paris et le groupe spécial de Satory. À propos de cette décision qui dérogeait aux instructions antérieures, le général Martin écrit :
« Il n’y a pas eu un seul courageux, civil ou militaire, qui ait osé envoyer par écrit cet ordre au général Gest commandant la Gendarmerie de la région de Paris et le signer. Tout s’est fait verbalement. Ce n’est que sur l’insistance renouvelée du général Gest que l’état-major du général Dentz, gouverneur militaire, qui n’était pour rien dans la rédaction ni la transmission de l’ordre, a adressé, après le 14 juin, un message téléphoné confirmant l’ordre de rester… »
Le 14 juin, débute l’odyssée vers le sud-ouest des quelque 170 brigades de la légion d’Alsace-Lorraine. Personne n’imagine alors que commence pour elles un exil de quatre ans. L’ordre de départ parvient aux unités dans la soirée du 13. La menace que font planer les combats qui se rapprochent est telle qu’il n’est pas question d’organiser un regroupement des sections et des compagnies. En quelques heures, tout est prêt. À l’initiative de leurs chefs, les différentes formations choisissent l’itinéraire le plus direct pour rallier Dijon lieu de rassemblement imposé par la légion. La gravité de la situation incite quelques familles à se joindre aux convois où s’intègrent, aux côtés des gendarmes, jeunes gens, hommes mobilisables, gardes territoriaux.
La nécessité s’impose rapidement d’éviter Dijon sur le point de tomber aux mains des Allemands. À la faveur de regroupements fortuits, des colonnes se forment qui vont connaître des fortunes diverses. L’une d’elle, comprenant la prévôté du 41e corps d’armée, des isolés de la légion d’Alsace-Lorraine, les compagnies du Doubs et de la Meuse ainsi que 2 pelotons de la G.R.M. de Stenay, se retrouve à Maiche le 17 juin. Dans la matinée du 20, elle gagne Soulay en territoire helvétique. Une autre, ayant à sa tête le commandant de légion, composée des compagnies du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, termine son périple le 21 juin à Toulouse. Une troisième atteint Albi (Tarn) le jour de la signature de l’armistice le 22 juin. Le lendemain, un dernier détachement où l’on trouve la compagnie de la Moselle et les services administratifs de la légion arrive à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
L’évolution de la situation politique, à la mi-juin, a une incidence sur le repli des services de l’État. Le 16, le maréchal Pétain constitue un nouveau Gouvernement. L’idée d’armistice a fait son chemin. Les démarches entreprises aux fins de savoir si les Allemands y sont favorables s’avèrent positives. Dès lors, le général Weygand, nouveau commandant en chef, successeur de Gamelin limogé, reconsidère l’ordre de repli donné au début des hostilités. Par télégramme n° 116585/4F.T.P. du 16 juin, il prescrit « à tous les organismes régionaux concourant au ravitaillement, à la Police, à la Gendarmerie de rester à leur poste et d’assurer leur mission même s’ils doivent tomber aux mains de l’ennemi. » Quarante-huit heures après, Charles Pomaret, ministre de l’Intérieur, en termes très fermes, donne des instructions analogues à tous les préfets : « Interdiction formelle à toute autorité civile ou militaire de se replier. Toute infraction à cet ordre entraînera comparution devant un tribunal militaire. »
À partir du 16 juin, les unités de gendarmerie départementale et de G.R.M., situées dans les zones de combat, qui n’ont pas commencé à se replier, restent sur place. Impuissants, la rage au cœur, les gendarmes assistent au déferlement victorieux de l’armée allemande.
* *
*
Le transfert de la sous-direction dans le Massif Central, pendant la période cruciale de la bataille de France, perturbe également le fonctionnement de la Gendarmerie. Alors que les combats se rapprochent de la capitale, le Gouvernement, pour conserver sa liberté d’action, décide le 10 juin de s’installer en province. Après un bref séjour dans la région de Tours, il se rend à Bordeaux d’où il pourra éventuellement gagner l’Empire pour continuer la lutte. Les ministères, à sa suite, rejoignent le sud-ouest.
La sous-direction doit effectuer le déplacement en liaison avec l’échelon lourd du département de la Guerre. La réquisition des véhicules et du carburant nécessaires au transport, le chargement du matériel et des archives dans les camions n’excèdent pas 24 heures. Le 13 juin, le convoi s’ébranle, directeur en tête, en direction de Blois. Au cours du trajet, quelques motocyclistes appartenant à des compagnies de l’est faisant mouvement vers le sud se joignent à lui. Des bords du Cher, terme de la première étape, les gendarmes se dirigent vers le camp de la Courtine. Ils y séjournent quelques jours, en attendant des instructions de l’état-major de l’armée. Vers le 20, départ pour le Périgord envahi par des milliers de réfugiés et de soldats. Les divisions qui ont échappé à la destruction ou à la capture se redéploient dans la région. Le détachement de la sous-direction arrive à Ribérac (Dordogne) petite agglomération qui compte à l’époque 3 000 habitants. Il y stationne plusieurs jours.
Profitant de ce répit, le directeur de la Gendarmerie se rend à Bordeaux pour effectuer une liaison auprès du ministère de la Défense nationale. Il redoute que les Allemands, dans l’éventualité d’un armistice dont on parle de plus en plus, ne considèrent la Gendarmerie comme une force combattante et la traitent en tant que telle. Il estime indispensable que l’on n’affirme pas au grand jour son caractère militaire. Aussi propose-t-il au ministère, qui élabore un projet de réorganisation de l’armée, que la Gendarmerie ne dépende plus directement de l’état-major de l’armée mais soit rattachée à la direction générale de l’administration de la guerre et du contrôle. Cet organisme doit avoir sous sa coupe l’ensemble des services. En la démarquant des forces traditionnelles, on diminuerait le risque de démantèlement qui la guettait. Le ministre se range à sa proposition.
Le 21 juin, la sous-direction reçoit l’ordre de rallier Montauban. Moins de 48 heures après, un détachement de la Wehrmacht occupe Vanxaine, village voisin de Ribérac.
Comme le Gouvernement, le ministère de la Guerre s’installe en Auvergne, à Clermont-Ferrand et dans sa région. Vers la mi-juillet, la sous-direction quitte le département du Tarn-et-Garonne pour le Massif Central. Les services du logement lui trouvent des locaux au château de Romagnat, vieille demeure inhabitée depuis des années. Dans les mois qui suivent, elle se desserre sur Chamalières et Vichy pour un séjour qui ne s’achèvera qu’en août 1944.
Le 4 juillet 1940, le Gouvernement met fin aux fonctions de M. Léonard. Il désigne pour le remplacer M. Chasserat issu, comme son prédécesseur, du Conseil d’État. Le directeur de la Gendarmerie, pendant 10 mois, n’a pourtant pas démérité. Il paye le prix de sa collaboration avec l’ancien président du Conseil, voué aux gémonies par les nouvelles instances du pouvoir.
* *
*
Les pertes subies par la Gendarmerie, durant les combats (377 tués, un millier de blessés, 5 000 prisonniers), donnent un aperçu de l’ampleur du mal qui la frappe. Elles affaiblissent son potentiel humain et par voie de conséquence sa capacité opérationnelle à un moment où, plus que jamais, elle a besoin de la totalité de ses ressources. Or le recrutement est interrompu depuis la déclaration de guerre. Sa reprise, dans l’immédiat, n’est guère envisageable. Les centres d’instruction de la G.R.M. ne sont plus en état de fonctionner en zone nord. Rien n’indique que les Allemands vont autoriser la réouverture de l’école d’application de Versailles où sont formés les officiers. Le recomplètement des effectifs, à court et moyen terme, paraît sérieusement compromis.
Il n’y a plus un seul gendarme dans 26 départements qui, avant les hostilités, en comptaient plus de 9 000 répartis dans 9 légions. Les préfets, dans les territoires occupés, ne peuvent plus s’appuyer pour maintenir l’ordre sur les légions de G.R.M., la plupart dispersées en zone sud.
Si le repli des unités n’engendre pas une crise grave du moral, il n’en est pas moins ressenti douloureusement par les personnels. Une légitime inquiétude naît de l’incertitude de l’avenir qu’avivent la séparation familiale et les conditions précaires d’installation.
Les dispositions de la convention d’armistice aggravent la désorganisation. La ligne de démarcation provoque une fracture dans l’organisation territoriale en coupant littéralement les 5 légions qui la chevauchent (5e, 7e, 8e, 9e et 18e). Le régime de circulation très strict instauré par les Allemands pour franchir la ligne s’impose aux gendarmes. Il nécessite un remodelage de l’assiette des circonscriptions.
L’interruption des liaisons téléphoniques interzone et les conditions draconiennes d’acheminement du courrier gênent l’exercice du commandement.
D’une manière générale, le retrait des unités de Gendarmerie provoque des réactions défavorables. Représentants du Gouvernement, élus, population, tous le déplorent.
En Moselle, le préfet Bourrat ne dissimule pas sa déception lorsque le 13 juin, le chef d’escadron Valty, commandant la compagnie, lui annonce qu’il vient de recevoir l’ordre de se rendre à Charolles (Saône-et-Loire) avec toutes ses brigades. Avec le départ de la Gendarmerie sur laquelle il comptait pour maintenir l’ordre, empêcher les pillages, veiller à l’écoulement du trafic sur les routes encombrées, le voilà brutalement dépourvu de moyens d’autant que l’armée a commencé la longue marche qui va la conduire jusqu’aux collines du Morvan.
Jean Moulin, en poste à la préfecture de Chartres, se plaint également de l’absence des gendarmes :
« Ceux qui, autour de moi, indique-t-il, ont fait la guerre de 1914 se souviennent du zèle manifesté par les gendarmes aux armées ! Ont-ils pu nous empoisonner, bon Dieu, ces gendarmes à l’arrivée du froid ! Et aujourd’hui, que nous aurions réellement besoin d’eux, c’est en vain que nous les attendons. Nous n’en verrons du reste pas un seul pendant les trois jours qui suivront le départ de la compagnie de Chartres, le 13 juin et qui précéderont l’arrivée des Allemands. »
Dans le Loiret, un maire exaspéré signale au préfet les exactions commises impunément dans les maisons abandonnées par leurs occupants : « Les réfugiés ont tué les poules, les lapins, emporté les boissons et maints objets de literie. Ce pillage était impossible à arrêter sans danger. Aucune police n’était possible et le départ des gendarmes a été une impardonnable erreur. »
Quelques préfets recourent à des fonctionnaires de police ou à des gendarmes retraités pour veiller à la sécurité publique. Cette police auxiliaire, malgré toute sa bonne volonté, ne suffit pas pour faire régner l’ordre.
Les gendarmes, présents dans leurs circonscriptions, auraient-ils pu empêcher ces méfaits ? Il est permis de le penser si l’on s’en tient à la relation faite par le commandant de la compagnie des Côtes-du-Nord dans le rapport établi le 20 décembre 1940 :
« Les gendarmes sont demeurés à leur poste au moment où les troupes s’évacuaient en désordre. Ils se sont ingéniés à protéger les populations et leurs biens et se sont imposés, dès la première heure, vis-à-vis des troupes d’occupation […] Au moment de la désorganisation générale des services, il est encore une fois apparu que la Gendarmerie survit à tous les régimes et demeure l’institution à qui toutes les administrations s’adressent quand il s’agit de reconstruire ou tout simplement de mettre de l’ordre dans les divers rouages de la vie publique… »
Enfin, dans les campagnes, les populations ont le sentiment que les pouvoirs publics, en décidant d’éloigner les gendarmes, les ont abandonnées à leur sort. En 1952, le général Martin, évoquant cette décision, désapprouve ceux qui l’ont initiée :
« On ne sait, écrit-il, dans quelle tête a pu germer l’idée d’ordonner le repli de la Gendarmerie, la seule protection de nos campagnes, leur seule sauvegarde. »
Au début de l’été 1940, l’avenir de la Gendarmerie, dans les territoires occupés, est bien sombre. Pourtant, les difficultés de l’heure ne sont en rien comparables aux maux qui attendent l’institution dans les mois à venir.
La convention d’armistice franco-allemande, signée à Rethondes, le 22 juin 1940, n’apporte aucun élément d’information sur les intentions de l’occupant à l’égard de la Gendarmerie. L’article 4 prévoit seulement « le désarmement des forces armées françaises, sur terre, sur mer et dans les airs, à l’exception des troupes nécessaires au maintien de l’ordre. »
II – RÉORGANISATION EN ZONE OCCUPÉE
CHAPITRE 3 – L’INCERTITUDE
Quel sort les autorités d’occupation lui réserveront-elle ? Sera-t-elle dissoute ? Modifiera-t-on simplement son statut ? Ou bien sera-t-elle subordonnée aux forces de sécurité du Reich ? Ces questions restent sans réponse dans l’attente de la réunion, à Wiesbaden, de la commission allemande d’armistice.
Dans les régions conquises, les Allemands adoptent des attitudes très variables envers la Gendarmerie. Au fur et à mesure de leur avance, ils s’emparent des édifices publics : postes, mairies, sous-préfectures et casernes de Gendarmerie. Lorsque ces dernières sont désertes, dans les départements où les gendarmes se sont repliés, ils y installent parfois des organes de commandement. Si leurs locataires sont présents, ils n’hésitent pas à les expulser.
La façon dont ils considèrent les gendarmes change d’un endroit à l’autre. Ici, ils les arrêtent et les envoient dans des camps de prisonniers. Là, ils les tolèrent et les laissent en liberté. Certaines autorités allemandes locales interdisent aux gendarmes l’exécution de tout service, d’autres ne s’y opposent pas. Toujours, elles sont extrêmement fermes au sujet de l’armement et n’autorisent la détention, dans le meilleur des cas, que d’une arme de poing par militaire.
Par suite de la rupture des communications et des difficultés de liaisons avec le commandement supérieur, les échelons d’exécution, en l’absence de toute directive, prennent l’initiative de contacts avec leurs homologues allemands en vue d’instaurer un modus vivendi qui leur permette de poursuivre l’accomplissement de leurs missions.
Dans la région parisienne où le commandement des forces militaires en France se met en place, à partir du 14 juin 1940, la situation de la Gendarmerie est comparable à celle que l’on observe dans le reste des territoires occupés.
Le 14 juin à 5 h 30, la Wehrmacht entre dans Paris désertée par ses habitants. Commencent alors le quadrillage de l’agglomération, l’occupation des points stratégiques et des casernes pour loger les troupes. Les grands ensembles de la Gendarmerie, dans plusieurs secteurs, n’échappent pas à la réquisition. Un détachement s’installe dans le sous-sol de la caserne Prince-Eugène, de la Garde républicaine de Paris, qui abrite le poste de commandement de la défense aérienne de la région. L’occupation des casernes de la 22e légion de G.R.M. à Drancy, Blanc-Mesnil, Dugny, Pont-Yblon, évacuées la veille par les unités et la plupart des familles, accentue l’incertitude de l’avenir. Le 15 juin, pourtant, les escadrons de Pont-Yblon et de Blanc-Mesnil réintègrent leurs quartiers.
Quant aux 800 gardes de Drancy regroupés à la caserne de Clignancourt, ils y restent 5 jours en plein milieu des troupes allemandes qui s’emparent de leurs armes, de leurs véhicules et de matériels divers.
Le 19 juin, la brigade mixte donne l’ordre aux commandants de groupe de se reloger par leurs propres moyens. Le colonel Ruel, commandant la Garde républicaine de Paris, auquel ils s’adressent pour être hébergés n’entend pas les accueillir. Il craint que la Garde ne soit compromise et subisse des mesures de rétorsions de la part des Allemands. La G.R.M. ne vient-elle pas de participer à des opérations militaires ?
Un groupe s’installe dans les écuries de la caserne de Noisy. L’autre campe dans la cour de la caserne Prince-Eugène, grâce à la compréhension du chef d’escadron Vérines. Ce dernier le prend même en subsistance sans s’inquiéter des réactions possibles du colonel Ruel.
Les commandants de groupe obtiennent des autorités allemandes, le 15 juillet, l’autorisation de réoccuper une partie des installations de Drancy, reconverties pour les trois-quart en camp de prisonniers de guerre.
Les légions de Montrouge (21e) et Courbevoie (23e) subissent les mêmes avatars que celle de Drancy (22e).
L’ennemi, comme en province, réagit différemment envers les gendarmes en service. À plusieurs reprises, au cours de la journée du 14 juin, il désarme des G.R.M. en patrouille dans les artères de la capitale alors qu’il en laisse d’autres poursuivre leur mission. Il neutralise et consigne avec son colonel, dans la caserne de Clignancourt, tout un groupe de la 23e légion. Place de l’Étoile, la Wehrmacht encercle le groupe du chef d’escadron Hamel, du Plessis-Robinson, qui faisait mouvement avec ses véhicules pour sortir de Paris. Elle s’empare des armes, puis fouille la colonne conduite ensuite dans le bois de Boulogne avant d’être dirigée vers un camp de prisonniers en Allemagne. L’intervention, in extremis, du général Gest sauve les gardes de la captivité. Ils se trouvent déjà à Laon lorsque les autorités allemandes leur rendent la liberté. Dépouillés de leurs véhicules, les hommes du chef d’escadron Hamel rentrent à pied sur Paris.
Un incident d’une autre nature se produit le 15 juin. Une reconnaissance aérienne de la Luftwaffe signale la présence de blindés dans la cour du fort de Montrouge qu’occupe la 21e légion de G.R.M. Il s’agit des engins du bataillon de chars affectés à la mobilisation à la brigade mixte de Gendarmerie. Les autorités allemandes exigent des explications. Tour à tour, des officiers d’état-major, des policiers et des feldgendarmes se rendent sur place pour évaluer l’importance de cet arsenal, effectuer des perquisitions, déterminer l’origine des chars, quels étaient leurs chefs et les troupes qui les servaient. Le représentant du général Gest ne pouvant prétendre qu’il s’agissait de gendarmes ou de gardes affirmait que ce bataillon avait été créé avec des réservistes des chars pour maintenir l’ordre dans la région parisienne, en renfort de la Gendarmerie, qu’il fallait les assimiler à des gendarmes et non à des combattants. Les Allemands, sceptiques, décident en fin de compte de désarmer le bataillon. Dans les heures qui suivent, ils enlèvent tous les chars. Le personnel, rapidement démobilisé, n’est pas inquiété.
Le général Gest, en plein accord avec le préfet Langeron auquel le Gouvernement avant son départ a confié tous les pouvoirs, notamment celui d’assurer l’ordre public, charge son chef d’état-major, le colonel Martin, de trouver un interlocuteur allemand habilité à traiter des questions de la Gendarmerie de Paris. Deux raisons motivent sa démarche. D’abord, l’attitude soupçonneuse des Allemands envers les gendarmes entraîne des incidents auxquels il convient de mettre un terme. Il importe, ensuite, d’obtenir que leur action ne soit pas entravée et qu’ils puissent poursuivre leurs missions dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1903.
Le 15 juillet, le capitaine Baget, de la G.R.P., met le colonel Martin en relation avec un officier allemand, le major Winter, qui entreprend le recensement et la visite des casernes de la région parisienne.
Fier d’être vainqueur, rigide, assez accueillant toutefois, le major Winter indique au colonel Martin que les affaires relatives à la Gendarmerie sont placées dans les attributions de son service, à l’état-major du cercle de Paris. Il l’invite à s’en entretenir avec lui.
Du 18 juin à la mi-août, les deux hommes se voient à peu près tous les jours. Aux problèmes divers soulevés par le colonel Martin, dont le principal est celui du statut organique de la Gendarmerie, la major Winter ne répond jamais nettement. Manifestement, il ne possède aucun pouvoir de décision :
« Le plus gros de son travail, note le colonel Martin, consistait à compter et à recompter nos armes, à en dresser des états, à me faire donner ma parole d’honneur qu’on ne le trompait pas, à se faire expliquer pourquoi la garde mobile avait des boutons et des galons dorés et moi des galons et des boutons blancs, à me demander la description de l’uniforme de notre général. Il trouvait nos effectifs trop élevés… »
Par le canal du préfet de police, Winter utilise la Gendarmerie pour exécuter des services de police de la circulation y compris au profit des troupes d’occupation. Il l’emploie encore pour remplir des missions d’assistance aux réfugiés de retour d’exode : recueil, ravitaillement, hébergement, guidage vers des itinéraires désignés, surveillance du trafic induit par leur arrivée aux alentours de Paris.
À la fin du mois de juin 1940, le colonel Martin obtient l’adresse du prévôt général de la Gendarmerie de campagne, le colonel Perhaus, attaché à l’administration militaire du Gross Paris. Il lui demande une audience. Perhaus le reçoit dans ses services installés au Palais Bourbon. A la question qu’il lui pose de savoir dans quelles conditions allait être régie dorénavant la Gendarmerie, Perhaus n’apporte aucune précision. L’étendue de ses pouvoirs n’est pas aussi large que l’escomptait le colonel Martin. Somme toute, le prévôt général n’a pas plus d’influence que Winter pour décider du sort de la Gendarmerie.
Le colonel Martin, au cours d’un entretien ultérieur, apprend que l’état-major des troupes d’occupation a l’intention de limiter à 10 le nombre de gendarmes par caserne. Cette éventualité faisait peser une menace de dispersion des personnels regroupés dans les quartiers de la G.R.P. et de la G.R.M. qui comportaient, comme à Asnières, Gennevilliers ou Courbevoie, plusieurs centaines d’hommes.
Malgré ce sujet d’inquiétude, la situation de la Gendarmerie de Paris reste en l’état jusqu’au 15 août. Survient alors une décision inattendue. Le prévôt général convoque le colonel Martin pour lui notifier que le Fürher ordonne de dissocier la G.R.P. de la Gendarmerie. Il exige son rattachement au préfet de police dans les 24 heures. Le colonel Martin ne s’estime pas fondé à prendre une décision qui relève de la direction de la Gendarmerie. Perhaus n’admet aucune discussion. Il brandit la menace de la dissolution immédiate de la garde, suivie de l’internement de ses personnels, si l’on ne rompt pas, dans les délais indiqués, les liens administratifs et hiérarchiques qui l’unissent à la Gendarmerie. Le colonel Martin s’incline devant ce diktat.
Dans les jours qui suivent, le général Gest reçoit une injonction du commandant du Gross Paris lui demandant de confirmer avant le 30 août, que « la subordination de la Garde républicaine de Paris est accomplie, que toute influence de l’autorité française antérieure, et plus particulièrement du ministère de la Défense nationale, a été immédiatement écartée […] que l’armement est limité à un chargeur de 9 cartouches et une baïonnette par homme, de rendre compte où et quand, ainsi qu’en quelles quantités les armes, munitions et chargeurs existants, en plus des dotations actuellement prescrites, ont été versées même déjà antérieurement et non seulement sur la base de la lettre du 15 août… »
* *
*
Pendant que les gendarmes, en zone nord, s’efforcent de reprendre une activité normale, le 27 juin, la délégation française constituée pour siéger auprès de la commission allemande d’armistice de Wiesbaden, dirigée par le général Huntziger et l’ambassadeur Léon Noël, quitte Bordeaux pour l’Allemagne. Elle se compose de 65 personnes (36 officiers et 29 civils). Arrivée à Wiesbaden dans la soirée du 28 juin, elle tient sa première réunion dès le 29. Ses travaux débutent effectivement le 30 au matin.
La commission des forces terrestres a dans ses attributions l’examen des questions se rapportant à la Gendarmerie. Or elle ne dispose d’aucun officier suffisamment informé pour les exposer. Conscient de cette lacune, le ministère de la Défense, dans la soirée du 1er juillet, saisit par message téléphoné la sous-direction de la Gendarmerie qui vient à peine d’arriver à Montauban où elle s’installe provisoirement. Il lui prescrit de « désigner un officier qualifié pour s’occuper de la remise en place, en région occupée, de la gendarmerie départementale et de quelques pelotons de « G.R.M. » » Cet officier, précise le texte, « partira demain matin de Montauban pour rejoindre la commission d’armistice, il se présentera au général Koeltz au ministère de la Défense nationale. »
Le contenu de cette instruction permet de penser que le haut-commandement allemand a donné des assurances au Gouvernement français quant au rétablissement de la Gendarmerie en zone occupée mais rien n’indique qu’il a garanti le maintien de son statut antérieur.
Le choix du directeur, M. Léonard, se porte sur un officier de l’état-major particulier, le capitaine Sérignan. Ce dernier, issu de Saint-Cyr, intègre la Gendarmerie en 1928. Indépendamment des commandements qu’il exerce postérieurement à son admission, son appartenance de 1935 à 1939 au bureau technique de la sous-direction, chargé de l’élaboration des règlements et des instructions relatives à l’organisation et au service, lui a permis d’acquérir une solide expérience. D’autres considérations militent en faveur de sa désignation. D’une part, sa connaissance approfondie de la langue allemande qu’il a perfectionnée, en 1930-1931, au centre d’études germaniques de Strasbourg. Pendant son séjour en Alsace, il publie un petit ouvrage intitulé « Le parti hitlérien et sa propagande » dans lequel il ne dissimule pas son antipathie pour le Führer. D’autre part, il a été détaché pendant deux ans, d’octobre 1933 à octobre 1935, au 2e bureau de l’état-major de l’armée, 2 bis avenue de Tourville, à la section centralisation du renseignement (section allemande). Le capitaine Paillole, officier de Gendarmerie comme lui, a pris sa succession le 1er décembre 1935. À la fin de son détachement au service de renseignements, il est affecté à la sous-direction de la Gendarmerie, à Paris, et y reste jusqu’à la déclaration de guerre, le 2 septembre 1939, avant de partir aux armées au Grand Quartier général des forces terrestres (bureau du personnel). Remis à la disposition de la sous-direction le 29 juin 1940, il se trouve à Montauban le 1er juillet.
Dans le courant de la soirée, le colonel Fossier, sous-directeur, l’informe qu’il vient d’être choisi pour représenter la Gendarmerie à la commission d’armistice de Wiesbaden mais que sa désignation ne sera définitive qu’après son acceptation car ses activités antérieures, dans les services de renseignements puis à Strasbourg au centre d’études germaniques, étaient susceptibles de lui faire courir un danger.
À l’heure où le pays a besoin de toutes les énergies, le capitaine Sérignan donne spontanément son accord. Commence alors pour lui ce qui sera « la grande aventure de sa carrière. »
Avant son départ pour Clermont-Ferrand, le commandement lui donne des instructions précises sur son mandat. L’objectif est d’obtenir des Allemands la remise en place, dans les territoires occupés, des formations de Gendarmerie, partout où elles existaient et dans la forme sous laquelle elles existaient.
Outre les brigades, il convient de réinstaller des éléments mobiles constitués en pelotons de gendarmerie mobile afin de fournir aux unités territoriales l’appoint dont elles ont besoin. Avant la guerre, pour pallier l’insuffisance des effectifs de la gendarmerie départementale, des pelotons de la G.R.M. participaient au service journalier des brigades.
Les ordonnances draconiennes édictées par les autorités allemandes limitant les liaisons et les déplacements entre les territoires occupés et la zone libre entravent l’exercice du commandement. La recherche d’un accord pour assouplir la réglementation s’impose d’urgence. Ainsi, la sous-direction de la Gendarmerie et les commandants de légions de G.D. de la zone occupée doivent pouvoir correspondre directement. De leur côté, les officiers de l’état-major particulier doivent être en mesure de se rendre en zone occupée pour y régler sur place toutes les questions se rapportant à l’organisation et aux services des unités de G.D. Il faut aussi accorder des facilités analogues de circulation aux commandants de légion, de compagnie, de section et de brigade dont les circonscriptions sont coupées par la ligne de démarcation.
Concernant l’emploi, on constate que dans les territoires occupés les Allemands ont tendance à mettre la Gendarmerie en action par l’intermédiaire d’une autorité française locale, généralement un préfet ou un sous-préfet, quelquefois par un officier de Gendarmerie.
La sous-direction n’entend pas protester contre cette manière de faire. Cependant, elle insiste auprès de son représentant pour que, dans le cas où une autorité civile est désignée, les Allemands ne l’investissent pas, en même temps, de droits différents de ceux que la loi française lui confère dans ses rapports avec la Gendarmerie.
En matière de service, la sous-direction considère qu’il est indispensable que l’occupant permette aux militaires de la Gendarmerie d’exécuter leurs missions dans les mêmes conditions que celles du temps de paix. Il y a, enfin, urgence à libérer toutes les casernes et à rapatrier les gendarmes prisonniers.
Le représentant de la Gendarmerie quitte Montauban pour Clermont-Ferrand dans la matinée du 2 juillet. Dès son arrivée, il se présente à la direction des services de l’armistice créée fin juin par le général Weygand, ministre de la Défense nationale, et placée sous les ordres du général Koeltz dont les connaissances des questions allemandes faisaient autorité. Le général lui accorde une brève entrevue.
Le 3 juillet, l’officier part pour Bourges où, selon les ordres reçus, il doit rencontrer des délégués allemands de la commission d’armistice. Dans les divers bureaux où il se présente, on ignore tout sur la question qui l’amène. Ses interlocuteurs l’invitent à se mettre en rapport avec le commandement de forces militaires en France installé à Paris.
Tout aussi décevante, l’étape parisienne l’oblige, le 4 juillet, à se rendre dans plusieurs services pour s’entendre dire finalement que les délégués allemands se trouvent à Wiesbaden.
Après l’invraisemblable périple qui le conduit de Montauban à Bourges, puis à Paris, il arrive à destination, en Allemagne, le 5 juillet à midi trente.
Ses allées et venues en zone occupée, aussi regrettables soient-elles, lui donnent l’occasion de procéder à d’utiles observations, sur la situation des gendarmes, qui complètent son information.
Pendant la durée de sa mission, du 5 au 17 juillet 1940, le capitaine Sérignan ne trouve pas, auprès des militaires de la délégation française, la compréhension qu’il était en droit d’attendre d’eux. Ils lui réservent un accueil peu amène et le traitent avec désinvolture.
À son arrivée, le représentant de la Gendarmerie se présente au lieutenant-colonel C…, sous-chef d’état-major du général Huntziger. Quelle n’est pas sa surprise lorsque ce dernier lui annonce que le lieu de sa mission est Paris. Elle atteint son comble quand il lui signifie qu’il doit reprendre le chemin de la capitale. Un convoi routier s’apprête d’ailleurs à partir pour la France dès 13 heures.
Pour l’officier de Gendarmerie, il est hors de question de revenir à Paris avant d’avoir rempli son mandat auprès de la commission d’armistice. À ce stade de l’entretien, le sous-chef d’état-major présente le capitaine Sérignan au colonel L…, chef d’état-major du général Huntziger, qui se range aux arguments que vient de développer l’officier de Gendarmerie. Il admet qu’on ne peut le faire repartir aussi brusquement.
Le lieutenant-colonel H…, président de la sous-commission des forces terrestres, est chargé de faire immédiatement le point avec le capitaine Sérignan. Il accueille celui-ci avec condescendance et semble peu disposé à l’écouter. Agacé par les questions évoquées se rapportant à la Gendarmerie ainsi que par les instructions données par la direction, il interrompt sèchement le capitaine Sérignan en disant que « la direction n’était rien et que l’état-major était tout. »
Vers 13 heures, le président de la sous-commission des forces terrestres, qui n’est pas sans ignorer les instructions de la direction des services de l’armistice relatives au détachement d’un officier de Gendarmerie auprès de la délégation française, invite son interlocuteur à rédiger, sur le champ, une note sur la remise en place de la Gendarmerie dans les territoires occupés.
Sans désemparer, le capitaine Sérignan se met au travail. Il consigne, dans une courte synthèse, les arguments en faveur du retour de la Gendarmerie en zone occupée dans ses garnisons du temps de paix. Des impératifs d’ordre public justifient une telle mesure. Le rapatriement, dans ses foyers, d’une population ébranlée par la guerre et placée dans des conditions de vie rendues difficiles par le bouleversement de la situation économique, risque de faciliter des mouvements sociaux. Outre la sécurité des populations, il faut préserver les biens (maisons évacuées notamment) des personnes dont le retour serait différé et surtout apporter, aux autorités locales, les concours nécessaires pour exercer l’administration du pays. Le retour prochain des démobilisés, dans leurs foyers, est de nature à aggraver les difficultés. Dans un milieu aussi sensible, l’absence d’un élément d’ordre ne saurait se prolonger. La réinstallation de la gendarmerie départementale constitue donc une priorité.
Encore insiste-t-il sur le fait que ses effectifs ne lui permettraient de répondre uniquement qu’aux besoins du maintien de l’ordre en période normale. En cas de troubles, ils seraient insuffisants. En considération des charges qui vont peser sur la Gendarmerie on ne doit pas se borner à réinstaller les brigades. Il est indispensable d’établir, en zone occupée, conjointement aux unités territoriales, des pelotons mobiles pour qu’elle puisse, en toutes circonstances, continuer à remplir l’intégralité de ses missions.
Enfin, le retour dans leur résidence normale des formations repliées aurait l’avantage, en donnant aux populations une impression d’ordre et de sécurité, d’inciter les réfugiés à regagner leurs domiciles, ce qui ne pouvait qu’accélérer la reprise, éminemment souhaitable, de la vie économique du pays.
Le 5 juillet, en fin d’après-midi, le capitaine Sérignan donne en main propre, au président de la sous-commission des forces terrestres, l’argumentaire demandé. Le lieutenant-colonel H… en conteste d’emblée le bien-fondé.
Pourtant, le général Huntziger, dans la note qu’il adresse le 6 juillet au général Von Stulpnagel, président de la commission allemande d’armistice, à propos du rapatriement de la gendarmerie départementale, reprend intégralement les arguments développés par le représentant de la Gendarmerie.
Dans l’hypothèse où les Allemands accepteraient les propositions de la délégation française, il fallait leur soumettre les modalités d’exécution de ce retour. Dans cette perspective, le lieutenant-colonel H… enjoint au capitaine Sérignan de préciser par écrit les intentions de sa direction. Dès le 7 juillet, il fournit les éléments de réponse.
Avant que la commission des forces terrestres ne saisissent la commission allemande d’armistice à propos des conditions de réinstallation de la Gendarmerie, le général Stulpnagel fait connaître le 8 juillet, à la délégation française, que la question de la remise en place de la Gendarmerie dans les territoires occupés incombe au chef de l’administration militaire en France.
La commission des forces terrestres informe immédiatement par message la direction des services de l’armistice, à Clermont-Ferrand, et prend position sur la composition de la représentation de la Gendarmerie. Estimant que le capitaine Sérignan ne possède pas, de par son grade, une autorité suffisante pour s’acquitter seul de cette mission, elle suggère de la confier à un officier supérieur qualifié tel que le colonel Martin en poste à Paris. En revanche, pour le chef de la commission des forces terrestres, rien ne s’oppose à ce que le capitaine Sérignan assume les fonctions d’adjoint.
Quelques jours après, la direction de la Gendarmerie, par le truchement des services de l’armistice, communique à la délégation française le nom de l’officier supérieur désigné pour négocier avec l’administration militaire à Paris. Il s’agit du colonel Mahé qui sera secondé par le capitaine Sérignan.
Le 10 juillet, le président de la sous-commission des forces terrestres annonce au capitaine Sérignan, sans lui fournir la moindre explication, qu’il va le mettre en route vers Paris. Cette décision appelle de la part du représentant de la Gendarmerie des interrogations sur ses nouvelles fonctions ainsi que sur la nature et la localisation de l’organisme allemand avec lequel il doit se mettre en rapport. Toutes restent sans réponse.
L’ordre du jour de la commission des forces terrestres prévoit l’examen de la situation de la G.R.M., entre le 10 et le 15 juillet. Se priver, dans ces conditions, du concours du capitaine Sérignan, serait inopportun estiment les officiers de l’entourage du lieutenant-colonel H… Ce dernier, reconsidérant sa position, se range certes à leur avis. En fait, il n’associera jamais l’officier aux travaux de la commission.
Lorsqu’on l’informe que l’autorité allemande chargée de traiter toutes les questions se rapportant à la Gendarmerie se trouve à Paris, à l’hôtel Majestic, le capitaine Sérignan considère que sa mission à Wiesbaden est terminée.
Avant son départ, fixé au 17 juillet à 5 heures, il se renseigne auprès du général Baures pour savoir quel allait être le sort de la G.R.M. Il apprend que le général Huntziger s’efforce de ne pas l’inclure dans les 100 000 hommes tolérés par l’occupant pour constituer l’armée d’armistice. La commission allemande n’a pas encore statué sur ce point. Quelques jours plus tard, elle annonce que la G.R.M. fera partie de l’armée d’armistice. Dès lors, la séparation de la G.R.M. et de la Gendarmerie est inévitable.
Moins d’un mois après son départ de Montauban pour l’Allemagne, le 17 juillet dans la soirée, le capitaine Sérignan foule à nouveau le sol français. Aux côtés du colonel Mahé, dans une structure qui n’existe pas encore, à créer de toutes pièces, il va devoir continuer la tâche entamée à Wiesbaden pour régler avec les autorités allemandes, directement cette fois, les modalités de réinstallation de la Gendarmerie en zone occupée.
Le 18 juillet 1940, la direction des services de l’armistice crée à Paris une délégation pour la Gendarmerie de la commission de Wiesbaden du même type que celles constituées pour traiter les problèmes spécifiques des transports, des communications ou des réfugiés.
Née des circonstances, la délégation pour la Gendarmerie, mise sur pied avec des moyens limités, comprend à l’origine deux officiers et quelques sous-officiers secrétaires. Son chef, le colonel Mahé, commandant la 18e légion de Gendarmerie à Bordeaux, n’a pas encore rejoint sa nouvelle affectation. Au plan matériel, elle ne dispose d’aucune infrastructure.
CHAPITRE 4 – LA SECTION GENDARMERIE DES TERRITOIRES OCCUPÉS
Le cadre dans lequel va s’inscrire son action n’apparaît pas encore distinctement. Le Gouvernement français vient juste d’envoyer une représentation à Paris en cours d’organisation. L’occupant parachève l’installation de son dispositif territorial qu’ignorent les autorités françaises.
Personne ne peut se prononcer sur la durée des discussions que l’on espère brèves. La Gendarmerie n’a-t-elle pas désigné pour diriger sa délégation un officier supérieur qui a atteint, depuis le mois d’avril, la limite d’âge de son grade mais qui, en raison de la guerre, a été maintenu en activité de service pour une durée supplémentaire de 6 mois.
Avant de suivre l’action des plénipotentiaires de la Gendarmerie, examinons comment, au fil des mois, la délégation s’est étoffée pour devenir une structure permanente investie d’attributions diversifiées. Son développement couvre deux périodes.
La première s’étend du 18 juillet 1940 au 2 juin 1942. Sans être subordonnée à la délégation générale du Gouvernement français, elle noue toutefois avec elle des liens étroits.
Ce n’est que le 9 juillet que M. Léon Noël, ancien ambassadeur de France en Pologne, prend ses fonctions à Paris en qualité de délégué général du Gouvernement français auprès de l’administration militaire allemande en France. D’une part, il lui appartient, assisté de hauts fonctionnaires, de suivre toutes les questions techniques posées par l’application de la convention d’armistice, de l’autre, de remettre en ordre et de coordonner l’action d’une administration livrée à elle-même depuis la débâcle.
Le 18 juillet, le capitaine Sérignan se présente à la délégation générale du Gouvernement. Un des collaborateurs de l’ambassadeur, M. Wilhelm, le reçoit. Au cours de la journée, il prend d’autres contacts. D’abord, avec la délégation chargée des transports présidée par le colonel Paquin. Il réserve ensuite une visite au commandement de la Gendarmerie de la région de Paris.
Le 19 juillet, à 10 heures, l’ambassadeur Noël reçoit toutes les délégations. Le capitaine Sérignan représente la Gendarmerie en l’absence du colonel Mahé dont l’arrivée dans la capitale n’est prévue qu’en fin de matinée.
Suivant les ordres qu’il a reçus, le colonel Mahé se rattache à la délégation générale du Gouvernement français. Ce rapprochement répond à des préoccupations d’ordre strictement matériel. Bien que tenus de rendre compte de leurs travaux au délégué général, les gendarmes continuent de dépendre exclusivement de leur sous-direction. Aussi sont-ils absents, comme les autres représentants des différentes délégations de la commission d’armistice, le jour de la présentation de la délégation générale du Gouvernement français aux autorités allemandes.
La délégation pour la Gendarmerie s’installe dans les locaux de la délégation générale, au 127, rue de Grenelle, dans l’hôtel occupé avant la guerre par le ministère du Travail. Elle y dispose de deux bureaux.
Plus que la question du logement, celle des liaisons avec la sous-direction, à Clermont-Ferrand, explique le rattachement avec la délégation générale. Dans ses murs, les gendarmes bénéficient à la fois de la priorité téléphonique et de la possibilité d’acheminer le courrier officiel dans des conditions moins draconiennes que celles réservées aux autres usagers.
Le soutien qu’apporte la délégation générale ne se limite pas aux deux domaines considérés. Les gendarmes ont la faculté de recourir au bureau des traductions ou encore à celui de la présentation des textes de lois, décrets, arrêtés, instructions aux autorités allemandes, enfin à celui des recours en grâce qui, on le verra, sera extrêmement précieux pour venir en aide aux gendarmes condamnés par les Conseils de guerre allemands.
Quelques semaines après son installation, la délégation pour la Gendarmerie adopte l’appellation de « section Gendarmerie de la délégation générale du Gouvernement français. »
Début septembre, les services du délégué général commencent à prendre de l’extension. Les gendarmes sont priés de quitter les lieux. Le ministère du Travail qui s’était réservé trois pièces dans l’immeuble accepte d’en céder deux à la section Gendarmerie. Bien que n’étant plus dans les locaux de la délégation générale, la section Gendarmerie conserve le bénéfice de la priorité téléphonique et des conditions favorables à l’acheminement du courrier. Elle sauvegarde ainsi ses liaisons avec la sous-direction.
Le 7 septembre, le colonel Mahé reprend le commandement de sa légion à Bordeaux. À partir de ce jour, le capitaine Sérignan le remplace à la tête de la section Gendarmerie. À ce titre, il devient le représentant accrédité et permanent de l’Arme auprès du général chef de l’administration militaire en France.
Les attributions de la section Gendarmerie s’élargissent. Dorénavant, elle constitue l’échelon parisien de la sous-direction et sert de trait d’union avec les légions de la zone nord.
Cette évolution impose un remaniement de son dispositif. Quatre officiers renforcent l’effectif initial. La structure de la section s’étoffe avec la création d’un bureau administratif chargé en particulier de préparer, pour l’ensemble de la Gendarmerie, les programmes en matière de produits industriels contingentés et de les répartir entre les deux zones. Commandé par un officier supérieur ce bureau s’articule en deux sections, approvisionnement d’une part, matériel de l’autre, placées respectivement sous la coupe d’un officier subalterne.
En 1941, la délégation générale quitte les locaux du ministère du Travail, trop exigus, pour occuper ceux du ministère de l’Intérieur. Elle y réserve une place pour la Gendarmerie. Rapidement, en raison des nouveaux besoins de la délégation générale, la section Gendarmerie doit déménager pour s’installer rue Cambacérès.
Aux rapports de circonstance que la section Gendarmerie établit avec la délégation générale du Gouvernement français s’ajoutent ceux qu’elle entretient avec le délégué du secrétaire général à la Police, Leguay. Ce haut-fonctionnaire, installé à la direction de la Police nationale, 61, rue de Montceau, dans le 8e, lui répercute les instructions des autorités allemandes et du ministère de l’Intérieur.
Entre juillet 1940 et juin 1942, la section Gendarmerie est principalement en liaison avec l’appareil administratif allemand installé à l’hôtel Majestic, rue Kléber.
Quelle est, en juillet 1940, la structure de l’administration militaire allemande en France ? Les autorités gouvernementales n’en ont qu’une idée très floue comme l’atteste la lettre n° 5614/DSA du 15 septembre 1940 par laquelle le directeur des services de l’armistice à Vichy demande au général de Fornel de la Laurencie, délégué général du Gouvernement français dans les territoires occupés, de poser la question aux autorités allemandes :
« Je crois savoir, écrit le 12 octobre le délégué général, que la réponse des autorités allemandes ne contiendra aucune précision et se contentera d’exposer des généralités : mais j’ai pu, au cours de conversations d’ordre privé, recueillir déjà un ensemble de renseignements intéressants que je résume ci-dessous… »
Avant de brosser, dans ses grandes lignes, un tableau de l’organisation de l’administration militaire allemande, il faut rappeler qu’Hitler a confié aux militaires tous les pouvoirs sur la France occupée (maintien de l’ordre, police, répression). Les services de police allemands installés en France relèvent de l’autorité des militaires, du moins jusqu’en mars 1942.
Le maréchal Von Brauchisch, commandant en chef de l’ensemble des armées allemandes (Q.G. Fontainebleau) exerce son commandement sur le groupe des armées opérant en France. Soulignons l’existence, à Bruxelles, d’un commandement du groupe des armées agissant en Belgique auquel sont rattachés les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Pour administrer les territoires occupés par ses troupes, chaque commandant de groupe d’armée délègue ses pouvoirs à un général qui porte le titre de chef de l’administration militaire.
Pour la période allant du 30 juin au 25 octobre 1940, ce poste est confié au général d’infanterie Alfred Streccius, ancien expert militaire en Chine. Conscient de la nécessité d’un exécutif fort, capable d’assurer l’ordre et la sécurité en territoire occupé, Hitler ordonne son remplacement par le général Otto Von Stulpnagel, militaire énergique, nommé commandant militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF). En février 1942, par suite de divergences avec le haut commandement, il se retire et son cousin, le général Heinrich Von Stulpnagel, lui succède.
Les services du MBF, installés à l’hôtel Majestic, regroupent un effectif pléthorique d’environ 1.100 militaires et civils répartis en deux grands secteurs. D’une part, l’état-major militaire ou de commandement ayant pour chef le lieutenant-colonel Speidel, ancien adjoint à l’attaché militaire à Paris. De l’autre, l’état-major administratif et économique dirigé initialement par Hans Posse auquel succède, en août 1940, le docteur Jonathan Schmidt, ministre de l’Intérieur et de l’Économie de Wurtemberg. La section V Police, de l’état-major administratif, est chargée de l’organisation et du contrôle des services de Police et de Gendarmerie.
Le chef de l’administration militaire transmet ses directives dans les territoires occupés, par l’intermédiaire des commandants de région ou district (Bezirk). Le district de Paris (kommandant Gross Paris) qui a son siège à l’hôtel Meurice inclut jusqu’en mars 1941 les départements de Seine, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise intégrés ensuite à la région nord-ouest. Son chef, le général Turner, a son P.C. au Palais-Bourbon. Le district C (nord-est), P.C. à Dijon, couvre les départements situés au nord de la ligne Brest-Orléans. Le district B (sud-ouest), siège Angers, est limité au nord par la ligne Brest-Orléans. L’état-major du district A (nord-ouest) est installé à Saint-Germain.
Au chef-lieu de chaque département l’administration militaire met en place une Feldkommandantur. Lors de la création des préfectures régionales, en 1941, elle réduit leur nombre qui passe de 46 à 38. Certaines Feldkommandantur couvrent alors deux ou trois départements. Chaque Feldkommandant dispose d’une section administrative qui s’occupe des questions de police et de l’administration départementale en liaison avec le préfet. Au niveau de l’arrondissement le commandement militaire est représenté par la Kreiskommandantur.
De juin 1942 à août 1944, la section Gendarmerie entre dans la seconde phase de son existence. Des changements internes et externes se produisent qui influent sur son activité et ses caractéristiques.
Tout d’abord, la direction de la Gendarmerie élargit les prérogatives du chef de son antenne parisienne. Le capitaine Sérignan, promu chef d’escadron par arrêté du 30 avril 1941, est nommé le 1er juin 1942 sous-directeur de l’organisation, du service spécial, du personnel de la direction générale de la Gendarmerie détaché dans la fonction de chef de la section Gendarmerie à Paris. Ce titre lui donne, au nom du directeur général, autorité sur toutes les formations de la zone nord, quel que soit le grade de leur chef.
La loi du 2 juin 1942 qui place la Gendarmerie sous l’autorité directe du chef du Gouvernement met fin au rattachement de la section Gendarmerie à la délégation générale. Pour marquer son détachement, elle prend le nom de « section Gendarmerie des territoires occupés. »
À la même époque, la direction générale, consciente de la précarité accrue de la position de sa représentation dans les locaux de la délégation générale, cherchait depuis longtemps un endroit où elle aurait pu l’installer en toute indépendance. La prospection, poussée plus activement, lui permet d’acquérir les immeubles situés au 17 et au 19 du boulevard de la Tour-Maubourg. Par suite des contraintes imposées par les ordonnances allemandes sur les constructions et travaux immobiliers, les nouveaux locaux ne pourront jamais être mis en état. La section Gendarmerie n’a pas d’autre choix que celui de rester sur place, rue Cambacérès.
En janvier 1944, la délégation générale ayant besoin de locaux supplémentaires l’invite à évacuer les lieux à bref délai. En fait, la mesure, différée de mois en mois, ne sera jamais mise à exécution. Elle montre, en tout cas, que la Gendarmerie n’y était que tolérée.
Quant aux relations avec le délégué général du Gouvernement français, de Brinon, elles sont inexistantes. En quatre ans, il convoque seulement deux fois le chef de la section Gendarmerie pour traiter avec lui de questions de détail : garde de sa propriété à Chantilly, procédure établie par des gendarmes à l’encontre d’un individu condamné par la suite à une peine correctionnelle pour dénonciation calomnieuse d’un chef de brigade.
Le 30 mai 1942, Hitler transfère les pouvoirs de police, jusqu’alors confiés à l’administration militaire (Wehrmacht), aux SS. Il nomme le général Karl Oberg chef de toutes les polices allemandes en France avec le titre de « Chef supérieur des SS et de la Police » (Höhere SS und Polizei Führer). Tout ce qui touche à l’ordre public et à la sécurité intérieure, en zone occupée, relève directement de sa responsabilité :
« Dans ses domaines d’activité, écrit Hitler, il a le droit de donner des instructions aux autorités de police française et le droit de les contrôler. Il dispose de l’engagement des forces de police française de la zone occupée. »
Le colonel Helmut Knochen, installé à Paris depuis juillet 1940, avec une centaine de policiers qui formaient l’antenne du « Bureau central de sécurité du Reich », le seconde. Pour renforcer ce Kommando initial, Oberg arrache à la Wehrmacht ses policiers militaires de la Geheime-Polizei et les reconvertit en SS. Seuls, les Feldgendarmes et les gardiens de prison échappent à cette mutation.
Le chef supérieur des SS articule ses forces en deux unités complémentaires. La première, l’Ordnungspolizei ou « Orpo », commandée successivement par Schweinichen et Scheer, a dans ses attributions la responsabilité du maintien de l’ordre et peut intervenir en unités militarisées capables d’agir contre les maquis. La seconde, Sicherheitspolizei ou « Sipo », police de sécurité, jumelée avec le service de renseignements Sicherheitsdienst (SD), est aux ordres de Knochen.
Oberg calque l’organisation centrale des services de sécurité de Paris sur les structures de la police nazie (RSHA) articulées en sept bureaux. Le bureau II se charge des rapports avec les services de police français et l’administration militaire allemande.
Dans chaque préfecture régionale, Oberg met en place un dispositif administratif et policier analogue coiffé par un Kommandeur der Sipo-Sd (en abrégé KDS). Les Kommandeurs contrôlent, dans leur juridiction, la Police et la Gendarmerie française auxquelles ils donnent des ordres, soit directement, soit par l’intermédiaire des préfets régionaux.
À Paris, le chef de la section Gendarmerie des territoires occupés est tenu d’assister à la réunion hebdomadaire organisée par les représentants de la Police de sûreté et de maintien de l’ordre allemande. À cette occasion, il défend les intérêts de l’Arme au point de vue organisation et service ainsi que les officiers, gradés ou gendarmes arrêtés. Jamais il ne participe aux conférences organisées par le général Oberg ou les officiers de son état-major.
* *
*
La section Gendarmerie cesse toute activité le 20 août 1944.
Après s’être investi des fonctions de commandant de la Gendarmerie de l’Île-de-France, en remplacement du général Guibert, arrêté sur son ordre, le lieutenant-colonel Capdevieille, retraité de la garde de Paris, qui arbore sur son béret deux étoiles de général, se présente à la section Gendarmerie des territoires occupés pour notifier à son chef qu’il est relevé de ses fonctions.
Il saisit toutes les correspondances de service établies depuis le début de l’Occupation. Sans doute pense-t-il découvrir dans ces documents des preuves de collaboration avec les Allemands. Il n’y trouvera pas le moindre indice de compromission.
À quel titre cet officier intervient-il ? Connu sous le pseudonyme « d’Ursus », il est un des signataires de l’appel à l’insurrection adressé par le parti communiste, le 17 août, à la population parisienne. Membre du comité directeur du Front national de la Gendarmerie, il organise au printemps de l’année 1944, avec plusieurs officiers en retraite, un noyau de résistance au sein des unités de la région parisienne en vue de mettre sur pied des « forces gouvernementales » chargées au jour « J » d’encadrer l’insurrection dans la capitale et de recevoir le Gouvernement provisoire venu d’Alger. À ses côtés, on trouve le chef d’escadron Paul Audra ainsi que des gradés et gendarmes en activité des brigades d’Exelmans, Boulogne-Billancourt, Neuilly, Asnières, La Comète… qui agissent en liaison avec les membres du réseau « Ceux de Libération-Vengeance ». C’est encore lui qui dresse et signe le 8 août la liste des officiers supérieurs à mettre aux arrêts et à interner à la Libération, avant de s’installer aux leviers de commande et de se promouvoir au grade supérieur.
Officiellement, il s’agit d’éliminer les éléments « suspects » ou considérés comme tels. En fait, l’objectif est de se débarrasser des officiers n’éprouvant pas une sympathie particulière pour l’organisation communiste du Front national et les sociétés secrètes du type « La Fraternelle de la Gendarmerie. »
L’attitude du lieutenant-colonel Capdevieille à l’égard du chef de la section Gendarmerie des territoires occupés est pour le moins ambiguë. Il lui fait remettre, en premier lieu, l’ordre de mise aux arrêts jusqu’à nouvel ordre, signé du général Chaban-Delmas, en second lieu, le lendemain, un laissez-passer établi par ses soins l’autorisant à circuler librement de jour comme de nuit. Des faits précis et irréfutables prouvent sa résistance constante à l’occupant si bien qu’il retrouve, quelques jours après, une totale liberté d’action. D’ailleurs, à la fin du mois d’août, la nouvelle direction lui propose plusieurs commandements.
Il opte pour celui de la 10e légion, ex-légion d’Alsace et Lorraine, qu’il faut réorganiser dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Entreprise difficile et risquée car cette partie du territoire n’est pas encore libérée. Il quitte Paris pour Nancy le 7 septembre, avec 6 officiers et 87 sous-officiers destinés à constituer le noyau de la 10e légion.
Entre la date de sa création, en juillet 1940, et celle de sa disparition, fin août 1944, ponctuée par le départ pour l’Alsace de son chef, la section Gendarmerie des territoires occupés à une activité très diversifiée. En priorité, conformément au mandat qu’elle a reçu, elle négocie pendant plusieurs mois avec le commandement militaire allemand le statut de la Gendarmerie en zone nord.
Les problèmes auxquels se trouve confrontée la section Gendarmerie des territoires occupés sont multiples et particulièrement importants. Les plus urgents, pour elle, sont la réinstallation des légions de Gendarmerie qui avaient été repliées en zone non occupée et le retour des prisonniers.
Mais, comme on pouvait s’y attendre, il lui faut rapidement faire face aux exigences allemandes. Et celles-ci se manifestent tout d’abord par une note du 23 septembre 1940 du général Streccius. Cette note, dont le contenu détaillé sera étudié dans les pages qui suivent, ordonne spécialement la dissolution de la Garde républicaine mobile et la réorganisation de la gendarmerie départementale.
CHAPITRE 5 – LES NÉGOCIATIONS
À l’évidence, les Allemands se méfient de la Gendarmerie. Son appartenance aux armées constitue, à leurs yeux, une menace potentielle. D’où leur volonté de l’affaiblir pour la rendre inopérante militairement. Ne pourrait-elle pas, en effet, se montrer dangereuse pour eux si elle menait une politique de résistance passive ou si elle entravait leur action ?
Du côté de la Gendarmerie, deux négociateurs : le colonel Mahé et le capitaine Sérignan. L’action du premier, très éphémère, ne dure que quelques semaines. Il quitte son poste le 7 septembre 1940 au moment où, précisément, commence l’examen de questions vitales pour la Gendarmerie. À partir de cette date, le capitaine Sérignan prend le commandement de la section et devient l’unique interlocuteur de la Gendarmerie auprès du général chef de l’administration militaire en France.
Du côté allemand, des officiers de la police de protection, les majors Van der Groeben et Runkowsky, conduisent successivement les discussions. Derrière eux se profile l’ombre inquiétante du docteur Best, un des doctrinaires du nazisme, qui supervise au sein de l’état-major administratif les relations avec la Police française.
Tous les éléments se conjuguent pour placer le représentant de la Gendarmerie dans une position délicate et inconfortable. D’abord, il y a l’éloignement de sa direction installée à Vichy, en zone libre, avec laquelle les liaisons ne sont pas très fiables. Les lenteurs dans l’acheminement du courrier et le manque de sûreté des communications téléphoniques, surveillées par l’occupant, l’obligent, dans les situations d’urgence, à prendre immédiatement des décisions souvent importantes sans pouvoir en référer au commandement supérieur. Et puis, le comportement dominateur de ses interlocuteurs qui veulent imposer leurs vues ne facilite pas sa tâche dont l’accomplissement, outre l’esprit d’initiative, exige patience, ténacité, ruse et courage.
Pendant près de quinze mois, sans interruption, il mène à leur terme les discussions sur la réorganisation de la Gendarmerie en territoire occupé. Réunions presque quotidiennes, échanges de correspondances, décisions des autorités allemandes en jalonnent le déroulement.
* *
*
Un premier accord intervient rapidement qui permet, dès la fin du mois de juillet 1940, de faire rentrer en zone occupée, par groupes de 50 avec leur matériel automobile et un armement réduit, le gros des éléments de gendarmerie départementale repliés au sud de la ligne de démarcation. Comme ils l’ont exigé pour la Garde de Paris, les Allemands ne tolèrent qu’un armement restreint : un pistolet et 9 cartouches par gendarme.
Dans une dizaine de départements, ils s’opposent, initialement, au retour de la Gendarmerie. C’est le cas dans ceux du Nord et du Pas-de-Calais, rattachés au commandement des forces militaires en Belgique.
L’amorce d’une solution apparaît seulement en décembre 1940. Le préfet Ingrand, envoyé spécial du Gouvernement de Vichy, obtient l’autorisation de se rendre dans la région du Nord. Durant son séjour à Lille, les 4 et 5 décembre, il rencontre le général Niehoff, Oberfeldkommandant. Ce dernier lui donne un accord de principe pour la remise en place de 650 gendarmes. Les premiers commencent à réintégrer leurs résidences à partir de février 1941. Au début de l’été, toutes les formations repliées de la 1re légion (Nord, Pas-de-Calais) ont rejoint leurs circonscriptions.
Le commandant des forces militaires en Belgique se range aux arguments de la section Gendarmerie et consent, le 26 mai 1942, à une augmentation des effectifs de 200 hommes pour permettre la constitution de détachements mobiles motorisés (brigades mixtes).
Dans la zone interdite et réservée (Aisne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Jura, Territoire de Belfort) où Hitler à l’intention de recréer un état « Thoïs » c’est-à-dire germanique, le commandant des forces militaires en France fait preuve de la même intransigeance que son homologue de Belgique au sujet du retour des gendarmes.
À la fin du premier trimestre de l’année 1941, la section Gendarmerie finit par le convaincre. D’abord individuellement, puis en unités constituées, les gendarmes reviennent dans leurs brigades si bien que les effectifs, en zone interdite et réservée, s’élèvent le 1er août 1941 à 15 officiers et 1.316 gradés et gendarmes.
À la même époque, les autorités allemandes répondent favorablement à une nouvelle demande en acceptant, pour une durée de six mois, qui en fait sera prorogée, le retour de 3 officiers et 589 sous-officiers dans la région industrielle du Doubs.
Des obstacles matériels et administratifs retardent le rapatriement de quelques formations. Les personnels de la compagnie de la Haute-Saône repliés en Saône-et-Loire, depuis le 13 juin 1940, où ils sont employés à la surveillance de la ligne de démarcation, côté français, ne savent pas encore, le 1er septembre 1941, dans combien de temps ils pourront regagner leur département d’origine.
Dans les provinces annexées d’Alsace et de Lorraine, il n’est pas question du rapatriement des unités. Cependant, les Allemands s’intéressent aux gendarmes alsaciens passés en Suisse en juin 1940. Internés dans des centres de triages, les intéressés reçoivent en septembre 1940, par le truchement des autorités helvétiques, une demande du Gouvernement allemand ainsi libellée : « Souhaitez-vous que l’Alsace-Lorraine soit annexée au grand Reich ? » En octobre, nouveau questionnaire aux fins de savoir s’ils accepteraient de rentrer en Alsace. Le 4 janvier 1941, une commission soi-disant mixte, mais ne comportant en réalité que des Allemands, convoque les Alsaciens au camp de Bieberich et leur propose de revenir en Alsace où on leur offre de lucratives situations notamment dans la Gendarmerie allemande. Quelques-uns acceptent. Accompagnés du mépris de leurs camarades, ils quittent la Suisse pour rentrer dans leur province natale.
Quant à la légion d’Alsace-Lorraine, elle survit quelques mois en zone libre où elle est répartie en deux détachements respectivement stationnés à Toulouse et à Marseille. Avant de recevoir une affectation en brigade les gendarmes de ces détachements sont surtout employés à la garde des camps d’internement très nombreux en zone sud. L’irruption de l’ennemi, en zone sud, le 11 novembre 1942, entraîne la dissolution de la légion.
Le 21 janvier 1943, le commandant de légion, au cours d’une cérémonie émouvante, remet son fanion au directeur général de la Gendarmerie. Il conclut son allocution sur ce propos : « Ce fanion vient de Strasbourg. Il a été témoin de nos épreuves. Ayant été à la peine, Dieu veuille qu’il soit un jour à l’honneur. »
Ce vœu ne sera exaucé que 23 mois plus tard. Dès le 7 septembre 1944, le commandement de la Gendarmerie entreprend la réorganisation de la légion sous l’appellation de 10e légion. Il ordonne le rassemblement des personnels qui y servaient avant la guerre et fait appel à des volontaires pour compléter leur effectif insuffisant.
Le regroupement des détachements nécessite plusieurs semaines par suite des combats qui se déroulent en différents points du territoire. Un convoi de 170 sous-officiers, commandé par le capitaine Gross, parti du sud-ouest le 19 septembre, n’arrive à sa destination initiale, au camp d’Écouvres, près de Toul, que le 7 octobre.
Au fur et à mesure de la libération des circonscriptions de Gendarmerie, le commandant de légion réinstalle les brigades. Le lundi 27 novembre, les premiers gendarmes, avec leur chef, le lieutenant-colonel Sérignan, entrent à la suite des armées alliées dans la ville de Strasbourg libérée.
Les combats continuent néanmoins. Conséquence de la contre-attaque allemande qui se développe les 2 et 3 janvier 1945, une partie des brigades de la légion se trouve dans une situation des plus critiques. Elles n’échappent à la capture qu’à la suite de dispositions judicieuses prises par le commandement.
Le 19 mars 1945, l’Alsace est enfin libérée. Depuis le début de sa réinstallation, la légion déplore la perte de 10 sous-officiers tombés au champ d’honneur. Tout au long de la campagne les gendarmes accomplissent un excellent travail à l’image du détachement de 62 officiers et sous-officiers, placés sous les ordres du capitaine Hirt, mis à la disposition de la 103e division US auquel, le 6 mars 1945, le général Patch, commandant la 7e armée, décerne un témoignage écrit de satisfaction « pour sa conduite exceptionnellement méritoire dans l’accomplissement de ses devoirs militaires. »
Le rétablissement de la Gendarmerie dans les territoires occupés, à l’exception de l’Alsace annexée, qui s’échelonne de quelques semaines, dans les départements qui ne sont soumis à aucune restriction, à plusieurs mois, dans les zones régies par un statut particulier, s’achève à la fin de l’année 1941.
À travers les rapports des autorités allemandes, on suit l’évolution de l’opération. À la mi-août 1940, le général commandant le Bézirk A estime « qu’avec le retour de la Gendarmerie nationale de la zone occupée, le service d’ordre français devrait se remettre en marche au point de suffire à sa tâche à l’égard des populations civiles ». En décembre 1940, le haut-commandement allemand note dans un rapport « que pour le service d’ordre, la réorganisation de la Gendarmerie française se poursuit normalement ». Dans un document du 19 novembre 1940, le docteur Best signale que « la Gendarmerie compte alors (zone occupée) 14.615 hommes dont 375 officiers. »
* *
*
À partir du mois de septembre 1940, les Allemands expriment leurs exigences concernant les modalités de réorganisation de la Gendarmerie en zone nord.
Dans sa lettre comminatoire en date du 23 septembre, le général Streccius fixe son effectif, en zone nord, à 20 000 hommes, impose la dissolution immédiate de la G.R.M., autorise sous certaines conditions le passage de gardes républicains mobiles dans la Gendarmerie, exige l’exécution d’un service individuel, interdit le logement en caserne de grandes unités et surtout dissout l’organisation de la Gendarmerie telle qu’elle existait avant l’armistice. Curieusement, le général Streccius passe sous silence la question pourtant essentielle de la subordination de la Gendarmerie.
Dans le projet qu’il doit soumettre à l’approbation du militärfelshaber in Frankreich, le négociateur de la Gendarmerie consacre un développement à l’examen de ce point. Il n’ignore pas la crainte qu’inspire l’Arme aux Allemands. N’ont-ils pas, à la fin du mois d’août 1940, imposé le passage de la Garde de Paris sous les ordres du préfet de police ? Aussi s’emploie-t-il à minimiser les liens qui existent entre la Gendarmerie et l’armée. Il fait valoir aux autorités allemandes que l’organisation en vigueur, au lendemain de l’armistice, leur offre toutes les garanties désirables car la Gendarmerie, depuis ce moment-là, est intégrée dans une direction générale des services administratifs confiée à un directeur général civil. Autre argument développé pour les convaincre, la présence à la tête de l’institution d’un magistrat de l’ordre administratif. Il leur indique, d’autre part, que les rapports antérieurs de subordination de la Gendarmerie avec l’état-major de l’armée n’existent plus. Quant aux généraux commandant les régions militaires, ils ne contrôlent plus les corps de Gendarmerie. Enfin, le poste d’inspecteur général, confié à un officier général du Conseil supérieur de la guerre est supprimé.
Les Allemands ne se laissent pas influencer par ce plaidoyer. Le 12 janvier 1941, la réponse du général Von Stulpnagel, successeur de Streccius, tombe comme un couperet :
« Je ne suis pas d’accord avec vos propositions concernant la subordination de la Gendarmerie au ministre de la Guerre. La Gendarmerie, poursuit-il, ne peut que relever du ministère de l’Intérieur et ne doit avoir aucun lien avec le ministre de la Guerre et l’Armée. »
Informé de cette décision irrévocable, le directeur de la Gendarmerie donne l’ordre à son représentant d’éviter, à tout prix, la subordination de l’Arme au ministère de l’Intérieur.
Comment, sans rompre son unité, pourrait-on concevoir une Gendarmerie nationale fractionnée en deux éléments, l’un en zone libre relevant de l’autorité du ministre de la Guerre, l’autre en zone nord rattaché à celui de l’Intérieur, dotés chacun d’une vie indépendante, ayant des besoins particuliers et y pourvoyant par leurs propres et seuls moyens ?
Le chef de la section Gendarmerie dispose d’une marge de manœuvre étroite. Il ne se résigne pas. Comme la délégation générale du Gouvernement français représente les autorités françaises et par suite tous les ministères, dont celui de l’Intérieur, pourquoi, pense-t-il, ne rattacherait-on pas la Gendarmerie à cet organisme ? À condition qu’elle soit fictive, l’opération ne devrait avoir aucune répercussion sur la situation de la Gendarmerie qui continuerait de relever du département de la Guerre.
La viabilité du projet suppose que le délégué général du Gouvernement français considère que son action, à l’égard de la Gendarmerie, n’est que de façade. La seule autorité s’exerçant sur elle ne pouvant être que celle du ministre de la Guerre. Autre obligation, le représentant du directeur de la Gendarmerie doit agir ouvertement comme s’il était subordonné au délégué général alors qu’en réalité il est, à son égard, le porte-parole du ministre pour toutes les questions d’organisation interne. Dernier impératif et non le moindre, ne pas donner l’éveil à l’occupant. D’où l’observation scrupuleuse du secret.
M. Chasserat, directeur de la Gendarmerie, de même que le général Koeltz, directeur des services de l’armistice, appuient ces propositions que le ministre secrétaire d’État à la Défense entérine.
Le chef de la section Gendarmerie arrête alors les modalités de détail du dispositif qui vient d’être agréé. Tous les ordres, dépêches, circulaires émanant de la direction et destinés à la Gendarmerie de la zone nord partiront de Vichy sous l’attache de la délégation générale mais ils ne seront pas signés. Arrivés à Paris, ces documents seront paraphés par ordre, soit par le secrétaire général de la délégation mis dans la confidence et ce pour toutes les questions de fond, soit par le chef de la section Gendarmerie pour les affaires mineures. En fait, l’ensemble de la Gendarmerie restera placée sous l’autorité du ministère de la Guerre.
Le 17 mars 1941, le délégué général du Gouvernement français transmet au général Von Stulpnagel les contre-propositions de la section Gendarmerie. À ce sujet, il précise :
« La Gendarmerie de la zone occupée dont tous les liens avec l’armée ont déjà été rompus ne sera plus subordonnée, pendant la période de l’armistice, à l’autorité du ministre de la Guerre.
Afin de donner tous apaisements à l’autorité occupante, elle sera subordonnée à l’autorité du délégué général du Gouvernement français (M. de Brinon).
Le délégué général disposera, à l’intérieur de la délégation, d’une section Gendarmerie qui aura à sa tête un officier supérieur de Gendarmerie, d’un ou plusieurs inspecteurs de la Gendarmerie de la zone occupée. »
Le 21 avril, le général Stulpnagel informe la délégation générale qu’il « accepte que la Gendarmerie de la zone occupée soit placée sous l’autorité du délégué général du Gouvernement français. »
Contre toute attente, la section Gendarmerie a réussi à sauvegarder l’unité de l’Arme.
Le rattachement fictif de la Gendarmerie de la zone nord à la délégation générale cesse le 2 juin 1942, date à laquelle une loi place l’ensemble de l’Arme sous l’autorité du chef du Gouvernement.
* *
*
Depuis le mois d’août 1940, la Garde de Paris, séparée de la Gendarmerie, dépend du ministère de l’Intérieur malgré les protestations émises par le colonel Martin et la section Gendarmerie des territoires occupés. Avec l’appui du contrôleur général Lachenaud, M. Chasserat négocie en secret, avec l’amiral Bard, sa réintégration au sein de la Gendarmerie.
D’un commun accord, courant juillet 1941, à l’insu des Allemands, ils mettent fin à sa subordination au préfet de police. La section Gendarmerie reçoit des mains de l’amiral Bard la décision secrète qui la rétablit dans sa situation antérieure.
À l’occasion de la réorganisation des régions d’inspection, en 1943, la direction générale intègre dans les tableaux d’effectifs de la Gendarmerie de l’Île-de-France ceux de la Garde de Paris. La subtilité de l’opération échappe à l’œil pourtant vigilant des autorités allemandes qui n’émettent aucune observation à la lecture du document qu’elles reçoivent en communication.
La section Gendarmerie des territoires occupés, dès septembre 1940, traite le dossier de la G.R.M. dont un ultimatum scelle le sort. Dans sa note du 25 septembre, le général Streccius écrit :
« Comme la G.R.M. est un élément de l’armée française, elle est dissoute dans les territoires occupés. »
On dénombre alors en métropole 15 légions de G.R.M. pour la plupart, soit une dizaine, implantées en zone nord. Que vont devenir les milliers de gardes républicains mobiles affectés dans les formations non repliées qui se trouvent dans les territoires occupés telles les 21e, 22e et 23e légions en garnison dans la région parisienne ?
Certes, les Allemands autorisent le passage dans la gendarmerie départementale de 7.000 d’entre eux mais dans des conditions draconiennes. Le commandement doit apporter la preuve qu’ils n’ont pas appartenu à une unité combattante pendant les hostilités. Or ce n’est pas le cas du plus grand nombre. De plus, ils interdisent formellement leur incorporation dans la G.D. en unités constituées.
Le capitaine Sérignan adopte une solution particulièrement risquée en décidant le passage en bloc, dans la gendarmerie départementale, de toutes les unités de G.R.M. encore présentes en zone nord.
Pour que le mouvement passe inaperçu, il leur donne l’ordre de changer immédiatement les galons rouges et or en galons argent de la gendarmerie départementale. Précaution supplémentaire pour tromper l’occupant, il envoie tous les gardes en renfort dans les brigades.
Par la suite, à deux reprises, en réponse aux demandes pressantes des autorités allemandes, il engage sa responsabilité par écrit en certifiant que la G.R.M. a été dissoute dans les conditions fixées. Est-il besoin de souligner que son initiative contrevenait, en tous points, aux instructions données par l’administration militaire allemande.
* *
*
Au cœur des discussions, le plafonnement des effectifs à 20 000 hommes constitue un nouveau sujet de préoccupations pour la Gendarmerie. On sait qu’elle disposait en zone nord, la veille des hostilités, de 30 000 gendarmes et gardes. Ces derniers, lorsqu’ils n’étaient pas en déplacement pour le maintien de l’ordre, renforçaient les brigades auxquelles ils servaient d’appoint pour effectuer le service journalier.
Par suite des pertes consécutives à la guerre, de la dissolution de la G.R.M., des radiations des contrôles incompressibles dues aux décès, invalidités, départs à la retraite (1 200 hommes/an en moyenne), des renvois à caractère disciplinaire ou motivés par l’application des lois d’exception, le potentiel de la Gendarmerie en zone occupée s’élève à la fin de l’année 1940 à 15 000 hommes.
Ces moyens seront-ils suffisants pour permettre à la Gendarmerie de remplir les charges qui lui incombaient avant la guerre ? Dans l’immédiat, comment pallier au déficit d’au moins 5 000 officiers et sous-officiers alors que l’administration militaire allemande autorise 20 000 militaires et paradoxalement interdit tout recrutement, s’oppose à la mutation de gendarmes de la zone sud dans les territoires occupés, soumet à des conditions restrictives la réadmission dans la G.D. des gardes républicains mobiles devenus disponibles à la suite de la dissolution de leurs légions ?
Pour y remédier, le capitaine Sérignan tente inlassablement d’obtenir le retour des 5 000 gendarmes prisonniers. Il se garde bien de relancer prématurément la question du recrutement qui était de nature à y faire obstacle.
Certes, la demande qu’il a présentée par note du 5 juillet 1940 à la commission d’armistice de Wiesbaden, pour faire rapatrier les gendarmes prisonniers, est restée sans écho. Cependant, la situation, sous son impulsion, évolue. Il constate en particulier que des commandants de camps de prisonniers, sollicités par des préfets, acceptent de libérer des gendarmes au vu d’un simple certificat attestant de leur appartenance à la Gendarmerie. Avec succès, il utilise ce procédé et en élargit les possibilités. Les Allemands, dans plusieurs cas, acceptent de libérer les militaires de la Gendarmerie chargés de famille (père de 4 enfants) ou ayant des antécédents sanitaires, ou encore devenus veufs depuis la déclaration de guerre.
La section Gendarmerie établit des listes qu’elle adresse aux chefs de camps. Elle obtient des résultats encourageants qui inclinent son chef à donner des instructions à tous les commandants de légion de la zone occupée pour qu’ils se rapprochent des commandants des camps, partout où il en existait sur leurs circonscriptions (Bar-le-Duc, Tongres, Saint-Julien, Biffontaine, Châtenois, Gigny, etc.), en vue de provoquer de nouvelles libérations. Ces efforts convergents aboutissent, à la fin de l’année 1940, au retour dans leurs unités d’un millier d’officiers, gradés et gendarmes. Au mois de mars 1941, 2 000 militaires au total ont bénéficié d’une mise en congé de captivité.
Le chef de la section Gendarmerie, parallèlement à ces actions ponctuelles, s’efforce de traiter globalement la question des prisonniers. Pour persuader ses interlocuteurs, il insiste sur l’insuffisance des effectifs que peuvent compenser très avantageusement les officiers, gradés et gendarmes prisonniers, personnels déjà formés, particulièrement solides, entraînés et compétents au point de vue professionnel.
D’autre part, il réussit à faire dissocier le problème particulier de la Gendarmerie, en le plaçant sur un plan technique, de celui en quelque sorte politique que représentait l’action de la mission Scapini s’exerçant sur près de 2 millions de prisonniers.
S’adressant le 17 mars au général commandant les forces militaires en France, le capitaine Sérignan attire son attention « sur l’intérêt qui s’attache à placer en congé de captivité les 185 officiers et 2 650 gendarmes encore actuellement prisonniers… »
Le général Stulpnagel, dès le 21 avril, saisit le haut-commandement militaire allemand seul habilité à prendre une décision de caractère général. Le 10 mai, il rend sa réponse au délégué général du Gouvernement français :
« Le haut-commandement de l’armée allemande est, en principe, disposé à mettre 2 385 autres officiers de Gendarmerie ou gendarmes en congé de captivité.
Toutefois, cette mise en congé s’entend exclusivement pour des officiers et des sous-officiers.
Le haut-commandement de l’armée allemande demande maintenant que les listes des officiers de Gendarmerie ou gendarmes à mettre en congé de captivité lui soient adressées par retour du courrier… »
Dans cette lettre, deux chiffres avaient été malheureusement intervertis de sorte que sur les 2 835 prisonniers qui devaient être libérés, il n’y en a eu que 2 385. Cela explique que 500 officiers, gradés et gendarmes, malgré les interventions ultérieures, resteront internés jusqu’à la fin de la guerre.
Les renseignements exigés pour chaque prisonnier, bien que très nombreux (noms, prénoms, grade, n° de plaque d’identité, camp d’affectation) parviennent dans les délais exigés grâce à la collecte préalable d’informations que le chef d’escadron Sérignan avait eu la précaution de prévoir ainsi qu’au travail de recherche considérable fourni de jour et de nuit par son secrétariat.
Alors que le retour des prisonniers semble acquis, le chef de la section Gendarmerie reçoit une mise en demeure de rendre compte immédiatement de l’affectation des militaires en instance de rapatriement. Ces derniers devaient, selon les instructions allemandes, réintégrer leur brigade d’origine.
Or un grand nombre d’entre eux provenaient de la G.R.M. et appartenaient à des formations de l’est de la France.
Par suite, n’ayant jamais servi dans la gendarmerie départementale, ils ne pouvaient y recevoir une affectation.
Contrairement aux ordres reçus, le représentant de la Gendarmerie décide de les répartir dans les unités territoriales situées tout le long de la ligne de démarcation. Quant aux gendarmes départementaux ils regagnent, comme prévu, leurs anciennes résidences.
* *
*
Rien ne laissait présager, au début de l’année 1941, le retour massif des prisonniers de la Gendarmerie lorsque l’on sait que le 12 janvier 1941, une note du commandant des forces militaires en France, tout à fait inattendue et génératrice d’une véritable stupeur, ordonne le renvoi immédiat, sur leurs camps de prisonniers, des gardes mobiles anciens combattants considérés, de ce fait, comme ayant été libérés par erreur. Il s’agissait de 1 200 gardes qui, pendant la guerre, avait été affectés à l’encadrement d’unités de l’armée française.
La section Gendarmerie des territoires occupés estime impensable de donner satisfaction à cet ordre. Mais comment parvenir à le rendre inopérant ? Les Allemands opposent une fin de non-recevoir à la première proposition qui leur est soumise de les répartir dans toute la zone occupée. Ils n’acceptent pas l’idée émise de les rassembler dans la région parisienne et n’autorisent pas davantage leur échange, nombre pour nombre, avec des éléments venus de la zone libre. Ces atermoiements les irritent. En dernier recours, le chef de la section Gendarmerie propose la création d’un corps spécialisé dans la garde des voies de communication ou des ouvrages d’art constitué avec ces gardes et des requis civils qui assuraient déjà ces services.
Le 24 avril 1941, le général Von Stulpnagel informe de sa décision le délégué général du Gouvernement français :
« En confirmation des entretiens qui ont eu lieu verbalement avec le délégué pour la Gendarmerie au sujet de l’institution de gendarmes auxiliaires, j’accepte la création d’une Gendarmerie auxiliaire dans le cadre ci-après… »
À partir de ce moment-là, il ne fut plus question de renvoyer les 1 200 gardes mobiles sur les camps de prisonniers.
Organisation particulière, la Gendarmerie auxiliaire relève du délégué de la Gendarmerie en zone occupée, terme par lequel les Allemands désignent le chef de la section Gendarmerie.
La mise sur pied de détachements n’est possible qu’avec l’autorisation expresse du commandant des forces militaires en France et lorsque la Gendarmerie ne dispose pas des effectifs nécessaires pour assurer son service normal dans les départements. De même, quand elle est chargée par l’administration militaire allemande de missions supplémentaires de surveillance ou d’une autre nature et qu’elle ne peut les remplir avec ses effectifs, la création de gendarmes auxiliaires est admise. En tout état de cause, l’institution de gendarmes auxiliaires ne peut s’effectuer qu’à titre d’expédient et sous réserve de l’autorisation des Feldkommandants compétents.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les gendarmes auxiliaires revêtent l’uniforme de la Gendarmerie mais sans insigne de leur grade. Toutefois, l’interdiction de porter des galons ne s’applique pas aux officiers. Un élément distinctif permet de reconnaître les membres de ce corps : le brassard vert, avec le cachet du Feldkommandant, et la mention en français et en allemand « Gendarmerie auxiliaire » qu’ils portent au bras gauche. Enfin, ils disposent du même armement que les gendarmes.
Au mois d’avril 1941, la Gendarmerie auxiliaire compte 31 officiers et 1 182 hommes gérés par le centre d’administration du personnel auxiliaire de la Gendarmerie installé à la caserne Charras à Courbevoie et placé sous les ordres d’un capitaine. Tous les personnels continuent à percevoir intégralement la solde du grade qui était le leur antérieurement.
Interdits de travail dans les brigades, les gendarmes auxiliaires remplissent des missions de surveillance diverses : garde de ponts de bateaux allemands (Vernon), de trains de munitions (Gasny), de tunnels (Navarre), de ponts (Vernon)… Beaucoup vivent mal ce statut qui leur apparaît incompréhensible et injuste étant donné qu’il résulte de leur qualité d’ancien combattant. Aucune explication ne pouvait pourtant leur être donnée. Il était indispensable en effet, pour la réussite d’une opération au demeurant très risquée, que le secret le plus absolu soit observé par les initiateurs du projet.
Si l’institution d’une Gendarmerie auxiliaire écartait tout danger de renvoi dans les camps de prisonniers des gardes anciens combattants, libérés à tort, elle ne portait pas remède à l’insuffisance des effectifs de la zone nord.
* *
*
Après la mise en congé de captivité d’un nombre significatif de gendarmes, fin 1940, le capitaine Sérignan envisage la reprise du recrutement. Comme il n’existe plus de centre de formation d’élèves-gendarmes dans les territoires occupés, il préconise d’envoyer les candidats recrutés sur place dans les écoles de la zone libre.
Si le 15 janvier les Allemands répondent qu’ils sont favorables au principe du recrutement, en revanche, ils n’admettent pas que les élèves-gendarmes soient formés en zone sud et qu’une fois leur stage terminé ils reviennent en zone occupée. Ils autorisent la création d’écoles sous réserve d’être informés, avant le 1er mars, du lieu de leur implantation, du nombre d’admissions envisagé, de la durée des stages et des programmes de formation.
Un projet prend corps rapidement qui prévoit l’organisation de deux écoles, l’une à Cholet (Maine-et-Loire), l’autre à Mamers (Sarthe), d’une capacité chacune de 400 élèves. Notons qu’à Cholet l’école est installée dans la caserne Tharaud occupée avant la guerre par la G.R.M. Les troupes allemandes occupent les bâtiments principaux tandis que les élèves-gendarmes sont relégués dans des locaux annexes. C’est dire combien leur indépendance est relative.
Le cycle de formation, d’une durée de 6 mois, est axé sur l’éducation militaire et morale, l’instruction professionnelle, élémentaire, physique et automobile. Les autorités allemandes donnent leur agrément à ces propositions. À la fin de l’année 1941, les écoles préparatoires ouvrent leurs portes aux élèves-gendarmes.
Lors de l’élaboration du texte sur le recrutement, le chef de la section Gendarmerie fait introduire, à dessein, une clause au terme de laquelle peuvent servir dans la Gendarmerie les anciens combattants de 1939-1940. À la faveur de cette disposition, en opposition avec les instructions allemandes, il est possible de réintégrer les 1 200 gardes anciens combattants qui au point de vue administratif, n’avaient jamais cessé d’appartenir à la Gendarmerie.
Malgré le contingentement des effectifs à 20 000 hommes, les forces de Gendarmerie, dans les territoires occupés, sont portées progressivement à 23 000, non compris ceux du Nord et du Pas-de-Calais. La section Gendarmerie parvient même à faire accepter la création de réserves mobiles motorisées pour renforcer les brigades territoriales. Courant 1941, le commandement met sur pied les brigades mixtes et, dans la région parisienne, des groupements de réserve motorisés articulés en groupes et brigades.
* *
*
Dans sa correspondance du 23 septembre 1940, le général Streccius aborde les questions de structure et d’emploi. Il prononce la dissolution de l’organisation de la Gendarmerie telle qu’elle était en vigueur jusqu’alors et détermine les bases de sa restructuration.
Trois mesures sont prévues. D’une part, la suppression de la Gendarmerie dans les agglomérations de plus de 5 000 habitants déjà pourvues d’un service de police ou susceptibles de l’être comme le prévoyait le projet de réforme sur l’étatisation de la police préparé par le ministère de l’Intérieur. De l’autre, la dispersion des effectifs dans les campagnes, à raison d’un gendarme par commune, en vue d’effectuer le service sous la forme individuelle, à la manière allemande. En troisième lieu, l’interdiction de loger en caserne de grandes unités.
Dans certaines régions, en fonction des circonstances et à titre tout à fait exceptionnel, le regroupement de dix gendarmes au maximum dans une caserne est admis.
Concernant l’emploi, le général Streccius est favorable au maintien des dispositions du décret du 20 mai 1903. Il ne s’agit que d’une fiction. Certes, les rapports de la Gendarmerie avec les autorités civiles ne sont pas modifiés. Ils obéissent aux règles traditionnelles : mise en œuvre par voie de réquisition ou de demande de concours.
Toutefois, les Allemands s’estiment fondés à confier à la Gendarmerie toutes missions qu’ils jugent utiles. En outre, le commandement de la Gendarmerie a l’obligation nouvelle de signaler à l’avance aux Feldkommandanturen, par l’intermédiaire des préfets, tout rassemblement temporaire de personnels organisé pour des motifs de service.
Le plan conçu par les autorités allemandes répond à un souci de sécurité de leur part. Ils considèrent comme un danger de maintenir les gendarmes groupés. En choisissant ce schéma qui conduit inéluctablement à l’éclatement des brigades, cellules d’exécution du service, dotées de moyens collectifs d’intervention (véhicules…), regroupées en caserne sous l’autorité d’un chef, capables d’agir avec célérité en cas d’événement grave, ils escomptent affaiblir la Gendarmerie pour mieux la dominer. Éloigner les gendarmes de leur chef immédiat ne pouvait qu’y contribuer.
Pour contrecarrer le projet, sinon en limiter la portée, le chef de la section Gendarmerie formule une série de contre-propositions. Il insiste sur le fait, d’une part, que l’organisation et le service de la Gendarmerie sont le fruit d’une longue adaptation, au cours des siècles, correspondant à l’évolution des besoins de la société française et d’autre part, que notre mentalité n’est pas préparée à un mode d’exécution du service sous la forme individuelle. Pour appuyer son argumentation il ajoute que les casernes de la Gendarmerie française ont été construites pour le logement d’une ou plusieurs brigades et que l’abandon de ces locaux poserait des problèmes pratiquement impossibles à résoudre. Ces arguments restent malheureusement sans effet. Au cours d’une autre réunion, il fait ressortir à ses interlocuteurs qu’une question aussi importante que celle de la dispersion des effectifs ne peut être réglée que lors d’un traité de paix et non en simple période d’armistice. Les négociateurs allemands admettent la validité de ce point de vue mais n’infléchissent pas leur position. C’est alors que le chef d’escadron Sérignan émet une ultime proposition. Étant donné les difficultés que ne manquerait pas d’engendrer l’opération de dispersion des effectifs, il demande de l’échelonner sur une période de quatre ans. Alors que l’on pouvait craindre, devant son insistance, une violente réaction des Allemands, ces derniers acceptent la procédure préconisée. Le chef d’escadron Sérignan leur indique qu’il n’a pas personnellement les moyens matériels de traiter cette affaire dont il transmet tous les éléments à sa direction.
Grâce à ces manœuvres dilatoires, à la fin de la guerre, rien n’est changé quant au stationnement et au mode d’exécution du service de la Gendarmerie.
* *
*
Les discussions sur la réinstallation de la Gendarmerie dans les territoires occupés comportent un volet relatif à la logistique. L’occupant se montre aussi intransigeant dans le domaine du matériel que dans celui des effectifs ou de l’organisation. Il prend des dispositions strictes pour réduire la capacité d’intervention de la Gendarmerie : définitions des dotations, interdictions de certains équipements, conditions strictes de renouvellement des matériels.
Avant la guerre, chaque gendarme disposait d’un pistolet ou revolver, d’un mousqueton et des munitions correspondantes pour le service et l’instruction du tir. En outre, les brigades possédaient une arme automatique (fusil-mitrailleur). Les Allemands n’autorisent par homme, qu’une arme de poing et 9 cartouches. L’exécution de tirs n’est plus possible dans le cadre de la formation des personnels. De plus, les armes manquent au lendemain des hostilités. La Gendarmerie n’en détient pas en réserve dans ses magasins si bien que la totalité de l’effectif ne peut être pourvue. Or l’occupant rejette toutes les demandes de recomplètement malgré les possibilités qui existent de s’approvisionner dans les dépôts des parcs d’artillerie de la zone occupée qui regorgent d’armes ou encore de recourir à de l’armement provenant de la zone libre.
La section Gendarmerie invoque les nécessités du maintien de l’ordre pour obtenir l’attribution de mousquetons et d’armes automatiques. L’occupant consent à débloquer 50 fusils-mitrailleurs et 4 pistolets-mitrailleurs par compagnie (départements). Au lieu de les distribuer, les Allemands, prudents, les stockent au siège des Feldkommandanturen. Lorsque le général Oberg prend les pouvoirs de police, en mai 1942, il fait transférer tout cet armement au siège des « Kommandeurs » de la police du maintien de l’ordre.
Le projet de réalisation d’un réseau de communication radioélectrique indépendant, présenté par la section Gendarmerie, se heurte au veto des autorités militaires allemandes. Sous le couvert de cette opération, la Gendarmerie devait camoufler du matériel technique appartenant à l’armée française. L’arrestation du capitaine Leschi, chef des transmissions de la zone sud, empêche toute avancée dans ce domaine.
Le recomplètement du parc automobile déficitaire et son renouvellement partiel nécessitent des mesures d’urgence. La section Gendarmerie tente d’obtenir l’autorisation de pouvoir faire construire du matériel neuf. Les Allemands répondent favorablement pour les motocyclettes et refusent pour les véhicules automobiles. À défaut de pouvoir pratiquer une politique de construction, la section Gendarmerie s’oriente vers l’acquisition de matériel d’occasion. Progressivement, le parc automobile de la Gendarmerie de la zone nord augmente malgré les obstacles dressés par les Allemands. À leur insu, la Gendarmerie intègre dans son parc des voitures appartenant à l’armée. Courant 1941, le chef d’escadron Sérignan « arrache » une lettre au commandant des forces militaires en France au terme de laquelle les troupes d’occupation ne peuvent réquisitionner les moyens motorisés de la Gendarmerie. Chaque fois qu’une entorse sera faite à cet accord, sauf dans les tout derniers temps de la guerre, la remise des véhicules enlevés sera effective.
Dès le mois de novembre 1940, la section Gendarmerie met en place, auprès des chefs des districts administratifs à Paris, Saint-Germain-en-Laye, Angers, Dijon et Bordeaux, des officiers pour assurer les relations directes entre les autorités allemandes et les unités. Les intéressés cumulent cette fonction avec celle qu’ils exercent habituellement. À Paris, la tâche incombe au chef d’escadron B…, commandant la compagnie de Versailles, secondé par le capitaine C…, du commandement de la Gendarmerie de Paris. À Angers, il s’agit du lieutenant D…, adjoint au capitaine commandant la section d’Angers, à Dijon du capitaine C…, adjoint au chef d’escadron commandant la compagnie de Saône-et-Loire, à Bordeaux du capitaine C…, puis A…, adjoint au colonel commandant la 18e légion. Accrédités par les commandants de région allemands, ils interviennent, chaque fois que cela est nécessaire, pour défendre les intérêts de la Gendarmerie et préserver les acquis obtenus au cours des négociations que les échelons locaux des troupes d’occupation sont peu enclins à respecter. Ainsi prolongent-ils sur le terrain l’action menée à Paris par la section Gendarmerie.
En définitive, après des mois de discussions et d’efforts ardus, la plupart des exigences allemandes sur la réorganisation de la Gendarmerie ne sont que partiellement satisfaites. Pour modestes qu’ils soient, ces résultats ont entraîné bien des démarches, des luttes, des humiliations. Il a fallu vaincre la méfiance de l’occupant, sa mauvaise foi, sa haine et parfois déjouer ses agents provocateurs pour lui arracher un maximum de concessions et sauvegarder l’unité et l’identité de la Gendarmerie. Comment ne pas voir dans l’action menée par la section Gendarmerie des territoires occupés l’expression d’une forme de résistance, non reconnue il est vrai, mais qui n’en est pas moins tangible. Elle va s’affirmer, d’ailleurs, dans d’autres circonstances.
À partir de 1941, il ne se passe pas de mois sans que les Allemands ne prennent en otage, menacent d’arrestation, placent en détention, condamnent ou déportent des militaires de la Gendarmerie. Des actions de résistance passive (inertie devant les exigences allemandes, retards dans l’acheminement de renseignements, etc.) et active (aide apportée aux parachutages, recueil de parachutistes, participation à des organisations clandestines, etc.) sont à l’origine de la répression qui s’abat sur les gendarmes.
En marge du mandat que lui a confié la commission d’armistice et de sa fonction de représentation de la direction de la Gendarmerie en zone nord, la section Gendarmerie des territoires occupés prend en charge, d’initiative, la défense des intérêts des gendarmes exposés à l’action répressive de l’occupant. De 1941 à la Libération, elle défend la cause d’environ 500 officiers et sous-officiers, stationnés dans sa zone de compétence, privés de liberté ou sur le point de la perdre.
CHAPITRE 6 – FRATERNITÉ D’ARME
Sa position contraste avec celle de la direction, très critique à l’égard des gendarmes détenus par les Allemands, comme en témoigne le contenu d’une note du 21 décembre 1943, signée par le général Martin, diffusée dans toutes les régions :
« Depuis le 1er mai 1943, précise le directeur général de la Gendarmerie, 147 officiers, gradés et gendarmes ont été arrêtés par les autorités allemandes pour des motifs divers. Un certain nombre d’entre eux se trouve sous le coup de peines extrêmement graves, voire même de la peine de mort.
Au lieu d’obéir à leurs chefs hiérarchiques et uniquement à eux, ils se sont laissés entraîner par des personnes étrangères à l’Arme qui, n’ayant aucun mandat sinon celui qu’elles s’attribuent elles-mêmes, et aucune responsabilité, ont exploité les sentiments patriotiques de ceux qui les ont écoutés.
Je mets à nouveau en garde tout le personnel contre de tels agissements qui risquent de conduire au pire ceux qui s’y livrent et qui sont, en outre, de nature à nuire à la Gendarmerie tout entière, aux prisonniers de l’Arme et enfin au pays. »
Le général Martin n’est pas aussi intransigeant qu’on pourrait le croire. Comme son prédécesseur, M. Chasserat, il donne son aval à l’action engagée par la section Gendarmerie. Il lui apporte même un appui matériel. N’accepte-t-il pas de dégager des crédits pour assurer la défense des gendarmes traduits devant des Conseils de guerre et venir en aide à leurs familles ?
Pour soustraire à la police allemande les gendarmes en danger d’arrestation et assister ceux qui ont été appréhendés, la section Gendarmerie prend des initiatives. Aux premiers, elle procure des laissez-passer et de fausses pièces d’identité pour qu’ils puissent se dérober aux recherches avant de prononcer ou de provoquer leur mutation en zone non occupée ou en Afrique du Nord. Son action, en faveur des seconds, revêt plusieurs aspects. D’une part, elle procède aux démarches nécessaires pour éviter qu’ils ne comparaissent devant les tribunaux militaires allemands. Faute d’y réussir, elle rassemble des éléments pour minimiser les chefs d’inculpation. D’autre part, elle recherche des avocats spécialisés, s’exprimant en allemand, et leur fournit tous les arguments utiles pour les plaidoiries. En troisième lieu, elle parvient à obtenir de la direction de la Gendarmerie qu’elle prenne en charge les honoraires des avocats et attribue des secours aux familles des gendarmes emprisonnés ou déportés. Lorsque les juridictions prononcent des condamnations, elle établit les recours en grâce. Enfin, elle s’efforce d’obtenir la réduction des peines en cours d’exécution. À ces interventions délicates s’ajoutent les visites fréquentes aux personnels incarcérés dans les prisons de la capitale (Fresnes, la Santé, etc.) pour les réconforter et les tenir informés des dispositions prises pour assurer leur défense.
Autre résultat fructueux dont peut se prévaloir la section Gendarmerie, dès l’automne 1940, elle obtient du chef de l’administration militaire en France l’assurance que les gendarmes, dans l’exercice de leur fonction, ne seront jamais pris comme otages. Or, très vite, il apparaît que les Allemands ne tiennent pas leur engagement. Dans plusieurs départements du nord de la France, à la suite de sabotages et d’attentats perpétrés contre le réseau ferroviaire mettant en péril la sécurité des trains de permissionnaires, ils ordonnent la mise en place de gendarmes français dans les wagons de la SNCF transportant des militaires allemands. La section Gendarmerie proteste énergiquement et obtient gain de cause. Du moins jusqu’à la fin de l’année 1943, en zone nord, les Allemands n’utilisent plus les gendarmes comme « bouclier ».
Grâce aux efforts déployés par la section Gendarmerie, des gendarmes en instance d’arrestation ne tombent pas dans les griffes de l’occupant. D’autres, emprisonnés ou déportés, bénéficient de réduction de peines. Certains sont mêmes acquittés par des Conseils de guerre. Enfin, une douzaine de condamnés à mort échappent à l’exécution à la suite de demandes de recours en grâce. Déportés par la suite, trois d’entre eux, malheureusement, ne reviendront pas des camps d’extermination.
* *
*
L’exposé de situations concrètes présente un double intérêt. Il permet d’apprécier à sa juste valeur le travail obscur, délicat et plein d’incertitudes accompli par la section Gendarmerie. Il met aussi en relief le comportement de gendarmes patriotes. Les modalités de la défense de quelques militaires de la Gendarmerie condamnés à mort retiendront tout d’abord l’attention.
La première relation a pour théâtre la légion d’Aquitaine. Le 26 octobre 1943, la Gestapo arrête le chef Robevieux et le gendarme Gros, de la brigade du Bouscat (Gironde), dénoncés comme résistants. Leur cas s’aggrave à la suite de la découverte à la caserne, au cours d’une perquisition, de plusieurs armes d’origine anglaise. La phase policière de l’enquête se termine par l’interpellation des gendarmes Batbedat et Bouthonnier.
Début avril 1944, les Allemands traduisent les quatre prévenus devant le tribunal militaire de la Feldkommandantur de Bordeaux. Le chef Robevieux et le gendarme Gros sont condamnés à la peine capitale. En revanche, les deux autres sous-officiers, mis hors de cause, sont libérés le 5 avril.
Dès qu’elle a connaissance du jugement, la section Gendarmerie des territoires occupés demande au capitaine A…, de la 18e légion, accrédité auprès du général commandant le district de Bordeaux, de tenter de se procurer une copie du jugement. Non sans difficultés, cet officier y parvient, ce qui était tout à fait exceptionnel. L’attendu du jugement mentionnait que les deux gendarmes avaient été condamnés à mort pour activité de « francs-tireurs et de résistants ». Or les intéressés, prisonniers en congé de captivité, pointaient régulièrement à la Kommandantur comme ils en avaient l’obligation. De ce fait, ils ne pouvaient être considérés comme des partisans. Rapidement, la section Gendarmerie adresse au chef de l’administration militaire en France une requête dûment motivée aux fins d’obtenir la cassation du jugement pour vice de forme. Ce dernier accepte la demande et transmet le dossier à Berlin pour décision.
Avant qu’il ne revienne, le 28 août 1944, les F.F.I. libèrent Bordeaux. L’heure tant attendue de la délivrance sonne pour les deux condamnés emprisonnés au fort du Hâ. Le gendarme Gros rejoint une unité des F.F.I. et prend part à divers combats, dans le Sud-Ouest, avant de réintégrer la Gendarmerie en fin d’année 1944.
La seconde affaire se déroule en 1943 dans la légion du Berry. Le 3 août 1943, l’antenne du Sipo/Sd d’Orléans, installée à Bourges, agissant à la suite d’une dénonciation, découvre à Sancoins (Cher) 40 containers d’armes, munitions et explosifs dissimulés dans un local à usage de bûcher loué par le gendarme Lamy de la brigade motorisée.
Au moment de la perquisition, ce militaire se trouve à Laval-de-Cère (Lot) où il participe à des opérations de maintien de l’ordre. Le 4 août, le capitaine Bretheau, commandant provisoirement la compagnie du Cher, à Saint-Amand-Montron, convoque ce gendarme en vue de recueillir ses explications. Mis en route le 5 au matin, par voie ferrée, Lamy télégraphie à ses chefs, depuis Brive-la-Gaillarde, qu’il a manqué sa correspondance et n’arrivera que le lendemain en début de journée. Conscient du danger qui le guette, il cherche à gagner du temps. En fait, il déserte et rejoint un refuge sûr pour échapper aux recherches. La diffusion de son signalement, à tous les services de Police et de Gendarmerie, ne permet pas de le découvrir. Aux Rousses (Jura), où résident ses parents, les gendarmes effectuent en vain des vérifications.
Pendant ce temps, le commandant de compagnie, qui ignore les charges relevées contre son subordonné, se rend auprès de la police allemande pour se renseigner. Le chef de service de la sûreté allemande, très évasif, lui indique seulement que, outre Lamy, deux autres gendarmes sont compromis dans cette grave affaire de dépôt d’armes, qu’en tout état de cause leur nom ne sera pas dévoilé avant que le général Oberg et Bousquet n’aient été prévenus.
L’officier se rend dans le Lot pour y interroger les gendarmes du peloton motorisé de Sancoins. Tous affirment ne rien savoir sur les armes découvertes.
De retour à Saint-Amand, le capitaine Bretheau trouve deux policiers allemands dans son bureau. Sans autre explication, ces derniers exigent que l’on mette à leur disposition les gendarmes Lamy, Vitoux et Satin. Si Lamy, en fuite, échappe à la police nazie, ce n’est pas le cas de Vitoux et de Satin, interpellés par la Gestapo le 9 août.
Le 7 septembre, les deux sous-officiers comparaissent devant le tribunal de guerre de la Feldkommandantur de Bourges. Le déroulement du procès fait apparaître qu’ils ont participé à la réception de plusieurs parachutages et transports d’armes. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1943, la R.A.F. largue une quarantaine de containers dans la région de Givardon. Satin et Lamy assurent la sécurité des équipes de ramassage. Vitoux, permissionnaire, n’y participe pas mais il est présent au cours d’une seconde opération qui se déroule dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Avec Satin et deux autres résistants, il convoie le matériel parachuté à Sancoins et le stocke dans le bûcher du gendarme Lamy absent. Les juges, comme on pouvait s’y attendre, prononcent la peine capitale à l’encontre des prévenus.
L’arrestation de Vitoux et Satin faisait suite à une série d’interpellations de militaires de l’Arme pour des faits similaires, notamment dans la région d’Angers et de Saumur. Pour éviter des mesures extrêmes à leur égard, la direction de la Gendarmerie décide d’adresser au général Oberg la proposition suivante : en échange de la grâce de Vitoux et Satin, les unités de Gendarmerie rechercheraient et remettraient aux autorités allemandes toutes les armes qui avaient pu être cachées depuis l’armistice, susceptibles d’être retournées contre les troupes d’occupation. L’émissaire de la direction, M. Nouvel, délégué du directeur général, se rend fin septembre à Paris où il rencontre le général Oberg. Ce dernier accepte la transaction. La commutation de peine pour les gendarmes Satin et Vitoux semble acquise.
Moins d’un mois après l’entrevue, les événements se précipitent. Fin octobre 1943, les Kommandeurs régionaux rendent compte à Oberg du résultat décevant des saisies d’armes, provenant de dépôts clandestins, opérées dans leur ressort par la Gendarmerie. Il s’agit d’un armement léger, hétéroclite, en partie inutilisable et rouillé par suite d’un séjour prolongé dans des pièces d’eau ou rivières. La colère du chef supérieur des SS est telle qu’il exige, par lettre du 30 octobre, la révocation de M. Nouvel.
Quelques jours plus tard, le 5 novembre, le général Martin lui adresse l’état récapitulatif de l’armement récupéré en zone sud par les gendarmes. Le chef des SS en France accuse réception de ce courrier le 9 novembre et annonce son intention de proposer une mesure de clémence pour les deux gendarmes condamnés à mort afin de récompenser les efforts de ceux « certainement nombreux qui ont manifesté leur volonté de dénoncer les dépôts clandestins d’armes et de munitions. »
Par bordereau d’envoi en date du 12 décembre 1943, la direction de la Gendarmerie diffuse pour information, aux commandants de légion, la lettre d’Oberg en les invitant « à souligner, auprès des officiers, gradés et gendarmes que cette mesure de clémence a pu être obtenue grâce à l’esprit de solidarité dont ils ont tous fait preuve. »
Le comportement d’Oberg, dans cette affaire, relève plus de l’imposture et de la perfidie que de la magnanimité. La genèse des événements le prouve. Le 5 octobre 1943, malgré sa promesse initiale, alors que l’opération de récupération d’armes est en cours, le sort des gendarmes Satin et Vitoux est scellé. Le commandant de compagnie du Cher alerte la section Gendarmerie des territoires occupés de l’imminence de leur exécution prévue le lundi 7 au petit matin.
Le chef d’escadron Sérignan décide d’agir immédiatement. Vitoux et Satin appartiennent au moment de leur arrestation à la brigade de Sancoins, située en zone sud, qui ne relève pas de la compétence de la section Gendarmerie. Invoquant le fait qu’ils étaient emprisonnés à Bourges, en zone nord, le chef d’escadron Sérignan obtient des autorités allemandes l’autorisation de les prendre en charge. D’urgence, il demande une entrevue au général Oberg.
Le numéro 2 de la police allemande, le colonel Knochen, le reçoit vers midi. Après un entretien extrêmement serré de plus de deux heures son interlocuteur le rassure sur le sort de Vitoux et Satin. Il lui donne l’assurance qu’ils auraient la vie sauve.
Étant donné que les Allemands pratiquaient la semaine anglaise, le chef d’escadron Sérignan craint que l’ordre concernant la grâce des deux gendarmes n’arrive trop tard à Bourges. Il téléphone immédiatement à la Gendarmerie. En l’absence du commandant de compagnie, son adjoint, le capitaine Muraton, lui répond. Après l’avoir mis au courant de la situation, il lui demande d’intervenir d’urgence auprès du général chef de la Kommandantur pour lui faire part de la décision des autorités de police allemande. L’officier, sans perdre un instant – il est à ce moment-là 18 heures – se rend à la Feldkommandantur. Écoutons son récit :
« Après avoir parcouru différents locaux, je finis par trouver un oberleutenant de service. Lui ayant demandé de m’indiquer où je serais susceptible de joindre le général pour une question d’extrême gravité, il me demanda de lui exposer les raisons qui motivaient ma démarche. À peine ai-je eu le temps de parler des gendarmes qu’il me dit que c’était un grand malheur, que l’exécution était fixée au lundi matin et que, justement, il avait reçu l’ordre de faire le nécessaire.
Lorsque je pus lui dire qu’un sursis avait été accordé, il se mit à ma disposition pour trouver le général. Nous partîmes en automobile, l’oberleutenant et moi, à la recherche de cet officier. Vers vingt heures, nous apprîmes qu’il était à la chasse. L’oberleutenant m’invita alors à établir une demande écrite, me promettant de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour que le mot parvienne à temps à son chef… »
Ne possédant sur lui aucune feuille de papier, le capitaine Muraton prend une de ses cartes de visite sur laquelle il écrit :
« Ordre au général commandant la place de surseoir à l’exécution des gendarmes Vitoux et Satin. Confirmation sera donnée par Paris. »
Le feldkommandant, à son retour, annule les ordres donnés si bien que les gendarmes ne sont pas fusillés, comme prévu, à l’aube. Le contrordre d’Oberg ne parviendra à la Feldkommandantur que le lundi vers 10 h 30. Comment s’explique ce contretemps qui pouvait leur être fatal ? Y a-t-il eu manque de coordination entre les services d’Oberg et le commandement militaire local ? Rien ne permet d’y croire lorsqu’on sait que des détenus, pourtant graciés, avaient été exécutés dans les mois précédents. L’initiative du chef d’escadron Sérignan et du capitaine Muraton avait permis de déjouer le funeste dessein des SS.
Dans l’après-midi du 7 octobre, le général commandant la Feldkommandantur convoque à son bureau le chef d’escadron commandant la compagnie du Cher et lui reproche la façon d’agir de son adjoint : capitaine, il avait donné des ordres à un général !
Quelques mois plus tard, la Gestapo arrête le capitaine Muraton, membre de la Résistance. L’officier est déporté. Rescapé des camps de la mort, il rentre en France en 1945. Son action dans la clandestinité lui vaut la médaille de la Résistance et la Légion d’honneur.
Que deviennent, après le 7 octobre, les gendarmes Vitoux et Satin ? Les Allemands ne leur accordent qu’un bref répit. Quelques semaines plus tard, ils sont déportés en Allemagne. À la mi-avril 1945, le camp où ils se trouvent est sur le point d’être libéré par les Russes. Les SS l’évacuent précipitamment. Commence alors pour les survivants une épuisante marche à pied. Les gardiens emmènent Vitoux, malade et exténué, sur un camion et l’exécutent le 30 avril. Pour Satin, son compagnon d’infortune, le cauchemar s’achève avec l’arrivée des Alliés.
La troisième affaire met en scène des gendarmes de la légion d’Anjou. Du 7 au 10 février 1944, un Conseil de guerre siégeant à Paris, à l’hôtel Continental, rue Castiglione, juge 11 officiers, gradés et gendarmes inculpés « d’intelligence avec l’ennemi ». Plusieurs, tel le chef d’escadron Caron, appartiennent au réseau de renseignements « Centurie », de la région de Saumur, démantelé courant septembre et octobre 1943 par le S.D. d’Angers.
Au cours de l’interrogatoire, tous les accusés, arrêtés en flagrant délit, reconnaissent, il ne pouvait en être autrement, les actes qui leurs sont imputés : participation à la réception de parachutages et détention d’armes de guerre. Le capitaine Royer, commandant la section de Saumur, couvre avec courage ses subordonnés. Il affirme qu’ils ont simplement exécuté ses ordres et qu’en conséquence il est seul coupable.
Le chef de la section Gendarmerie, qui a obtenu l’autorisation de déposer, reprend la déclaration de l’officier incriminé tendant à mettre hors de cause les gradés et gendarmes. Il considère que le tribunal ne saurait leur reprocher d’avoir obéi à leur chef. À la question que lui pose le président pour savoir si un militaire de la Gendarmerie peut s’adresser à l’autorité supérieure, lorsqu’il constate un comportement anormal dans le service de l’officier dont il relève directement, il répond que la chose est possible mais que toute réclamation implique le respect de la voie hiérarchique, règle absolue inscrite dans les règlements. Un des officiers assesseurs souffle alors à voix basse au président : « C’est exactement comme chez nous ». Toujours à la décharge des sous-officiers, le chef d’escadron Sérignan explique aux juges qu’en entrant dans la Gendarmerie ils avaient prêté serment et qu’en cas de violation de ce dernier ils étaient passibles du tribunal militaire. Pour conclure la première partie de son intervention, il souligne avec force qu’il serait grave de prendre des mesures extrêmes à l’égard d’un personnel sur qui reposait la sécurité des populations et le maintien de l’ordre.
Restait le cas du capitaine Royer. Pour minimiser sa responsabilité, le chef de la section Gendarmerie rappelle la présence, dans l’arrondissement de Saumur, de la maison d’arrêt de Fontevrault où était détenus de dangereux malfaiteurs. En cas de révolte ou d’évasions massives, la Gendarmerie n’aurait pu s’y opposer efficacement en raison de son armement insuffisant. Conscient du danger que cette situation engendrait, le capitaine Royer avait conservé les armes recueillies pour accroître la valeur opérationnelle de ses brigades.
Maître Haenning, avocat à la cour de Paris et Alsacien d’origine, chargé de la défense des gendarmes, plaide ensuite en allemand. D’abord, il montre qu’il s’agit d’un procès de tendance car seuls des gendarmes et des fonctionnaires de police se trouvent sur les bancs de l’accusation alors que les civils impliqués dans la même affaire sont absents. Sans doute ignore-t-il, à ce moment-là, que les Allemands disjoignent, en règle générale, le cas des agents de l’État de celui des civils. Ces derniers d’ailleurs ne sont pas toujours jugés. Sans formalité, la Gestapo emprisonne, exécute et déporte. Il développe ensuite l’argument selon lequel les membres de la Police française n’étaient pas obligés de faire connaître, aux services de sécurité allemands, les renseignements qu’ils détenaient sur les groupes de résistance nationale. En effet, les directives relatives à la coopération des polices ne le prévoyaient pas expressément. Pour clore sa plaidoirie, Maître Haenning reprend les éléments exposés par le chef d’escadron Sérignan et lance un appel à la clémence du tribunal.
Le Conseil de guerre prononce 10 condamnations (7 à mort, 3 à sept ans de réclusion) et 1 acquittement. La section Gendarmerie obtient 7 commutations de peine de mort.
Le 13 août 1944, les dix officiers et sous-officiers détenus à Fresnes sont déportés en Allemagne. La tentative d’évasion organisée par le chef d’escadron Sérignan et son adjoint, le capitaine Rombach, en liaison avec Monsieur Adam, sous-chef de gare principal à Paris-est, échoue malheureusement.
Alors que la libération des camps est imminente, le chef d’escadron Caron, l’adjudant Boisse et le gendarme Boulme disparaissent à quelques jours d’intervalle, fin mars 1945, victimes de la dysenterie. Mystérieux sont les chemins de la destinée, tous trois avaient été condamnés à 7 ans de réclusion. Quant aux condamnés à mort, très affaiblis, ils rejoignent la France dès l’arrivée des Alliés.
Mécontent du déroulement du procès, Oberg, au mois de mars 1944, rappelle Darnand à l’ordre. Il n’admet pas que les défenseurs des policiers et gendarmes jugés devant le Conseil de guerre du grand Paris se soient appuyés, pour les innocenter, sur le texte des accords de coopération des polices conclus en 1942. Oberg évoque l’article III de la convention d’armistice, base immuable des rapports entre les polices allemandes et françaises. Et de souligner vigoureusement les « engagements du Gouvernement français » d’apporter, pour tous les moyens, son appui aux ordonnances des autorités d’occupation et de les appliquer avec l’aide de l’administration française.
À son retour d’Allemagne, imité en cela par tous ses camarades de déportation, le gendarme Eudes, de la brigade de Conlié (Sarthe), un des condamnés à mort du 7 février, rend hommage au chef de la section Gendarmerie des territoires occupés :
« J’ai été défendu, pendant le jugement, par le lieutenant-colonel Sérignan… Cet officier supérieur ayant eu l’autorisation de faire une déposition a employé tous les arguments possibles en ma faveur pour me défendre devant ledit tribunal et pour essayer d’obtenir ma commutation de peine par la suite… »
Dans des affaires antérieures, courant 1941 et 1942, les Allemands se déjugent en exécutant un officier et un gendarme dont ils avaient commué la peine de mort en détention à la suite des requêtes établies par la section Gendarmerie.
Le 25 novembre 1941, à 7 heures du matin, la Gestapo appuyée par la Feldgendarmerie arrête le capitaine Descamps, commandant la section de Soissons, dans son logement de fonction, rue des Francs-Boisiers. Depuis septembre 1940, il appartient au groupe de résistance « Vérité française ». La Gestapo qui a infiltré un indicateur dans le mouvement n’ignore rien de son action clandestine. Conduit à la prison de Fresnes, il y est mis au secret pendant plus de cinq mois. Soumis à de multiples interrogatoires, jamais la police allemande n’obtient de lui la moindre information qui puisse mettre en péril ses compagnons.
S’adressant à Madame Descamps, le 21 avril 1942, avant l’ouverture du procès, le chef d’escadron Sérignan écrit :
« Suivant les renseignements qui viennent de me parvenir, le procès du capitaine Descamps s’ouvrira d’ici une quinzaine de jours. J’ai pris toutes dispositions utiles pour que maître Heanning soit autorisé à plaider par les autorités allemandes. Je lui donnerai d’ailleurs, dès qu’il aura reçu l’agrément nécessaire, tous les renseignements complémentaires lui permettant d’étayer solidement la défense. Le dossier de votre mari porte le numéro 96. Je vous donne cette précision parce que je crois qu’elle pourra vous être utile pour lui remettre des colis. »
Le 4 mai, il annonce à Madame Descamps que son mari est sur le point de comparaître en jugement :
« Ce jour même, je dois voir l’avocat qui défendra votre mari et nous mettrons au point un plan de défense. Vous allez avoir à vivre des heures pénibles, mais je suis persuadé que vous ferez preuve, ainsi que le capitaine Descamps, du courage que j’ai pu apprécier en vous. Je puis vous assurer que, de notre côté, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à défendre votre mari dans son procès. »
Le 30 mai 1942, le tribunal militaire allemand du Gross-Paris, qui siège à Fresnes, condamne le capitaine Descamps à la peine de mort pour « intelligence avec l’ennemi ». À son fils aîné, Pierre, qui lui rend visite le 1er juin avec sa mère et ses deux frères, il glisse un billet ainsi libellé :
« Allez voir Sérignan, commandant Le Dall. Appuyez pour grâce. »
Le chef d’escadron Sérignan ne reste pas inactif. Le 3 juin, il rend visite au prisonnier. Dès le lendemain, il écrit à Madame Descamps pour lui annoncer les dispositions qu’il a prises :
« Je lui ai fait part de toutes les démarches que nous avions déjà entreprises et lui ai donné des paroles d’espoir qui ont paru lui faire beaucoup de bien.
Par ailleurs, je lui ai demandé tous renseignements complémentaires qui me permettront de rendre encore plus efficace sa défense. À ce sujet, la délégation générale a accepté de transmettre, comme complément au premier recours en grâce, les renseignements que j’ai pu obtenir et qui sont intéressants… »
Alors que l’officier attend tous les jours la mort et que la demande de recours en grâce semble vouée à l’échec, survient l’événement inespéré. Début septembre, le commandement militaire en France annonce officiellement à la délégation générale que la peine de mort prononcée le 30 juin par le tribunal du Gross-Paris, à l’encontre du capitaine Descamps, est commuée en 20 ans de forteresse.
Son départ pour l’Allemagne est fixé au 14 septembre. Le chef d’escadron Sérignan confirme cette décision à Madame Descamps début octobre.
Comme l’atteste un document découvert par Pierre Descamps dans les archives allemandes, au lendemain de la guerre, le général Stulpnagel a en fait ratifié le 22 août 1942 le jugement initial, contrairement à ce qu’il a annoncé à la délégation générale.
Successivement incarcéré dans les prisons de Karlsruche, Rheinbach, Sonnenburg, les Allemands transfèrent l’officier à Görden le 4 décembre 1942. Le lendemain à 5 h 21, le bourreau vient le chercher dans sa cellule. Il est ensuite décapité à la hache dans la forteresse de Brandebourg. Le 27 mars 1943, Madame Descamps reçoit d’Allemagne un colis contenant des objets et des vêtements qui appartenaient à son mari. Sinistre présage. Elle n’apprendra officiellement sa mort qu’en décembre 1945.
Toute aussi vaine est l’action entreprise par la section Gendarmerie pour arracher à la mort le gendarme Charlot de la légion de Champagne. En poste à la brigade de Reims, ce sous-officier appartient depuis le 1er septembre 1941 au réseau SR Kléber-Uranus. À la suite de la trahison d’un de ses agents de renseignements, la Gestapo l’arrête le 14 août 1942. Le 1er octobre, le tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur de Châlon-sur-Marne le condamne à mort pour espionnage.
Le commandant des forces militaires en France, à la suite du recours en grâce établi par la section Gendarmerie, prononce la commutation de la peine. Une libération n’est pas exclue si les Allemands acceptent, comme la demande en a été faite, de l’échanger contre un espion du Reich. En attendant une décision, le condamné est transféré en Allemagne, à la prison de Reinbach puis à celle de Cologne.
Le 29 octobre 1942, le général Keitel qui a été saisi du dossier s’oppose à l’opération de substitution. Deux mois plus tard, le 4 janvier 1943, à 20 heures, le gendarme Charlot est exécuté.
Comment, à travers le récit de sa mort, ne pas honorer sa mémoire. Son destin s’achève dans la petite cour de la prison de Cologne, cour couverte, entourée de murs, à l’abri de tout regard indiscret. Au milieu, se trouve une table recouverte d’un drap noir sur laquelle sont posées deux bougies allumées et un crucifix. En face de la table, dans la partie arrière, caché par un rideau rouge, le matériel d’exécution. À 20 heures précises, les gardiens conduisent le gendarme Charlot, les mains liées dans le dos, devant le procureur entouré d’un juge, du représentant du directeur de la prison et d’un médecin. Sur ordre du procureur, le gendarme prend place devant la table puis décline son identité après quoi le bourreau reçoit l’ordre d’exécuter le jugement du Conseil de guerre. Au même moment, on retire le rideau rouge. Le matériel d’exécution devient visible. Les trois aides et le bourreau prennent leur place respective. Ils emmènent le condamné à l’appareil d’exécution et le poussent sur ce dernier, la tête en bas. Le bourreau l’exécute alors à la hache. L’opération, chronométrée, à duré 18 secondes. Durant le lugubre cérémonial qui a précédé sa mise à mort, le gendarme Charlot, très digne, n’a pas proféré une parole. Il meurt en faisant preuve d’un courage exemplaire.
Les efforts de la section Gendarmerie pour sauver le premier gendarme condamné à mort, pendant l’Occupation, seront vains. Le 30 décembre 1941, le tribunal de guerre de la Feldkommandantur d’Amiens condamne à la peine capitale le gendarme Maxime Garin, de la 2e légion, pour son action en faveur de la Résistance. Le chef d’escadron Sérignan, informé du verdict, une heure avant que l’intéressé ne soit passé par les armes, tente immédiatement une intervention auprès du général Stulpnagel. Le trop court délai imparti ne lui permet pas de mener à bien son entreprise.
* *
*
Grâce aux diligences de la section Gendarmerie, des militaires de l’Arme, emprisonnés par les Allemands sur le territoire français ou déportés outre-Rhin, sont libérés.
Au cours du second semestre de l’année 1941, la Gestapo, sur les indications d’un traître, réussit à infiltrer le sous-réseau de renseignements mis sur pied par le chef d’escadron Vérines de la Garde de Paris. Son organisation, rattachée au réseau Saint-Jacques de la France Libre, créé par Maurice Duclos, couvre la région de Paris, les côtes de la Manche et de la Normandie. Parmi les 600 personnes interpellées par la police allemande figurent 14 officiers et sous-officiers de Gendarmerie. À l’exception du capitaine Morel, commandant la section de Tours, de l’adjudant Pinault de la brigade de Bléré, du capitaine Martin de l’école préparatoire de Romans, arrêtés respectivement les 25 juin 1941, 2 août 1942 et 4 février 1943, tous les autres sont incarcérés en octobre 1941 : colonel Boillin, commandant la légion de Picardie, colonel Raby, commandant la légion de Touraine, lieutenant Laurent, de la légion de Touraine, chef Legrand, gendarmes Valencelle, Raymond, Provins, Carette de la brigade de Beauval (Somme), le Guern, de la Gendarmerie auxiliaire de l’Eure, capitaine Le Flem, commandant la section de Pont-L’Evêque (Calvados).
Les charges qui pèsent sur le chef d’escadron Vérines, le colonel Raby, les capitaines Morel et Martin entraînent leur traduction devant un tribunal du peuple allemand dont le verdict est impitoyable. Tous les quatre sont fusillés, en octobre 1943, à Cologne.
Aucune preuve n’a pu être établie sur l’activité clandestine des autres militaires internés en Allemagne dans le cadre de la même affaire, aussi la section Gendarmerie réclame inlassablement leur retour aux autorités allemandes qui reconsidèrent leur situation. Le 15 août 1942, le capitaine Le Flem et le gendarme Le Guern sont ramenés en France. Après deux ans de détention, en septembre 1943, le colonel Boillin, le chef Legrand, les gendarmes Valencelles, Raymond, Provins et Carette retrouvent à leur tour la mère patrie. Seul, le lieutenant Laurent n’est pas libéré. Les Alliés le délivrent le 27 avril 1945.
Autres interventions positives de la section Gendarmerie, celles qui aboutissent à l’élargissement d’officiers et de gradés sanctionnés par l’occupant en raison de leur mauvaise volonté à coopérer.
Que reproche-t-on au capitaine Vercher, commandant la section de Nantua (Ain), pris en otage le 14 décembre 1943 et dirigé vers l’Allemagne ? Le 6 décembre, ses gendarmes ne se sont pas rendus sur les lieux d’une agression commise par des « terroristes ». Ces derniers, sous le regard complice de la population, ont traîné dans les rues de Nantua et d’Oyonnax, après l’avoir déshabillé, un couple de collaborateurs notoires.
L’avis du Kommandeur du SD de Lyon daté du 14 décembre et affiché dans les deux agglomérations, après une brève relation des faits, conclut :
« En conséquence, le capitaine de Gendarmerie, Monsieur le maire de Nantua et deux gendarmes d’Oyonnax ont été arrêtés. Ils séjourneront jusqu’à la fin de la guerre dans un camp de concentration en Allemagne. En outre, 150 hommes de Nantua entre dix-huit et quarante ans seront menés pour la durée de la guerre dans un camp de travail en Allemagne. »
Par la lettre n° 269/4 du 15 janvier 1944, la Gendarmerie lui fournit des explications afin de dégager la responsabilité de l’officier. La démonstration, pour l’innocenter, s’appuie sur deux faits. Au moment de l’incident, un gendarme seulement était présent à la caserne occupé à des écritures. Les autres assuraient un service qui ne leur permettait pas de savoir ce qui se passait en ville. Quant au commandant de section, en mission loin de Nantua, dès sa rentrée à la résidence, après avoir pris connaissance des faits, il n’avait pas manqué de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour que l’enquête soit effectuée dans les meilleures conditions.
Cette démarche initiale s’avère infructueuse. La section Gendarmerie s’adresse alors, en dernier recours, à Oberg auquel elle demande « d’envisager la remise en liberté de l’officier ». Elle lui signale par ailleurs « que le capitaine Vercher a une fille de 21 ans, mariée depuis quatre mois, dont l’époux figure au nombre des 150 hommes emmenés en Allemagne. »
Quelques semaines plus tard, courant mars, le commandant de section est libéré. C’est un allié des maquisards. Bien avant son arrestation, il est en liaison avec le colonel Romans Petit, chef des maquis de l’Ain. En novembre 1943, il fournit au préfet des informations erronées pour provoquer le rassemblement de toutes les forces de police à Nantua à l’occasion de l’anniversaire de la Victoire. L’attention des autorités ainsi détournée, les maquisards de l’Ain défilent à Oyonnax le 11 novembre.
En mars 1943, la police allemande emprisonne le capitaine Raiffaud, commandant la section de Poitiers, et le chef Largeaud, de la brigade de Vivonne. Un avion anglais ayant atterri dans la région de Marnay, ils n’ont pas signalé aux autorités la présence sur les lieux de deux témoins. La section Gendarmerie plaide leur bonne foi si bien qu’ils sont libérés moins d’une semaine après leur incarcération. Néanmoins, elle ne peut s’opposer à la mutation du capitaine exigée par l’occupant.
Beaucoup plus élevé est le nombre de gendarmes, menacés d’arrestation par l’occupant, qui échappent à la capture grâce à la complicité de la section Gendarmerie. À deux reprises, le capitaine Martin, membre du réseau Vérines, est sur le point d’être arrêté. Commandant la section de Loches (Indre-et-Loire), il profite de ce que la ligne de démarcation traverse sa circonscription pour faciliter le passage à tous ceux qui sont traqués par les Allemands et la police de Vichy. En octobre 1942, par mesure de précaution, la section Gendarmerie le fait muter à Châteauroux en qualité d’adjoint au commandant de la légion du Berry. Il n’en continue pas moins ses activités clandestines. Pour le soustraire à de nouveaux dangers, il reçoit une nouvelle affectation à l’école de Romans. La Gestapo, qui ne relâche pas sa surveillance, l’arrête le 4 février 1943. Il rejoint en déportation ses frères de combat.
Le capitaine Bouillie, nommé en 1941 au commandement de la section de Montpellier, en raison des dangers que lui faisait courir son action patriotique en zone nord, échappe à l’occupant et continue la lutte au sein de la légion du Languedoc.
Des militaires, rarement il est vrai, refusent, pour des motifs qu’ils ne peuvent ouvertement faire connaître, l’aide qu’on leur propose pour échapper aux Allemands. Homme de conviction, le chef d’escadron Guillaudot est un de ceux-là. À la suite de l’assassinat d’un de leurs officiers, au camp de Coëtquidan, le 1er novembre 1943, les Allemands réagissent vigoureusement. En deux jours, ils prennent en otages 80 personnes et les emprisonnent à Vannes. Il est question d’en fusiller un grand nombre. Au moment des faits, le commandant de la compagnie du Morbihan se trouve en permission à Rennes. Prévoyant ce qui allait se passer, sans attendre la fin de son congé, il reprend son service et participe à l’enquête. Exploitant des fautes professionnelles commises par les policiers allemands au cours de leurs investigations, le chef d’escadron Guillaudot défend obstinément la thèse du « crime impossible ». Il exige et obtient une reconstitution sur les lieux mêmes du drame, à la suite de laquelle il adresse aux autorités françaises et allemandes un rapport circonstancié, avec croquis à l’appui, tendant à prouver qu’il s’agissait, soit d’un suicide, soit d’un accident de chasse, alors qu’il y avait bien eu crime. Le doute s’installe chez les Allemands. Moins de dix jours plus tard, ils libèrent tous les otages.
Dans la semaine qui suit, le commandement de la Gendarmerie apprend que les autorités allemandes, très irritées de l’attitude du chef d’escadron Guillaudot pendant l’enquête, envisagent son arrestation. Le général G…, inspecteur de la Gendarmerie de la région de Paris, de concert avec la section Gendarmerie, propose à l’officier de le muter en zone libre où trois postes lui sont offerts.
L’intéressé décide de rester à Vannes malgré les risques qu’il encourt. Pourquoi ce refus ? Depuis qu’il a pris son commandement, fin juin 1941, il a entraîné dans la Résistance toutes ses brigades avec leurs cadres, à l’exception de trois officiers sur quatre. Il tient à poursuivre avec ses hommes l’œuvre ainsi entreprise conformément aux directives qu’il leur a données de se conduire en soldats et en Français :
« En soldat : ne pas faillir à l’honneur militaire et se préparer à reprendre les armes pour libérer le pays.
En Français : ne rien faire contre nos compatriotes, au contraire les aider, les défendre de toutes nos forces, même à leur insu. »
Aucun moyen n’est négligé pour venir en aide aux personnels en difficulté. Le chef d’escadron B…, accrédité auprès du général commandant le district de Saint-Germain-en-Laye avait réussi à obtenir de transmettre lui-même, avec son avis, les demandes de laissez-passer pour la zone libre. Inutile de dire que son intervention a permis à de nombreuses personnes d’éviter l’arrestation en passant, en temps utile, en zone sud.
La section Gendarmerie a recours à lui, en 1941, à l’occasion d’une affaire mettant en cause plusieurs gendarmes. Pendant la campagne de 1939-1940, dans l’est de la France, la D.C.A. abat un avion allemand au-dessus d’une agglomération. Les aviateurs sautent en parachute. La population les moleste dès qu’ils arrivent au sol. La prévôté, stationnée dans la localité, n’intervient pas immédiatement.
Dès leur installation en zone nord, les Allemands identifient les gendarmes qui appartenaient à cette formation. Les uns servent dans des brigades de la région de Nice. La ligne de démarcation les met à l’abri de toute mauvaise surprise. Les autres, au nombre de cinq, sont en poste à la brigade de Boussat (Creuse).
Alors qu’ils sont sur le point d’être arrêtés par la Feldgendarmerie, le chef de la section Gendarmerie, qui en a eu connaissance, demande au chef d’escadron B… de lui procurer d’urgence des laissez-passer. En même temps, il prend les dispositions nécessaires pour les affecter en zone sud. À peine ont-ils quitté leur résidence que les feldgendarmes se présentent à la brigade pour les interpeller. Ils ne poursuivent pas davantage leurs recherches lorsqu’ils apprennent que les cinq gendarmes servent en zone libre et que le général commandant le district de Saint-Germain-en-Laye leur a délivré les autorisations requises pour s’y rendre.
Des civils, traqués par la police, trouvent assistance auprès de la section Gendarmerie. En mai 1944, le commissariat du 1er arrondissement découvre au domicile de M. L… T… directeur de la compagnie générale de Grande Pêche, membre d’un réseau de résistance, deux aviateurs alliés, l’un anglais, l’autre américain. Il n’a pas d’autre solution pour échapper à l’arrestation que de passer dans la clandestinité. La section Gendarmerie, avec laquelle il est en relation depuis 1942, lui fournit une carte d’identité et pourvoit à son hébergement dans la capitale.
« Il est certain, écrira-t-il plus tard, que sans cette aide immédiate je n’aurais pu échapper longtemps à l’ennemi ni rejoindre les lignes alliées après le débarquement. »
Dans ce temps d’épreuve, la sollicitude manifestée par la section Gendarmerie à l’égard des personnels exposés à des périls graves, du fait de l’occupant, montre que le lien d’appartenance à la communauté gendarmique reste très fort, même si quelques officiers et gendarmes, ici et là, se désolidarisent d’avec leurs camarades en difficulté.
De l’avènement du maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, au 2 juin 1942, la Gendarmerie réorganise son dispositif non seulement dans les territoires occupés, mais aussi en zone libre où, en apparence, les accords d’armistice sauvegardent l’autonomie du Gouvernement, de son administration et de la force publique.
Pour adapter l’Arme au nouvel état du pays doté d’institutions rénovées, partiellement sous la botte étrangère, coupé en deux par la ligne de démarcation et contraint de respecter les dispositions de la convention d’armistice, la direction entreprend, dès le mois de juillet 1940, une série d’aménagements et de transformations qui modifient sensiblement sa physionomie antérieure.
III – LA GENDARMERIE DE L’ÉTAT FRANÇAIS
CHAPITRE 7 – L’ADAPTATION
Comme sous la IIIe République, la Gendarmerie conserve son caractère militaire. Son appartenance aux armées la place sous l’autorité du ministre secrétaire d’État à la Guerre, y compris en zone nord, malgré l’opposition des Allemands et grâce à l’artifice imaginé par la section Gendarmerie (rattachement fictif de l’Arme à la délégation générale).
Par contre, sa subordination à l’état-major de l’armée cesse avec son intégration dans une direction générale des services administratifs coiffée par le contrôleur général Lachenaud. Ce changement répond au souhait exprimé, en pleine débâcle, fin juin 1940, par M. Léonard.
Le département de la Guerre lui fournit toujours l’essentiel de sa logistique : service de santé, service social, intendance, génie, etc.
Les généraux commandants les régions militaires, en zone libre, continuent d’exercer leurs prérogatives, en matière d’avancement comme au plan disciplinaire, sur ses échelons territoriaux. En zone occupée, le général représentant le ministre secrétaire d’État à la Guerre a les mêmes attributions envers la Gendarmerie. Lorsque courant juillet 1941, il convoque à Paris le chef d’escadron Guillaudot pour l’entendre sur les incidents survenus au cimetière de l’est, à Rennes, le 17 juin 1941, il est tout à fait dans son rôle.
Que s’est-il passé ce 17 juin ? Ce jour-là, la population de Rennes se rend en masse sur les tombes des victimes du bombardement de l’année précédente afin d’en commémorer le souvenir. Pour complaire aux Allemands, le préfet décide de fermer le cimetière pendant trois jours. Il prend un arrêté dans ce sens. Des gendarmes, au nombre d’une centaine, sont requis pour renforcer la police de Rennes. La manifestation se déroule sans incident jusqu’au moment où le représentant du préfet, en l’occurrence son secrétaire général, donne l’ordre aux policiers et aux gendarmes de disperser la foule et de procéder à des arrestations. Le chef d’escadron Guillaudot refuse d’obtempérer à la réquisition, imité en cela par M. Dives, commissaire de police. Le préfet, dans les heures qui suivent, demande sa révocation. Quarante-huit heures après, il obtient sa mutation de Rennes à Vannes.
Le chef d’escadron Guillaudot expose au représentant du ministre les raisons qui ont motivé sa décision. Le général lui signifie qu’il va être obligé de lui infliger trente jours d’arrêts de rigueur pour « refus d’obéissance aux ordres du Gouvernement. »
Pour l’essentiel, l’organisation de la direction du Contentieux, de la Justice militaire et de la Gendarmerie ne diffère pas de celle d’avant les hostilités. L’implantation de l’administration centrale en Auvergne, où elle est installée dans des conditions précaires à Romagnat, Chamalières et Vichy, n’offre pas les mêmes avantages que dans la capitale. Bien que les possibilités de logement soient limitées – l’agglomération de Vichy, en quelques mois, est passée de vingt mille à cent mille âmes – elle parvient progressivement à regrouper ses services. En fin d’année 1943, elle occupe à Vichy les hôtels d’Aix, Chambéry, la Tour-d’Auvergne et Bourgeon.
L’État français maintient à sa tête M. Chasserat nommé au poste de directeur le 4 juillet. Ce haut fonctionnaire a débuté sa carrière, le 1er janvier 1924, au Conseil d’État où il a servi successivement en qualité d’auditeur puis de commissaire du Gouvernement pendant cinq ans. En outre, il a professé à l’école des Sciences politiques et assumé des responsabilités importantes au sein d’organismes internationaux et dans des cabinets ministériels. S’il est personnellement comptable de la Gendarmerie pour toutes les questions techniques, en revanche, quant à l’emploi, il dépend exclusivement de l’autorité de Bousquet, secrétaire général à la Police, comme le confirme la note établie le 4 juillet 1942 par le SS Sturmbamführer Hagen à l’issue d’un entretien entre Obert et Bousquet.
Le 16 mai 1942, la direction étoffe le haut commandement en créant une inspection générale de la zone sud, à Royat (Allier), confiée au général Durand. Celui-ci dispose d’un état-major réduit et d’une section « études ». Le général Fossier, promu divisionnaire, le remplace le 28 août 1943. À la même époque, une inspection générale de la zone nord voit le jour, avec à sa tête le général Balley. Elle s’installe 12, rue du Béarn, à Paris dans le 13e. La Gendarmerie d’Afrique du Nord relève d’un troisième inspecteur général.
Les difficultés de déplacement d’une zone à l’autre, mais surtout le caractère particulier de certains problèmes, qui se posaient dans chacune d’elles, justifiaient une centralisation des renseignements que les inspecteurs d’arrondissements n’étaient pas en mesure de réaliser car leur compétence territoriale ne s’étendait pas à l’ensemble d’une zone. D’où l’idée de mettre en place cette nouvelle structure.
Rattachés directement au ministre secrétaire d’État à la Guerre, les inspecteurs généraux exercent le contrôle des légions, compagnies, écoles dans leurs zones respectives. Sur ordre du ministre, ils procèdent aux études particulières que celui-ci juge utile de leur confier. Enfin, ils veillent à ce que la Gendarmerie ne soit pas détournée de sa mission d’ensemble par des concours excessifs émanant des autorités judiciaires, administratives ou militaires.
La ligne de démarcation qui partage la France en deux zones ne coïncide pas avec les limites des circonscriptions des légions. Les 5e (Orléans), 9e (Tours), 8e (Dijon), 18e (Bordeaux), situées en majeure partie dans les territoires occupés, s’étendent sur des portions de départements de la zone libre. Or les Allemands soumettent le franchissement de la ligne à un régime strict de laissez-passer. La Gendarmerie est assujettie à la réglementation. Il en résulte des difficultés dans l’exécution du service et l’exercice du commandement. Pour éviter le chevauchement des unités sur la ligne de démarcation, la direction, le 30 juillet 1940, modifie l’organisation des légions de la zone sud en créant trois nouvelles légions, la 18e bis (Pau), la 9e bis (Châteauroux), la 7e bis (Bourg). Elle apporte également de légères modifications au 12e, 13e et 14e. Corrélativement, le 28 août, elle adapte le tracé des légions de la zone occupée, limitrophes de la ligne de démarcation.
* *
*
À Wiesbaden, malgré tous leurs efforts, les négociateurs français n’ont pu obtenir des Allemands que la Garde républicaine mobile ne soit pas incluse dans les cent mille hommes de l’armée d’armistice.
Le cordon ombilical entre la Garde et la Gendarmerie n’est pas tranché immédiatement. Le secrétariat d’État à la Guerre doit soumettre à la commission allemande d’armistice ses propositions sur la structure des forces nouvelles.
Pendant ce temps, la Garde républicaine mobile reste dans l’orbite de la Gendarmerie. Toutefois, le processus de sa réorganisation s’enclenche. La loi du 3 juillet 1940, modifiée par le décret-loi du 20 août 1940, portant organisation de l’armée d’armistice, ramène son effectif de vingt mille à six mille hommes, dont cent quatre-vingts officiers, répartis dans trois légions : légion du centre à Clermont-Ferrand, de l’est à Lyon, du sud à Toulouse. Le 1er novembre 1940, elle dédouble ses légions. Aux précédentes s’ajoutent celles de Marseille, Montpellier et Limoges. Les divisions militaires, au nombre de huit, qui viennent de se substituer aux régions, disposent chacune à l’issue de ce redéploiement, d’une légion ou d’un groupe d’escadrons. L’Afrique du Nord en compte trois : une en Algérie et deux nouvelles, l’une en Tunisie, l’autre au Maroc.
Tout est prêt, dès lors, pour amputer la G.R.M. de la Gendarmerie. Le décret du 17 novembre 1940 consomme la séparation. Son article 2 dispose : « Les légions de la Garde républicaine mobile ne font plus partie de la Gendarmerie. »
Dès le 25, la G.R.M. constitue une sous-direction au sein de la direction de la cavalerie et du train. Un lien subsiste, toutefois, avec la Gendarmerie. Le décret du 9 février 1941 établit une passerelle entre les deux institutions. Il autorise le passage d’officiers de la Garde dans la Gendarmerie. Chaque année des capitaines et des lieutenants peuvent, sur leur demande, y être admis avec leur ancienneté de grade à la suite des officiers déjà en fonction. Peu nombreux sont les postulants. Les gardes, quant à eux, y passent de droit après quinze ans de services. Il faudra attendre le 14 janvier 1945 pour qu’elle revienne au sein de la Gendarmerie.
« L’extériorisation » de la Garde, selon le terme adopté à l’époque, a des conséquences multiples. La Gendarmerie ne possède plus d’unités spécialisées dans le maintien ou le rétablissement de l’ordre, ou ayant une orientation spécifiquement militaire. Comment va-t-elle pouvoir assurer des missions à caractère provisoire, étrangères à son service ordinaire : services d’ordre en particulier et, exceptionnellement, services de maintien de l’ordre ? La voici également dépourvue de moyens pour renforcer l’action préventive ou répressive de ses brigades.
Dans un premier temps, dès la signature de l’armistice, la direction profite de toutes les occasions pour affecter dans la gendarmerie départementale le maximum de gardes. À la dissolution des formations prévôtales, le 26 juin, elle mute en brigade tous les militaires de la G.R.M. qui, à un titre quelconque, y servaient. Dans les territoires occupés, malgré des instructions contraires du commandement militaire allemand, la section Gendarmerie des territoires occupés réussit à transférer la plupart des personnels de la G.R.M. dans la gendarmerie départementale. De même, lorsque la Garde est rattachée à l’armée d’armistice, la direction absorbe l’excédent de son effectif soit environ 14 000 hommes. Une dépêche ministérielle du 4 septembre 1940 détermine les modalités de l’opération.
Selon quels critères les officiers de la G.R.M. allaient-ils être maintenus dans leurs fonctions ou versés dans la gendarmerie départementale ? L’état-major de l’armée voulait, pour sa part, affecter dans la Gendarmerie tous ceux qui étaient sortis du rang, par définition les plus âgés, et conserver dans la Garde les jeunes issus des écoles militaires. La direction s’y oppose fermement. Elle obtient finalement une répartition des officiers conforme à l’intérêt général.
L’apport d’officiers et de gradés en provenance de la G.R.M. permet au commandement de valoriser l’encadrement en créant des postes d’adjoint aux échelons compagnie (officier) et section (adjudant-chef) pour suppléer et seconder les titulaires. Il permet aussi d’organiser les services de la compagnie en mettant en place un embryon de secrétariat, de service automobile et du casernement.
La majeure partie du reliquat de gradés et de gendarmes issue d’unités dissoutes de la G.R.M. est employée pour organiser les brigades motorisées.
La cohésion, plus que jamais indispensable de la Gendarmerie, s’opposait à la reconstitution d’unités indépendantes des sections et des compagnies et, à plus forte raison, d’une subdivision d’arme particulière comparable à la G.R.M. Il convenait donc de mettre à la disposition des commandants de compagnie une réserve prête à intervenir à tous moments sur un point quelconque de leurs départements.
Les éléments disponibles des brigades territoriales ne pouvaient jouer ce rôle, en raison des délais indispensables à leur rassemblement. Intégrées dans le cadre normal d’activité de la Gendarmerie, les brigades motorisées devenaient le complément indispensable des brigades territoriales qu’elles allaient dispenser, en partie, de certaines missions en marge du service spécial.
Déjà, avant la guerre, dans cette optique, plusieurs brigades motorisées avaient été mises à l’essai.
Les brigades motorisées, en nombre variable, six en moyenne dans chaque compagnie, comprennent dix gradés et gendarmes. Leur rayon d’action s’étend sur la circonscription de plusieurs brigades auxquelles elles fournissent, en cas de besoin, l’appoint d’effectifs que peuvent exiger les événements graves tels que crimes, catastrophes naturelles, recherches diverses. Des moyens automobiles légers leur confèrent une grande mobilité, théoriquement, car l’essence est sérieusement contingentée. Par suite de leur réalisation hâtive – il fallait reclasser rapidement les gardes disponibles là où ils se trouvaient – il n’a pas été possible de donner une formation au personnel, de surcroît, employé intensivement.
* *
*
Les besoins particuliers du maintien de l’ordre, depuis la cessation des hostilités, augmentent à un point tel que, dès la fin de l’année 1940, le ministère de l’Intérieur a recours de plus en plus fréquemment à la Gendarmerie dont les charges restent constantes malgré la création des Groupes mobiles de réserve (G.M.R.) courant 1941.
Ceci conduit la direction, lorsque la situation l’exige, à regrouper les brigades motorisées par trois pour former des pelotons. Ces moyens ne suffisent pas pour couvrir les demandes des autorités. En avril 1942, une circulaire prévoit la levée de pelotons dits « territoriaux » composés de gendarmes provenant des brigades et employés dans les mêmes conditions que les pelotons motorisés.
Pelotons motorisés et territoriaux constituent les forces supplétives de Gendarmerie. Leur engagement quasi permanent, durant l’Occupation, perturbe le service traditionnel des brigades qui ont « pour fonctions habituelles et ordinaires de faire des tournées, courses et patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes, bois, enfin dans tous les lieux de leurs circonscriptions respectives. »
Les brigades motorisées, détournées de l’activité pour laquelle elles avaient été conçues, ne peuvent même plus renforcer l’action préventive des unités territoriales. Le général Martin en est pleinement conscient. N’écrit-il pas fin 1943 :
« Les brigades motorisées n’ont pas été créées uniquement pour remplir des missions de maintien de l’ordre, mais surtout en vue d’apporter un concours aussi efficace et aussi rapide que possible aux brigades territoriales comprises dans leur zone d’action. »
Mais il ne peut changer le cours des choses malgré les prescriptions édictées à sa demande, par Bousquet, en décembre 1943, mais aussi par Darnand, en mai 1944. S’adressant aux préfets régionaux et intendants du Maintien de l’ordre, ce dernier leur demande de « veiller à ce que le personnel de cet Arme (la Gendarmerie) ne soit pas distrait de ses fonctions normales ». Il fait valoir par ailleurs « qu’au moment où les attaques à main armée et les attentats terroristes se font plus fréquents dans les campagnes, les gendarmes ont pratiquement disparu de leurs circonscriptions et que, les brigades de Gendarmerie réduites à des effectifs squelettiques ne sont plus en mesure de remplir leur mission ou de s’opposer par la force aux entreprises des fauteurs de troubles. »
Toutes ces directives restent lettre morte.
Le tableau d’emploi des forces supplétives, pour le mois de mars 1944, illustre la situation. Soixante-dix pelotons motorisés et une cinquantaine de pelotons de réserve territoriale, requis par les préfets, opèrent sur l’ensemble de la zone sud pour remplir des missions de garde ou de surveillance. Celles-ci les hypothèquent pour des périodes de longue durée, les relèves n’intervenant, en moyenne, que tous les quarante-cinq jours.
À titre indicatif, de janvier à août 1944, le peloton motorisé n° 107 de Draguignan est déplacé successivement en Haute-Savoie, Haute-Vienne, Basses-Alpes, Var et Alpes-Maritimes. Ainsi, du 16 janvier au 6 mars, il effectue des missions de maintien de l’ordre en Haute-Savoie où il remplace le peloton n° 113 de Digne. Stationné dans la commune de Groisy-le-Plot, il surveille vingt-quatre heures sur vingt-quatre le viaduc d’Évire sur la ligne de chemin de fer Annecy-Annemasse. Par ailleurs, l’unité met en place des barrages routiers de contrôle sur la route Annecy-Thorens. Après une brève remise en condition, cette formation rejoint Limoges le 28 mars et y reste jusqu’au 28 mai. Pendant cette période, elle assure la garde de la maison d’arrêt. Suit un intermède de 19 jours à la résidence, dans le Var, puis le peloton, au lendemain du débarquement sur les plages de Normandie, est mis à la disposition des troupes d’opérations à Digne. Sa mission prend fin le 25 juin. De retour à Draguignan, il reprend son service normal jusqu’au 12 août. À partir de cette date, on assiste à son éclatement. Plusieurs gendarmes rejoignent isolément le maquis. Le gros du peloton participe, sous les ordres du chef d’escadron Favre, commandant la compagnie du Var, à la libération de Draguignan.
Le peloton motorisé n° 181 d’Auch effectue, entre juillet et décembre 1943, deux déplacements de longue durée. L’un de quarante-cinq jours. L’autre de deux mois. Le premier se déroule en Corrèze dans la région d’Ussel. L’unité assure la surveillance de trois sites sensibles : usine d’aviation du Montupet d’Ussel, pylônes de la ligne à haute-tension de Chassagnac et de celle de Viémont. Le second conduit le peloton dans l’Allier où il est employé à différents services d’ordre, à Vichy, au sein du groupement des forces de Gendarmerie mis sur pied dans la capitale de l’État français.
Quelques chiffres révélateurs traduisent, à l’échelon d’une légion, les conséquences de l’emploi intensif des forces supplétives. Le 31 octobre 1943, la légion de Guyenne, forte de mille neuf cent soixante-quatorze militaires en a plus de sept cents en déplacement. Si l’on y ajoute les malades et les permissionnaires, il ne reste qu’un millier d’hommes, état-major compris, pour effectuer le service traditionnel dans cent soixante-dix-sept brigades territoriales et quarante-huit brigades motorisées. Le rythme d’emploi des forces supplétives ne cesse de croître, de juillet 1940 à la Libération.
Plusieurs centaines de gendarmes déplacés sur la ligne de démarcation tiennent des postes de surveillance (Chavagnac, La Rochefoucault, etc.). D’autres répriment aux frontières les passages clandestins vers l’Espagne et la Suisse, pays les plus attractifs pour les candidats à la liberté désireux de rallier la France Libre. À la frontière franco-espagnole, le 1er octobre 1940, le dispositif comprend soixante gendarmes déplacés. En décembre 1942, on en dénombre cent quatre-vingt-dix entre Cerbère et Porta.
Pour pallier l’insuffisance des moyens des ministères de la Justice et de l’Intérieur, la Gendarmerie leur apporte son concours pour la garde des prisons et des camps d’internement : Fort Barreau, Drancy, Voves, Châteaubriand, Saint-Sulpice-la-Pointe, Mauzac, Saint-Paul-d’Eyjaux, Le Vernet, Nexon, Évaux-les-Bains, Mérignac, Bourrassol, Portalet, etc.
Dès le début de l’Occupation, soit de sa propre initiative, soit à la demande des Allemands, le Gouvernement français ouvre des camps d’internement. Ainsi, en octobre 1940, les autorités d’occupation interdisent la circulation des romanichels et ordonnent leur rassemblement dans un camp. On leur affecte le site de La Forge, dans la commune de Moisdon-la-Rivière, à une cinquantaine de kilomètres de Châteaubriand (Loire-Atlantique).
Le préfet de Loire-Atlantique s’adressant le 14 octobre 1940 au lieutenant-colonel Pisson, commandant la compagnie de la Loire-Inférieure, écrit :
« Comme suite à notre entretien de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer que la Feldkommandantur de Nantes a décidé de rassembler tous les bohémiens se trouvant en Loire-Inférieure. Ces derniers devront être concentrés par les soins de la préfecture de la Loire-Inférieure dans un camp où ils seront surveillés par la police française.
D’ores et déjà, vous voudrez bien déterminer, par les soins de vos brigades, les communes où se trouvent actuellement ces nomades en invitant ceux-ci à demeurer sur place… jusqu’au moment où je vous aurai indiqué le camp où ils devront être dirigés. »
Le jour même, le lieutenant-colonel Pisson donne ses instructions aux commandants de section pour réaliser la première phase de l’opération :
« 1°) Immobiliser tous les nomades circulant actuellement dans le département sur le territoire de la commune où ils se trouvent. Pour cela, leur notifier la présente décision en leur prescrivant d’avoir à se présenter, chaque jour, à la brigade. Établir un procès-verbal de cette notification. Toute infraction à l’astreinte à stationnement qui aura été régulièrement notifiée entraînera les recherches immédiates et l’arrestation des délinquants (procès-verbal en trois expéditions).
2°) Adresser à la compagnie, pour le 2 novembre, une liste nominative par brigade, comportant l’énumération par commune de stationnement de tous les nomades actuellement dans le département de la Loire-Inférieure. »
La seconde phase se déroule au début novembre. La Gendarmerie est requise pour surveiller le camp. Le sous-lieutenant Lodeho, commandant la section de Châteaubriand, est chargé d’établir les consignes destinées aux gendarmes de surveillance en vue de les soumettre à la Feldkommandantur. Le dispositif comprend un gradé et neuf gendarmes prélevés dans les brigades de sa section.
Début janvier 1941, les nomades sont transférés au camp de Choisel. L’administration n’ayant pu recruter les agents civils nécessaires à la garde du camp, les gendarmes poursuivent leur mission, qui de temporaire devient permanente. Les autorités administratives, prudentes, ne cessent de renforcer le dispositif, aussi des forces supplétives (P.R.T. et P.M.R.) en provenance de tous les départements prennent le relais des gendarmes locaux. Le détachement de garde et de police de dix sous-officiers passe à vingt (un adjudant et dix-neuf gendarmes), puis à vingt-sept (dont un officier) et à quarante. On observe la même évolution des effectifs dans les autres camps pris en compte par la Gendarmerie.
Avec ses forces supplétives, la Gendarmerie participe encore au quadrillage policier que le pouvoir met en place dans les régions où les premières bandes armées font leur apparition : Limousin, Haute-Savoie, Massif-Central, etc.
De mai à juillet 1943, quatre cents hommes du groupement des forces de Gendarmerie rassemblées en Corrèze, sous les ordres du lieutenant-colonel D…, commandant la légion du Limousin, recherchent les défaillants au S.T.O. De juillet à octobre, un effectif comparable opère au sein d’un groupement mixte des forces de police et de Gendarmerie sous l’autorité de lieutenant-colonel B… auquel succèdent des officiers de la Garde, le lieutenant-colonel B… puis le général B… Le volume des moyens engagés ne varie pas jusqu’à la libération de Limoges.
En Haute-Savoie, dès l’automne 1943, la direction constitue un groupement des forces de Gendarmerie de deux cents hommes qui passe à six cent avant l’investissement des Glières. Encadré par quatre officiers supérieurs et quatorze officiers subalternes, placé successivement sous l’autorité des lieutenants-colonels B… et C…, ce dispositif n’est levé que dans les derniers jours de l’Occupation.
Dans le Massif Central, plus de quatre cents gendarmes en provenance de la région parisienne et de la zone sud gardent, à partir de janvier 1944, des installations vitales pour l’économie et la vie des populations.
Les forces supplétives, surtout en 1943 et 1944, sont constamment sollicitées pour escorter les convois d’internés administratifs et de détenus transférés, en règle générale par voie ferrée, d’un camp ou d’une prison à un autre, pour des raisons diverses : remise des intéressés aux autorités allemandes, nivellement des effectifs des camps, regroupement de certaines catégories de détenus, etc.
Ce type de mission, de durée limitée certes, un à quatre jours, absorbe cependant un volume d’effectif très élevé, qu’il s’agisse de la protection proprement dite des convois, à la charge des unités de la Garde ou des G.M.R., ou de la surveillance des détenus, confiée à la Gendarmerie. Son caractère répétitif, on en recense en moyenne dans chaque région une quinzaine par mois, constitue une lourde charge qui affecte le service traditionnel des gendarmes éloignés de leurs circonscriptions.
Du 12 mai au 3 juin 1944, on enregistre dans la région administrative de Toulouse huit transfèrements effectués par la Gendarmerie.
12 mai : transfert de seize étrangers catalogués « dangereux » du camp du Vernet sur le centre spécial de Gaillac (1 P.R.M.).
13 mai : transfert de quarante-huit internés administratifs et terroristes dangereux de la maison centrale d’Eysses à Blois (3 P.R.M.).
22 mai : transfert de quatre-vingt-dix détenus, du camp de Noë, à Toulouse, pour remise aux autorités allemandes (3 P.R.T.).
23 mai : renforcement des éléments de garde du camp du Vernet, par trois pelotons, à l’occasion du fonctionnement d’une commission de triage des étrangers internés dans le camp.
24 mai : transfert sur la maison centrale d’Eysses de vingt-cinq détenus incarcérés à Agen, Pau et Toulouse (2 P.R.M.).
27 mai : transfert de quatre cents internés du camp du Vernet, en zone nord, pour remise aux autorités allemandes (5 P.R.M.).
2 juin : transfert de vingt-sept Anglo-Américains du camp de Noë à Paris (1 P.R.T.).
3 juin : transfert de cent quarante-neuf femmes internées à Brens au camp de Gurs (2 P.R.T.).
La dérive dans l’emploi des forces supplétives suscite déjà, au début de l’année 1943, ce commentaire d’un commandant de légion :
« Pour ce qui est du commandement il devient très difficile, par suite de la mise sur pied fréquente de pelotons qui vident nos brigades et rendent matériellement impossible l’exécution du service courant, si bien que l’on peut dire que le service extraordinaire est devenu le service normal et que celui-ci n’est exécuté qu’exceptionnellement. »
* *
*
La création, en automne 1940, d’une nouvelle formation pour assurer la sécurité du chef de l’État, contrairement à celle des pelotons motorisés et des pelotons de réserve territoriale, n’engendre pas de difficultés particulières.
Cette unité spécialisée prend le nom de « Compagnie de garde personnelle du chef de l’État ». Elle remplace le détachement de policiers du service des voyages officiels qui, depuis l’armistice, avait en charge cette mission traditionnellement dévolue à la Garde de Paris. À la disposition du préfet de police depuis le 30 août 1940, celle-ci ne pouvait être employée hors de la capitale.
Les membres de la garde personnelle, soigneusement sélectionnés parmi les gendarmes très bien notés, de belle présentation, autant que possible décorés, portent la tenue des départementaux. Pour les services d’honneur ou de protection, dans les résidences du maréchal, à l’hôtel du Parc, au pavillon Sévigné, au château de Charmeil et du Lonzat, une veste de cuir et le casque à bourrelet des unités de chars remplacent la vareuse traditionnelle et le képi.
Courant 1942, la garde adopte une grande tenue de service comportant une tunique de tradition, une cape et un bicorne porté en ligne avec bufflèteries et aiguillettes blanches.
De structure classique, la compagnie, à l’effectif de cent soixante-six officiers et sous-officiers, aux ordres d’un capitaine, comprend cinq pelotons, dont un motorisé d’escorte qui accompagne le chef de l’État dans ses déplacements officiels, et la musique de la Garde de Paris, repliée à Chamalières fin juin 1940. Cette formation participe tous les dimanches à la cérémonie de la relève de la garde ainsi qu’à la plupart des manifestations patriotiques qui se déroulent à Vichy et dans sa région.
Le 27 août 1942, elle rehausse de sa présence la prise d’armes présidée par le maréchal Pétain au cours de laquelle il confie à la compagnie la garde du drapeau de la gendarmerie départementale.
Le commandant militaire du cabinet du chef de l’État règle l’emploi de la compagnie qui échappe au contrôle de l’inspecteur général de la Gendarmerie de la zone sud. Sur le plan administratif, l’unité dépend de la 13e légion de Clermont-Ferrand.
Lors de sa réorganisation, le 1er octobre 1942, consécutive à l’accroissement de ses charges, la compagnie prend le nom de « Garde personnelle du chef de l’État ». Elle totalise quatre cent vingt hommes. Un chef d’escadron en prend le commandement. Cet officier dispose des droits et prérogatives que confèrent les règlements aux commandants de légion de Gendarmerie.
Un arrêté du 21 février 1943 transforme la garde personnelle en « légion de la garde personnelle du chef de l’État » commandée par un colonel. Il porte l’effectif à quatre cent soixante.
L’hôtel Carlton où la formation est installée depuis sa création s’avère désormais trop exigu. Elle se desserre sur la caserne d’Orvilliers, située dans l’enceinte de l’hôpital militaire thermal, et dans les baraquements en bois du « concours hippique » de Vichy.
La spécificité de la mission qui incombe à la garde du chef de l’État, pendant l’Occupation, l’a mise à l’abri des difficultés auxquelles les unités traditionnelles de Gendarmerie étaient confrontées. Jamais, en effet, elle n’a participé à des opérations de maintien de l’ordre, pas plus qu’elle n’a eu à affronter ou à arrêter des patriotes.
Des officiers et des sous-officiers de la légion de la garde personnelle participent à la Résistance comme le lieutenant Frumin, membre de l’O.R.A., arrêté par la Gestapo, le 13 septembre 1943, qui meurt en déportation un an plus tard, le 20 septembre 1944. Autres victimes de la police allemande, interpellées le 7 juillet 1944, sous l’inculpation « de participation à un complot dirigé contre Laval », le chef d’escadron Hurtel et le lieutenant Bertrand. Ils ne doivent leur salut qu’au départ précipité des Allemands. Pour le lieutenant Bertrand, le sursis sera de courte durée. À la tête d’une compagnie de F.F.I., lors des combats du Lioran, il est fait prisonnier. Déporté à Dora, il y succombe le 3 avril 1945.
Après le départ de Vichy du maréchal, sa garde se met à la disposition du responsable régional de la Résistance. Elle rejoint le maquis d’Auvergne au col de la Plantade. À l’est de Dampierre, un détachement sous les ordres du lieutenant Mathieu, lors d’un accrochage avec les troupes allemandes, perd deux gradés (adjudant-chef Lardereau et chef Brenon) et cinq gendarmes (Arnaune, Bard, Dourneau, Martin, Schmeltz), onze autres sont blessés.
* *
*
La reconstitution de l’infrastructure nécessaire à la formation des personnels, qui conditionne la reprise du recrutement des officiers et des gendarmes, commence en 1941.
Fin août 1939, la veille de la déclaration de guerre, l’école d’application des officiers de Versailles a fermé ses portes. Après plus d’un an d’interruption, les cours reprennent le 1er janvier 1941. Pau accueille provisoirement l’école. L’encadrement, peu étoffé, comprend quatre officiers (colonel Picard, commandant l’école, chef d’escadron Fabre, capitaine Solenne [professeurs], capitaine Stella, [comptable]) et six sous-officiers (un gradé, un secrétaire, quatre gendarmes). Les moyens matériels, fournis par la légion de Pau, sont réduits au strict minimum : une voiture légère, deux machines à écrire et quatre bicyclettes.
La première promotion formée par l’école comprend vingt officiers-élèves (quatre capitaines et seize lieutenants) provenant des corps de troupes admis au concours de 1939. Elle aurait dû, en fait, être plus nombreuse, mais des candidats étaient retenus en captivité en Allemagne, d’autres, affectés à la Garde qui venait d’être détachée de la Gendarmerie, se trouvaient à l’école d’application de la Cavalerie, du Train et de la Garde à Tarbes.
Le stage initial d’une durée de six mois prend fin le 1er juillet 1941. Deux promotions se succèdent jusqu’à l’automne 1943.
Le 15 octobre, les Allemands autorisent le transfert de l’école, à Courbevoie, dans la caserne Charras où Vigny servit comme sous-lieutenant au 5e régiment de la garde royale. C’est là, d’ailleurs, qu’il aurait écrit une partie de son œuvre « Grandeurs et servitudes militaires ». Le retour de l’école dans la région parisienne répondait au souci de la placer en un point central, de faciliter ses liaisons avec la direction générale. Mais surtout, les ressources intellectuelles et matérielles qu’offrait la capitale ne pouvaient que profiter à son enseignement.
Sous le commandement du lieutenant-colonel Simonpoli, à partir de 1943, l’école formera jusqu’à la Libération deux autres promotions. Parmi les officiers professeurs affectés à l’école entre 1941 et 1944, quelques-uns, comme le chef d’escadron Dubarry et le capitaine Vessereau, seront des « éveilleurs de conscience ».
Dès le mois d’août 1942, le premier nommé entretient des rapports suivis avec les chefs de la Résistance du département des Basses-Pyrénées. Après la réinstallation de l’école à Courbevoie, il reste en contact avec eux. Comme convenu, au moment du débarquement, il déserte et rejoint Pau où on lui confie d’importantes responsabilités. Nommé d’abord chef d’état-major puis commandant militaire des F.F.I. du département, il prépare les actions qui entraînent le 26 août la libération de la région.
Quant au second, recherché par la Gestapo, il quitte son poste en 1944, pour continuer la lutte dans la Nièvre, son département natal. Il y lève une force de huit cents hommes avec laquelle il participe aux combats de la Libération. Le 10 septembre 1944, à la tête d’une compagnie des F.F.I., il interdit le franchissement de l’Allier à une forte colonne allemande et obtient sa reddition.
La G.R.M., avant la guerre, formait dans ses centres d’instruction les élèves-gendarmes appelés à servir dans ses rangs et dans ceux de la départementale. Son rattachement à l’armée d’armistice met la Gendarmerie dans l’obligation d’organiser l’instruction des futurs gendarmes. Courant 1941, elle crée, en zone sud, des écoles préparatoires de Gendarmerie respectivement à Roanne, Pamiers, La Fontaine-du-Berger qui s’ajoutent à celles de Cholet et de Mamers en zone nord. D’autres créations interviennent postérieurement : école de Brive, centres d’instruction de Vichy, de Roubaix et de Vals-les-Bains. Ce dernier forme les élèves-gendarmes à cheval. La Gendarmerie dispose en effet d’unités montées. Le 2 février 1943, la commission d’armistice autorise la création de vingt-trois pelotons à cheval (neuf cent quarante-trois officiers et sous-officiers).
Avec l’année 1944 s’ouvre une période cruciale pour les écoles préparatoires. Le 18 mars, la direction reçoit l’ordre de mettre à la disposition des autorités d’occupation, au plus tard avant le 25, les locaux occupés par l’école préparatoire de Gendarmerie de Romans. Le jour de sa dissolution, le 23 mars, le commandement organise une ultime prise d’armes. Au cours de l’après-midi, en présence du maire de la ville et de quelques personnalités, les cinq compagnies se rassemblent au pied des couleurs. Puis, le lieutenant-colonel Guérin, commandant l’école, présente la promotion « capitaine Vallet » après avoir rappelé la mort tragique de cet officier par des « mains fratricides ». Dans une brève allocution, il dit son émotion à formuler, pour la dernière fois, à Romans, le mot rituel « Amenez ». Le 24 mars, à 16 heures, le casernier du génie reçoit les clefs de la caserne Bon. Le dernier acte est accompli.
Sur instruction expresse de Darnand, secrétaire général au Maintien de l’ordre, la direction générale de la Gendarmerie, début juin 1944, suspend la formation des élèves-gendarmes des écoles préparatoires de Brives, Mamers et Pamiers. Avec leurs cadres, alors qu’ils ne sont même pas assermentés, ils partent pour la zone nord relever les forces de maintien de l’ordre chargées de la protection des lignes électriques et des canaux. Une décision du 1er juillet 1944 met fin officiellement à l’existence de ces trois écoles. Les quelque mille cinq cents élèves-gendarmes détachés pour le M.O. reçoivent une affectation en surnombre dans les légions sur le territoire desquelles ils sont déplacés. La situation des E.P.G. ne se normalise qu’après la Libération.
* *
*
Une importante innovation technique voit le jour le 23 avril 1942. La direction crée, dans chaque compagnie de la zone sud, un service de diffusions et un fichier des personnes recherchées.
Depuis 1926, chaque brigade constituait et tenait à jour une documentation sur laquelle était répertoriée la liste des individus à rechercher. Ce travail fastidieux prenait beaucoup de temps. Pour s’assurer au cours du service qu’un inconnu, objet d’un contrôle, ne figurait pas, où était au contraire inscrit sur les listes de signalements, le gendarme emportait avec lui et devait compulser une trentaine de documents d’environ deux mille pages auxquelles s’ajoutaient des feuilles de mises à jour. Le tout d’un format différent.
Le système devient inopérant en 1942 par suite du nombre considérable des individus à rechercher qui s’est accru, en moins de trois ans, de cent vingt mille. D’où l’idée de constituer un service doté d’un fichier qui centralise, tant à l’échelon du département (compagnie) que national, les demandes d’identification des brigades et y réponde immédiatement ou, tout au moins, dans des délais admissibles.
Des fichiers centraux coiffent le dispositif. Deux en zone sud installés à Clermont-Ferrand et à Rodez (fichier spécialisé d’étrangers) et deux en zone nord, à Versailles et à Chartres (fichier des étrangers).
À partir de mai 1942, chaque compagnie de la zone libre, outre son propre fichier, en établit un pour une formation correspondante des territoires occupés, désignée préalablement par l’administration centrale en attendant leur mise en place ultérieure. Après l’invasion de la zone sud et l’accentuation de la politique de collaboration, en octobre 1943, Laval autorise l’extension des fichiers à la zone nord. Toutefois, avant leur transfert, la direction ordonne aux compagnies qui les détiennent de les expurger des fiches « S », établies en application d’instructions du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur courant 1942.
Création du régime de Vichy, les fiches « S » ont un lien de parenté avec le carnet « B », fichier des suspects élaboré sous la IIIe République par une instruction en date du 1er novembre 1912, dont elles sont le prolongement. Après enquête approfondie, les individus susceptibles de nuire tant à la Défense nationale qu’à l’État sont inscrits dans le carnet « B ». Chaque brigade de Gendarmerie en détient un exemplaire. Figurent sur ce document les communistes, les réfugiés républicains espagnols et, après 1940, les gaullistes. Les textes prévoient leur incarcération en cas de troubles.
Des officiers et des gradés prennent l’initiative de détruire ce fichier pour éviter qu’il ne soit exploité. Fin 1940, le chef d’escadron Guillaudot, alors en poste à Rennes, donne l’ordre à toutes les brigades du département de l’Ille-et-Vilaine de le faire disparaître afin qu’au cours de perquisitions possibles des Allemands, les personnes répertoriées ne soient pas repérées et ne tombent pas entre leurs mains.
Le secrétaire général à la Police, René Bousquet, remplace, en juin 1942, le carnet « B » par les listes « S » où sont consignés les noms des suspects. Ces listes, dressées et tenues à jour par les renseignements généraux puis mises en place dans tous les services de Police et de Gendarmerie se répartissent en trois catégories. Listes « S1 » : elles comprennent les personnes considérées comme dangereuses du point de vue politique (communistes, gaullistes principalement). Listes « S2 » : y figurent les repris de justice, souteneurs, vagabonds. Listes « S3 » : en font partie les individus à arrêter en cas de troubles.
À partir du 7 juin 1944, sur ordre des préfets, Police et Gendarmerie reçoivent pour mission de mettre en application les instructions relatives aux listes « S1 » et « S3 ». En exécution de ces prescriptions, des gendarmes procèdent à des interpellations. Dans l’Aveyron, où pourtant les trois quarts sont acquis à la Résistance, on totalise dix-neuf arrestations. Une partie seulement de ces dernières leur sont imputables. Nombreuses sont les unités où l’on n’obtempère pas systématiquement aux ordres. Des fuites se produisent qui permettent aux personnes visées par la mesure d’échapper à l’arrestation. À Montpellier, le commandant de compagnie exige un ordre écrit du préfet. De plus, l’inertie des gendarmes aidant, trente-cinq personnes inscrites sur la liste « S1 » et domiciliées en zone Gendarmerie se soustraient aux recherches. En Lozère, on dénombre treize noms sur les listes « S1 ». Dès le mois de novembre 1943, l’adjudant Roquefeuil, du secrétariat de la compagnie, les communique au chef de la Résistance locale. Dans l’arrondissement de Marvejols, l’adjudant Doutre prévient en temps utile cinq personnes fichées domiciliées dans le canton.
Des problèmes importants restent en suspens malgré l’effort d’adaptation entrepris dans les mois qui suivent l’armistice. Ainsi à la fin du premier trimestre de l’année 1942, la direction n’a élaboré aucune directive d’ensemble pour régler, dans les territoires occupés, la question épineuse des rapports avec l’occupant, laissant le soin à chaque responsable d’agir au mieux. Les contacts personnels qu’établissent initialement les Allemands avec les différents échelons de Gendarmerie, qu’ils considèrent comme directement responsables vis-à-vis d’eux, s’espacent progressivement. Fin 1941, les officiers abordent de moins en moins souvent personnellement, avec leurs homologues allemands, les problèmes de leur compétence car les autorités préfectorales s’interposent.
Le colonel commandant la 11e légion, à Nantes, déplore cette situation dans un rapport en date du 17 janvier 1942, enregistré sous le n° 4/4 S :
« Tant que les officiers de Gendarmerie traitèrent directement les questions de leur compétence avec les officiers allemands, leurs rapports empreints de l’esprit militaire furent relativement faciles et permirent à la Gendarmerie de résister à bien des prétentions exagérées. Elle put souvent faire admettre aux officiers allemands que les gendarmes français ne pouvaient prendre à l’égard des populations françaises telles positions qui les auraient rendus odieux. »
* *
*
La Gendarmerie de la zone libre, si elle ne subit pas l’emprise constante de l’occupant, est néanmoins assujettie aux contrôles des commissions allemandes d’armistice chargées de vérifier, sur le terrain, l’application des accords de Wiesbaden.
Le domaine d’investigation des commissions, à l’égard de la Gendarmerie, est très étendu sinon illimité. Elles vérifient, tout spécialement, qu’il n’existe, entre la Gendarmerie et l’armée d’armistice, aucune liaison. Elles s’assurent qu’on n’y fait pas d’instruction autre que celle se rapportant aux missions de police. Elles comptabilisent l’armement, les munitions et tout le matériel divers, auto, génie, etc. qui doit correspondre strictement aux dotations agréées par les commissions centrales. Elles exigent la communication des programmes généraux d’instruction et les tableaux de travail des écoles. Bien que les effectifs, en zone libre, ne soient pas soumis à limitation du fait de la convention d’armistice et ce jusqu’au 15 octobre 1942, où leur plafond est fixé à vingt-neuf mille deux cent soixante-dix-neuf hommes, les commissions en suivent attentivement l’évolution.
Tous ces contrôles génèrent dans les unités visitées l’établissement de nombreux états. Pour le suivi des effectifs, les commissions, lorsqu’il s’agit de sous-officiers, se contentent de situations numériques (effectif théorique, réalisé, excédents, déficits) alors que pour les officiers elles réclament des situations nominatives assorties de détails précis : grade, âge, fonction, etc. Toutes les catégories de matériels donnent lieu à la fourniture d’une multitude de renseignements (niveau des dotations théoriques, réalisées, etc.).
Quelle attitude le commandement supérieur de la Gendarmerie adopte-t-il vis-à-vis des commissions d’armistice ? Le Gouvernement français ayant donné l’assurance aux Allemands qu’il ne s’opposerait pas aux investigations des commissions, la direction ne pouvait y faire obstacle. Toutefois, elle adresse des instructions confidentielles aux commandants de légion pour les inviter à en limiter les conséquences. Entre septembre 1940 et juin 1942, elle rappelle, dans au moins huit directives, la conduite à tenir.
Une des dernières, en date de juin 1942, signée par M. Chasserat souligne que :
« D’une façon générale, il convient de subir le contrôle et non de le faciliter, l’expérience ayant montré que toutes les facilités données à des organes de contrôle se traduit par un accroissement de leurs exigences, de ne pas heurter les commissions par des réponses trop absolues, d’éviter dans la mesure du possible de fournir des renseignements trop précis risquant d’engager l’avenir, d’adopter en tout cas, à l’occasion des contrôles, une attitude qui, tout en restant digne, ne doit pas se départir de la plus stricte correction. »
Pour éviter toute discordance entre les réponses que pourraient fournir les commandants d’unités visités aux interrogations des contrôleurs, la direction adresse aux commandants de légion un mémento reprenant, dans leurs principes, les points essentiels sur l’organisation et l’emploi de la Gendarmerie tels qu’ils avaient été exposés aux commissions d’armistice. Ce document, de quelques pages, contient une liste de questions susceptibles d’être posées à des commandants de compagnie et les réponses correspondantes. Quelques extraits en donnent un aperçu intéressant :
« – Demande : travaillez-vous avec la garde ?
– Réponse : Je n’ai aucun rapport avec la garde.
– Demande : En cas de M.O. en auriez-vous ?
– Réponse : Très vraisemblablement, dans le cas où mon effectif très réduit serait insuffisant.
– Demande : Faites-vous de l’instruction militaire ?
– Réponse : Il n’est pas fait d’instruction militaire. Seuls, sont enseignés les mouvements nécessaires pour obtenir d’eux une présentation correcte.
– Demande : Faites-vous des exercices de tir ?
– Réponse : Non, mais nous en ferions si nous avions les munitions.
– Demande : Avez-vous des ennuis avec les communistes ?
– Réponse : La population est calme et nous n’avons pas d’ennuis.
– Demande : Avez-vous des cartouches de réserve ?
– Réponse : Non, etc. »
Placées sous l’autorité de l’inspection allemande de contrôle de Bourges, les commissions, composées de quelques officiers et sous-officiers allemands, flanquées d’un détachement de liaison français, aux ordres d’un officier parlant couramment l’allemand, commencent leur activité en août 1940.
Elles visitent les corps de troupes, leurs magasins, les parcs de matériel, la G.R.M., les services de Police et de Gendarmerie. Les contrôles s’exercent aux échelons des légions et des compagnies qui fournissent, dans les limites fixées confidentiellement, les renseignements demandés. Si, exceptionnellement, les commissions veulent se rendre dans des formations subordonnées (sections ou éventuellement brigades), satisfaction, selon les directives, doit leur être donnée étant entendu que le commandant de compagnie dont dépend l’unité visitée sera présent, lui seul devant répondre aux questions posées.
Dès septembre 1940, des officiers, de connivence avec des sous-officiers, que ce soit dans les légions où les compagnies, prennent le risque de cacher les excédents stockés dans les magasins. Il s’agit essentiellement de munitions, de cartouches et de matériels divers. Les états de renseignements destinés aux commissions d’armistice sont naturellement mis en conformité de même que la comptabilité. À titre indicatif, la 1er légion (Montpellier) réussit à soustraire aux investigations des commissions cent mille cartouches de mousquetons et neuf cents de pistolets.
Après l’invasion de la zone libre, le 11 novembre 1942, la police allemande prend en charge la plupart des attributions dévolues aux commissions par le traité d’armistice. Les Kommandeurs régionaux de la police d’ordre procèdent à toutes les vérifications, sans limite aucune, qu’ils jugent utiles, dans les unités de Gendarmerie.
Le 18 avril 1942, après une éclipse de quelques mois, Laval est de retour sur le devant de la scène politique. Pétain le nomme chef du Gouvernement. Il trouve une Gendarmerie consolidée, comparativement à l’état dans lequel elle se trouvait, vingt mois auparavant, en juillet 1940, qui a su procéder aux adaptations qu’exigeaient les circonstances. Rien ne laisse présager de nouvelles transformations. Pourtant, quelques semaines plus tard, Laval engage l’institution dans un processus de profonds changements.
Moins de deux mois après sa nomination à la tête du Gouvernement, Pierre Laval promulgue la loi n° 565, du 2 juin 1942, qui place la Gendarmerie sous sa dépendance directe et exclusive.
Comme il s’en explique, dans deux directives des 26 juin et 23 août respectivement adressées, l’une au ministre secrétaire d’État à l’Intérieur et au ministre secrétaire d’État à la Guerre, l’autre au secrétaire général pour la police, aux préfets et au directeur général de la Gendarmerie, un souci d’efficacité dicte cette mesure.
Compte tenu du rôle que doit jouer la Gendarmerie dans l’œuvre de rénovation nationale, ses charges sont appelées à augmenter. Aussi, le chef du Gouvernement tient à lui donner une position qui « réponde aux conditions les meilleures de son emploi. » Dans un cadre mieux adapté elle va continuer à déployer son activité au profit de tous les départements ministériels sans qu’aucun d’eux, toutefois, comme c’était le cas pour le secrétariat d’État à la Guerre, n’exerce sur elle une autorité prépondérante.
CHAPITRE 8 – L’AUTONOMIE
Laval prend soin de rappeler qu’il n’entend porter atteinte, ni à son organisation traditionnelle, ni à son fonctionnement. Les rapports de l’Arme avec les autorités administratives et judiciaires restent inchangés malgré les prérogatives accrues des préfets en matière d’ordre public et de coordination des services de police. Le décret du 20 mai 1903, en cours de réactualisation, ne modifie pas les modalités de sa mise en œuvre prévue par voie de réquisition.
Le fait qu’elle ne soit plus subordonnée aux autorités militaires n’implique pas l’abandon de structures et de principes de discipline dont elle a, dans le passé, tiré sa valeur. Elle devient simplement une force de police organisée militairement.
Plus que la recherche de l’efficacité, la pression des autorités occupantes explique la réforme décidée par Laval. On connaît l’hostilité des militaires allemands au lien de subordination qui existe entre la Gendarmerie et le secrétariat d’État à la Guerre. N’ont-ils pas déjà, dans les territoires occupés, au lendemain de l’invasion, imposé le passage de la garde de Paris et de la gendarmerie départementale, au sein du ministère de l’Intérieur. Le compte rendu rédigé par le SS Sturmbannführer Hagen le 4 juillet 1942, sur l’entretien qui a eu lieu le 2 juillet, entre Oberg et Bousquet, prouve que la question du rattachement de la Gendarmerie à une autre autorité que celle du département de la Guerre a été abordée plusieurs fois. Dans le paragraphe 6 consacré à la Gendarmerie il note :
« La situation confuse concernant l’autorité dont doit relever la Gendarmerie avait déjà fait l’objet d’une discussion le 16 juin. Bousquet a de nouveau été interrogé là-dessus par le SS Brigadeführer Oberg. Le SS Brigadeführer Oberg pose la question concrète de savoir s’il peut, sans pour autant ignorer Bousquet, parler au directeur de la Gendarmerie à Vichy, Chasserat. Bousquet déclare que celui-ci est chargé de toutes les questions techniques qui concernent la Gendarmerie mais que pour ce qui est de son utilisation elle relève de son autorité à lui, Bousquet. Il transmettra directement à Laval nos questions touchant ce domaine. Selon Bousquet, c’est pour lui éviter un surcroît de difficultés pour les débuts de son activité que Laval s’est abstenu de faire dépendre directement la Gendarmerie de son autorité. »
Dans les semaines qui suivent la promulgation de la loi, décrets, arrêtés, circulaires définissent les modalités de son application. Sans entrer dans le détail de ces textes examinons-en les deux dispositions majeures.
D’une part, la subordination de la Gendarmerie aux autorités militaires disparaît. Désormais, même si elle conserve une structure militaire, la Gendarmerie n’appartient plus aux armées. Le décret du 24 juin 1942, publié au J.O. de l’État français du 13 septembre, modifie dans ce sens le décret du 20 mai 1903. Il enlève au ministre secrétaire d’État à la Guerre la presque totalité des pouvoirs qu’il exerçait antérieurement sur la Gendarmerie : organisation, commandement, exécution réglementaire de toutes les parties du service, admissions dans la Gendarmerie, avancement, changement de résidence, ordre intérieur, permissions, congés, récompenses, contrôle des généraux inspecteurs d’arrondissement, inspection des officiers, etc.
En ce qui concerne l’exercice de la police judiciaire militaire, la Gendarmerie a une action totalement indépendante bien qu’à ce titre elle relève des commissaires militaires régionaux. De même, la Gendarmerie n’est plus soumise à la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’armée.
Cependant, bien que dissociée de l’armée en vertu de la loi, la Gendarmerie n’en continue pas moins à vivre dans l’orbite du secrétariat d’État à la Guerre. L’intendance lui livre des machines à écrire, du cuir pour la confection des bottes et des leggins, des bons de transport par voie ferrée, etc. Sur désignation des commissaires militaires régionaux, des officiers siègent dans les juridictions militaires pour des périodes de six mois. Jusqu’à la création de son service social, le 1er octobre 1943, la Gendarmerie bénéficie des prestations de celui de l’armée. Enfin, la direction du matériel détache dans les compagnies du personnel technique pour assurer le fonctionnement du service automobile ainsi que des agents armuriers pour vérifier, entretenir et réparer l’armement.
Dans ce nouveau cadre, les relations avec les militaires, malgré quelques ombres au tableau, restent bonnes. Après la démobilisation de l’armée d’armistice, à partir de novembre 1942, un commandant de légion signale que « les commandants de subdivisions et les officiers en congé d’armistice font encore, trop souvent, sentir leur rancœur à la Gendarmerie parce qu’elle a eu l’honneur de garder son uniforme et qu’elle a conservé son caractère militaire. »
Un adjoint de chancellerie, président de la commission administrative d’un mess d’une grande ville, décide de retirer définitivement au personnel de la Gendarmerie le droit de prendre les repas au mess de garnison, sous le prétexte que les gendarmes « sont des ex-sous-officiers reclassés dans des administrations autres que la guerre. »
Ceci mit à part, les obligations de la Gendarmerie à l’égard des officiers démobilisés de l’armée d’armistice n’altèrent pas les relations harmonieuses qui existaient antérieurement. Ce n’est pas de gaîté de cœur que les gendarmes font émarger, aux officiers renvoyés dans leurs foyers, la mise en garde libellée par les autorités allemandes :
« Je reconnais par la présente avoir eu connaissance de la communication du haut-commandement allemand : toute action hostile envers le Reich allemand ou toute autre mesure dirigée contre les puissances de l’Axe dont un officier démobilisé de l’Armée française se rendra coupable entraînera les conséquences les plus graves pour lui-même et pour sa famille. Le corps des officiers français est responsable dans sa totalité de l’attitude de chacun. »
L’autre formalité, plus facilement supportable, consistait pour les officiers démobilisés à se présenter, une fois par mois, au commandant de section ou de compagnie, pour justifier leur présence. Ce pointage mensuel visait à limiter leurs déplacements de longue durée et surtout à faciliter la surveillance de leurs activités. La plupart des officiers de Gendarmerie s’emploient à assouplir cette règle. Ils se contentent, bien souvent, d’une lettre mensuelle ou de tout autre arrangement. Par ce biais, ils vont nouer des contacts utiles avec des officiers de l’armée d’armistice, engagés dans la Résistance, auxquels ils apporteront une aide précieuse.
La complaisance des gendarmes manque parfois de tourner à la tragédie. Au moment de son affectation à la compagnie de la Loire, début 1944, le lieutenant Sanvoisin a dans ses attributions le suivi du contrôle des officiers démobilisés de l’arrondissement de Saint-Étienne. De connivence avec le lieutenant Pialat, astreint à signer, il émarge régulièrement à sa place. L’état-major de liaison allemand convoque un jour l’officier et le met en demeure d’expliquer comment le lieutenant Pialat a pu se présenter au pointage alors qu’arrêté par la Gestapo il est incarcéré.
Second volet essentiel de la loi du 2 juin : elle rattache directement la Gendarmerie au chef du Gouvernement. Comme ceux des années 1980, les gendarmes, en 1942, caressaient-ils le rêve d’une Gendarmerie autonome ? Aucun élément ne permet de le penser.
L’article 54 du décret du 20 juin 1942 détermine les attributions du chef du Gouvernement envers la Gendarmerie. Celles-ci s’étendent à tout ce qui se rapporte à « l’organisation, l’emploi et le service. » Pour les exercer, il dispose d’un organe de commandement, la direction générale de la Gendarmerie, qui se substitue à la direction de la Justice militaire et de la Gendarmerie précédemment reliée au secrétariat d’État à la Guerre.
Comme Laval ne peut jouer à l’égard de la Gendarmerie le rôle d’un chef de département ministériel, en particulier dans les affaires courantes, par arrêté, il délègue ses pouvoirs au directeur général. Dès lors, ce dernier exerce la plénitude du commandement et de l’administration. Il est personnellement responsable de toutes les parties du service.
Les commandants de légion, eux-mêmes, relèvent de l’autorité immédiate et totale du directeur général, ce qui n’était pas le cas avant la loi du 2 juin. Sous l’ancienne législation, ils correspondaient avec le ministre de tutelle par l’intermédiaire des commandants de corps d’armée.
Les services du chef du Gouvernement ne disposent d’aucune organisation permettant à la Gendarmerie de s’y intégrer, par voie de conséquence elle doit se constituer en service public autonome. D’où l’établissement d’une nouvelle réglementation administrative sur des bases qui survivront au régime de Vichy : séparation du commandement et de la gestion, indépendance du contrôle, spécialisation des services.
La loi du 5 novembre 1942 réorganise l’échelon central de la Gendarmerie dont la structure comprend des services techniques et administratifs répartis en deux sous-directions : la sous-direction de l’organisation, du service spécial et du personnel et la sous-direction des services administratifs et financiers.
Un directeur général, assisté par un directeur adjoint et deux sous-directeurs, coiffe ce dispositif. À la fin de l’année 1942, un contrôleur de l’administration de l’armée est placé, en service détaché, auprès de la direction générale, pour exercer le contrôle administratif et financier des corps et services de l’Arme. Les textes habilitent cette autorité à effectuer toute étude et enquête jugées utiles par le commandement. Autre chargé de mission attaché à la direction générale M. Nouvel, officier de réserve, âgé de 36 ans qui n’avait aucune formation en matière de Gendarmerie et devait son poste à son amitié avec M. Chasserat. Deux attributions lui incombent. En premier lieu, participer avec le chef de la section Gendarmerie des territoires occupés aux négociations avec les autorités allemandes tout en assurant, dans les deux sens, les liaisons entre la direction générale à Vichy et son échelon avancé parisien. En second lieu, représenter le directeur général pour traiter différents problèmes avec les autorités administratives : acquisition d’immeubles, etc. Lorsque le chef du Gouvernement, sur injonction des Allemands, met fin à ses fonctions, le 30 octobre 1943, il n’est pas remplacé.
En août 1943, Laval renforce l’autonomie de la Gendarmerie en nommant directeur général un officier de l’Arme. Il rompt ainsi avec une pratique qui, depuis 1932, plaçait à la tête de la Gendarmerie des magistrats de l’ordre judiciaire ou plus rarement administratif.
Au début du mois, le chef du Gouvernement convoque à Vichy, à l’hôtel du Parc, le colonel Martin, inspecteur par intérim des 7e, 14e et 15e légions de Gendarmerie à Lyon, en vue de lui annoncer sa prochaine désignation au poste de directeur général de la Gendarmerie en remplacement de M. Chasserat sur le point d’être relevé. L’entrevue est brève. Laval se contente de lui indiquer qu’il le reverra prochainement. Le 18 août une nouvelle convocation parvient à l’officier. Laval confirme à l’intéressé sa nomination à la tête de la Gendarmerie et sa prochaine promotion au grade de général de brigade. Il lui demande son avis sur le colonel d’infanterie qu’il envisage de nommer au poste de directeur adjoint en remplacement du général Fossier. Le colonel Martin n’en veut pas car il estime qu’un spécialiste de l’Arme est nécessaire pour tenir cet emploi délicat. Le chef du Gouvernement lui laisse toute latitude pour proposer, à sa convenance, un directeur adjoint. Son choix se porte sur le lieutenant-colonel Chambon, commandant la 9e légion bis à Châteauroux.
Originaire des Vosges, âgé de 51 ans, fils de gendarme, le nouveau directeur a embrassé très tôt la carrière militaire. Après Saint-Cyr, il opte pour la Gendarmerie et suit les cours de l’école de Versailles. Breveté d’état-major, la Gendarmerie à l’époque n’en compte que trois dans ses rangs, dont le colonel Chambon, il est promis à un bel avenir. Des commandements importants jalonnent sa carrière : chef d’état-major de la Gendarmerie de la région de Paris (1939-1940), commandant des forces de Gendarmerie de Paris sud-ouest (janvier à juillet 1941), chef de corps de la garde de Paris (1941-1943), inspecteur par intérim, à partir de mai 1943, de la région de Lyon. La réorganisation du haut-commandement se poursuit en 1943. Plus rien ne justifie, à ce moment-là, le rattachement des corps de Gendarmerie aux divisions et régions militaires qui n’existent d’ailleurs pas en zone nord. Un décret du 9 janvier 1943 met en concordance les légions avec les régions administratives créées à partir de 1941 et coiffées par un préfet régional. Ce texte consacre la création d’une légion par région, soit au total 22 légions, plus la compagnie autonome de la Corse et la région de Paris répartie en trois légions, Paris-est, Paris sud-ouest, Paris nord-est et le groupement de Seine-et-Oise à Versailles. Chaque légion prend le nom d’une province : Flandres, Picardie, Normandie, etc.
Considérant l’étendue très inégale des circonscriptions administratives, certaines ne groupent que 3 ou 4 départements, alors que les plus vastes en comportent jusqu’à une dizaine, la direction crée deux légions dans chacune des régions les plus importantes. C’est le cas pour les régions de Dijon (légion de Bourgogne et de Franche-Comté), de Lyon (légion de Lyon et du Dauphiné), de Marseille (légion de Provence et des Alpes), enfin de Toulouse (légion de Guyenne et de Gascogne). Un officier général, qui prend l’appellation de commandant régional de la Gendarmerie, assure la coordination des légions avec les hautes autorités administratives régionales.
Après ces aménagements, le dispositif d’ensemble du haut-commandement comprend une inspection générale dans chacune des deux zones, commandée par un officier général, sept régions d’inspection regroupant plusieurs légions aux ordres d’un général (4 régions en zone nord et 3 régions en zone sud). Les plus importantes de ces régions d’inspection constituent un commandement régional (4 commandements régionaux).
Conséquence de l’autonomie administrative, les charges des légions augmentent considérablement. Pour les diminuer la direction met sur pied des centres d’administration, un en zone sud, installé à Chasseneuil (Haute-Vienne), l’autre en zone nord, à Courbevoie.
* *
*
La réorganisation de la Gendarmerie, consécutive à la loi du 2 juin 1942, est en cours lorsque le 11 novembre 1942 les Allemands envahissent la zone libre et occupent les 9/10e du territoire laissant le reste aux Italiens jusqu’au 8 septembre 1943.
Avant d’évaluer les conséquences de l’événement sur la Gendarmerie, rappelons-le dispositif territorial allemand en zone sud. Les autorités militaires considèrent la France méridionale comme zone d’opération et non d’occupation. Les troupes qui y stationnent sont dites d’opérations. Il n’existe pas, comme en zone nord, de Kommandantur administratives mais des états-majors purement militaires et des missions de liaison.
Le Militarbefehlshaber in Frankreich n’a pas autorité sur les forces implantées en zone d’opération rattachées au commandement de la zone d’armée en France sud ou K.H.S. (Heeresgebiet-sur-Frankreich) installé à Lyon, subordonné lui-même au commandant supérieur des troupes de l’ouest.
Au K.H.S. sont subordonnés les états-majors principaux de liaison ou H.V.S. (Hauptverbindungsstables), placés auprès des préfets régionaux, et les états-majors de liaison V.S. (Verbindungsstables) situés à l’échelon des préfets départementaux.
Bien que n’ayant pas revendiqué en zone sud « les pouvoirs de la puissance occupante », le Reich doit néanmoins y assurer la sécurité de ses troupes. C’est la raison pour laquelle Oberg prend l’initiative d’installer des kommandos de la Sipo-SD dans les chefs-lieux des préfectures régionales à l’instar de ce qui avait été réalisé en zone nord.
Le 1er mars 1943, la commission d’armistice le charge de superviser les problèmes de police. Les Kommandeurs régionaux, délégués d’Oberg, ayant sous leur autorité les services de la Sicherheitzpolizei et des S.D. ainsi que ceux de la Ordnungspolizei (police d’ordre dite Orpo), vont dorénavant contrôler et suivre l’action de la Gendarmerie.
L’extension des compétences de la police allemande, dans des régions théoriquement souveraines, est régularisée le 16 avril 1943 par la confirmation officielle, pour la zone sud, des points faisant l’objet du premier accord Oberg-Bousquet de juillet 1942. L’accord détermine, d’une part, les limites des tâches respectives des services de police français et allemands. Aux policiers allemands incombe la mission de garantir, en toutes circonstances, la sécurité des troupes d’opérations, la sécurité intérieure de la France. Aux forces de police du Gouvernement de Vichy revient la charge d’assurer le maintien de l’ordre. De l’autre, il impose aux policiers et gendarmes français de signaler aux autorités allemandes les activités communistes et terroristes, les actes de sabotage qui pourraient en résulter, et tous les renseignements recueillis sur « les organisations dissidentes ».
Le 8 juin, la direction de la Gendarmerie adresse aux commandants de légion le contenu de la déclaration d’Oberg, assorti d’un bref commentaire, signé par le général Fossier :
« J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, l’extrait d’une note en date du 16 avril par laquelle Monsieur le général Oberg, commandant supérieur de la police des S.S. en France, définit le rôle respectif de la police française et de la police allemande en zone d’opérations. Elle délimite, en outre, le cadre des contacts nécessaires entre les deux services et fixe un certain nombre de principes dont tous les officiers devront avoir connaissance. Ces principes devront servir de base aux rapports à entretenir avec les services de police allemands et, éventuellement, avec les autorités allemandes d’occupation. »
La question des rapports de la Gendarmerie avec l’occupant, en zone nord, n’a fait l’objet, avant le retour de Laval au pouvoir, d’aucune instruction d’ensemble. Chaque commandant de légion et de compagnie réagit en fonction des demandes présentées par les autorités allemandes.
Par note n° 4019/S. G du 23 août 1942, le chef du Gouvernement fixe le cadre général dans lequel doivent s’inscrire ces rapports. Seuls les préfets sont habilités à traiter par accord direct, avec l’occupant, les questions de principe concernant les concours que la Gendarmerie est susceptible de lui fournir. Les officiers peuvent ensuite en discuter les modalités de détail, sans intermédiaire, avec leurs homologues allemands.
Sur ces bases, la direction définit le rôle des différents échelons. Elle prévoit que les unités, au niveau brigade, section et compagnie, informent immédiatement et seulement dans trois cas, atterrissage d’avion, parachutage, événement grave de nature à porter atteinte à la sécurité de l’armée d’occupation, le service allemand le plus rapproché.
En dehors de ces faits, les consignes sont impératives. Sauf décision spéciale de la direction, elles ne peuvent renseigner directement l’occupant que s’il s’agit d’informations ayant trait uniquement à l’organisation de la Gendarmerie ou aux conditions matérielles de vie des troupes d’opérations. Il appartient à l’autorité administrative, seule informée le cas échéant par la Gendarmerie, si elle l’estime opportun, de fournir tous autres renseignements en particulier ceux qui concernent l’attitude de la population française vis-à-vis de la puissance occupante, les diverses activités politiques antigouvernementales (communistes, gaullistes, etc.) ainsi que la désignation des personnes pouvant se livrer à ces activités, les réfractaires au S.T.O., les Alsaciens-Lorrains en résidence dans la région.
En limitant au strict minimum les contacts directs avec les services allemands, il ne fait aucun doute que la direction générale de la Gendarmerie a érigé un garde-fou qui va contribuer à tempérer l’empressement ou le zèle de ceux, peu nombreux il est vrai, tentés d’aller plus loin dans leurs relations avec l’occupant.
Comme en zone nord depuis 1940, la Gendarmerie de la zone sud, à partir de novembre 1942, est à la merci des Allemands qui usent de tous les moyens pour la soumettre. Les accords de police conclus entre Oberg et Bousquet ne scellent pas, contrairement aux déclarations et aux apparences, l’autonomie de la police de Vichy placée sous la botte allemande.
En fait, Oberg et ses Kommandeurs régionaux contrôlent la Gendarmerie et lui donnent des instructions, soit directement, soit très souvent par l’intermédiaire des préfets ou encore des détachements de liaisons placés auprès des commissions de contrôle de l’armistice.
À la pesanteur de la police allemande s’ajoute celle des autorités militaires territoriales (E.M.P. de liaison, E.M. de liaison), de la Gendarmerie de campagne (Feldgendarmerie) et des commandants d’unités des troupes d’opérations qui prennent, comme bon leur semble, des initiatives personnelles.
* *
*
L’irruption des Allemands en zone sud fait passer au second plan des réalisations techniques peu connues mais qui défient le temps.
Il y a l’emploi des chiens policiers. Leur utilisation, tentée en 1921, n’avait pas reçu à l’époque, l’accueil escompté. L’expérimentation reprend en 1943. Elle permet de jeter les bases d’une instruction provisoire sur l’utilisation, l’entretien et le dressage des chiens de la Gendarmerie. Ce document constitue l’unique référence, dans ce domaine, jusqu’en 1990. Le 17 août 1943, la direction organise au chenil d’État de Gramat (Lot) un premier stage pratique destiné au personnel de la zone sud chargé de l’utilisation des chiens policiers et de montagne. Une seconde session, réservée à des éléments de la compagnie de Gendarmerie du Nord, se déroule d’octobre à novembre. Fin novembre 1943, la Gendarmerie dispose, sur l’ensemble du territoire, de 20 équipes cynophiles.
Autre novation liée au climat d’insécurité : l’aménagement de la législation sur l’usage des armes. Depuis la fin de l’année 1942, il ne se passe pas de mois sans que des gendarmes ne soient victimes d’agressions à main armée. Les gendarmes, en service, ne peuvent utiliser leurs armes que dans deux cas. D’une part, si l’on exerce contre eux des violences ou des voies de fait. D’autre part, s’ils sont dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les personnes ou les postes qui leur sont confiés et dans la mesure où la résistance est telle qu’elle ne peut être vaincue autrement que par la force des armes.
La loi du 22 juillet 1943 étend le droit de tirer, sans sommations, pour arrêter les personnes qui cherchent à échapper à leurs investigations, après l’avertissement répété de « Halte Gendarmerie ». La législation leur reconnaît aussi le droit de tirer, pour immobiliser les véhicules et les embarcations qui n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ou pour prévenir les tentatives d’évasion de prisonniers, sur l’unique injonction de « Halte ou je fais feu ». Dans une circulaire du 2 juillet 1943, Laval justifie les nouvelles dispositions.
« Les nombreuses attaques récentes perpétrées contre les gendarmes, les mairies et les chantiers de la jeunesse, l’audace croissante des malfaiteurs et terroristes, l’appât du gain pour les trafiquants du marché noir ont provoqué une augmentation considérable des agressions à main armée contre les personnels de la Gendarmerie. Paralysé par un règlement inadapté aux nécessités de l’heure, ce personnel se trouve sans défense… »
Après avoir énuméré les cas d’usage des armes, il annonce que les dispositions prises seront exécutoires immédiatement, dès réception de la circulaire. Le Gouvernement se charge de porter à la connaissance du public, par voie de presse, la nouvelle réglementation. Procédure peu orthodoxe. Laval autorise les gendarmes à déployer la force des armes en se fondant sur une simple circulaire ! La promulgation de la loi n’intervient que 20 jours plus tard.
Notons que la loi du 18 septembre 1943 attribue à la Police en uniforme et en civil une partie des prérogatives accordées à la Gendarmerie. Un nouveau texte, le 12 octobre, donne à la Garde, et seulement à elle, le droit de se considérer en état de légitime défense par le simple fait de se trouver « en présence de bandes ou d’individus armés ». Dans ce cas, elle a non seulement le droit de tirer, mais elle en a l’obligation lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution de sa mission.
L’ordonnance du 9 août 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine, ne remet pas en cause les pouvoirs exceptionnels conférés en propre aux gendarmes par la loi du 22 juillet 1943. Une circulaire de février 1945 précise que « l’emploi des armes, tel qu’il est défini par la loi et le décret du 22 juillet 1943 est une mesure salutaire, il importe que le personnel n’en use qu’avec mesure et discernement. »
Signe évident de la modération des gendarmes : en 1994, les dispositions sur l’usage des armes reposent sur les mêmes fondements qu’en 1943.
Toujours en 1943, la direction crée un service social. La Gendarmerie dépendait auparavant de celui des armées qui s’adaptait mal à ses besoins. La spécificité de son organisation et de ses missions réclamaient des moyens différents. Certes, chaque légion dotée de masses de secours pouvait venir en aide aux gendarmes et à leurs familles dans des cas limitativement déterminés. Cela ne suffisait pas. Le général Martin améliore la situation en fondant, au mois de juin 1944, avec l’aide financière de Laval, « La maison de la Gendarmerie ». Depuis la Fondation n’a pas cessé de se développer.
Pour le directeur général ces nouvelles structures revêtent une importance capitale :
« Le service social de la Gendarmerie ne doit pas se limiter à l’attribution de secours. Il importe avant tout de créer dans l’Arme un élan de solidarité, d’entraide, de charité, générateur des plus belles initiatives. La Gendarmerie doit être réellement une grande famille dans laquelle aucune détresse ne doit rester ignorée, sans appui, sans conseil et sans soulagement. »
Vaste et ambitieux programme dont peuvent toujours se nourrir ceux qui exercent des responsabilités, à quelque échelon que ce soit.
La réalisation d’un atelier d’imprimerie, constitué de gendarmes compositeurs, typo, conducteurs typos, linotypistes, lithographes, atteste, malgré les difficultés de l’heure, d’une volonté de modernisation.
Citons, pour l’anecdote, l’attribution à tous les gradés et gendarmes d’un sifflet « de modèle réglementaire, agréé, portant la marque « Gendarmerie nationale » gravée dans le métal. » La note du 6 octobre 1943, qui annonce sa mise en place, précise « que les circonstances actuelles exigent que cette dotation soit réalisée d’urgence. »
Une circulaire d’avril 1943 institue le port d’un insigne de la Gendarmerie nationale. D’après sa symbolique il s’agit :
« D’un écu français moderne, d’argent sommé d’un heaume de trois quart face du même. Sur fond d’émail bleu outremer à une barre noire, une épée en pol à garde d’or et lame d’argent. En cœur, brochant sur l’épée, écu suisse d’argent à une tête de lion de même. »
L’interdiction, en 1945, du port de ce vestige de l’État français, ne remet pas en question une pratique qui a toujours cours avec des insignes adaptés aux différents types de formations.
Le rattachement de la Gendarmerie au chef du Gouvernement n’entraîne pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire, une amélioration des conditions matérielles. La Garde, les G.M.R. la force gouvernementale du 1er régiment de France, plus que la Gendarmerie, bénéficient, en matière d’équipement, de casernement, de secours aux veuves, d’un traitement de faveur de la part du pouvoir. Les soldes des gendarmes sont inférieures à celles des gardes et des G.M.R. La Gendarmerie ne connaît pas une telle sollicitude.
Les unités déplacées pour le maintien de l’ordre logent dans des conditions précaires. Un peloton motorisé détaché en Haute-Savoie, pendant deux mois, au cours de l’hiver 1943-1944 est cantonné dans une école qui, malgré les rigueurs de la température, n’est pas chauffée. Pour le couchage les gendarmes ne disposent que d’un peu de paille et d’une couverture emportée au départ. En Dordogne, à la même époque, un autre peloton stationne dans une ferme abandonnée ouverte à tous les vents.
Les allocations en carburant diminuent de mois en mois. La gêne qui en résulte est d’autant plus ressentie que des missions nouvelles incombent à la Gendarmerie l’obligeant à des actions rapides en tout point du territoire. Les unités y remédient en faisant appel aux ressources locales en véhicules à gazogène, ce qui n’est pas sans inconvénient pour « la rapidité et le secret des interventions » souligne un témoin. Faute de carburant, les pelotons motorisés, sur leurs lieux d’emploi, utilisent rarement leurs véhicules. Ils remplissent leurs missions à pied.
L’insuffisance des contingents de pneus et chambres à air, pour les bicyclettes, contraignent les gendarmes des brigades à recourir aux transports publics pour effectuer les tournées de communes ou à s’y rendre à pied.
Au plan vestimentaire, l’uniforme laisse à désirer. En 1943, tous les gendarmes ne possèdent pas encore la tenue traditionnelle. Certains ne détiennent, par suite des pénuries, qu’une chemise bleue. Souvent, ils sont obligés de porter une chemise kaki avec la tenue noire ce qui n’est pas d’un heureux effet.
L’autonomie de la Gendarmerie, on ne peut le nier, a pourtant des effets bénéfiques dans le domaine technique : administration, fonctionnement, méthodes de travail. En quelques mois elle se modernise.
Sa totale dépendance à l’égard du chef du Gouvernement et surtout des préfets, chargés de centraliser tous les renseignements, d’assurer les liaisons avec les autorités allemandes pour discuter de son emploi et de coordonner son action avec celle des services de Police, est source de difficultés. Loin de s’aplanir, ces dernières vont s’accentuer, en 1944, lorsque Joseph Darnand accède au poste de secrétaire général au Maintien de l’ordre.
Fin décembre 1943, l’ambassadeur Otto Abetz et le général Oberg obtiennent le renvoi de René Bousquet. Tous deux jugent son action répressive trop timorée. Ils imposent à sa place Joseph Darnand, secrétaire général de la Milice, qui a donné des gages de son attachement à la politique de collaboration. En août 1943, n’a-t-il pas été nommé commandant dans la SS et prêté serment d’allégeance à Hitler, à huis clos, à l’ambassade d’Allemagne.
La nomination de Darnand, par décret du 30 décembre 1943, au poste de secrétaire général au Maintien de l’ordre, conduit le chef du Gouvernement à modifier l’organisation du ministère de l’Intérieur pour minimiser, dans l’opinion publique, l’impact de l’arrivée du chef de la Milice dans la haute administration policière. Laval coiffe le ministère de l’Intérieur tandis que l’ex-préfet régional de Rouen, Lemoine, devient secrétaire d’État. Son influence sur Darnand, qui n’agit qu’à sa guise, est quasiment nulle.
CHAPITRE 9 – LES HEURES DIFFICILES
Le 1er janvier 1944, le successeur de Bousquet s’installe à l’hôtel Thermal, à Vichy, avec le service technique du Maintien de l’ordre. Cet organisme, en liaison avec les intendants de police a la haute main sur les questions techniques touchant à l’ordre public. Il a en charge le montage et le suivi des opérations de police. Rien de surprenant, dès lors, si on trouve dans sa composition une majorité d’anciens officiers d’active, dont des généraux, qui jouent le rôle de conseillers militaires. La direction de la Gendarmerie y détache un officier de liaison, le capitaine Gervais.
En zone nord, le milicien Max Knipping, colonel aviateur de réserve, succède à Leguay en qualité de délégué général de Darnand. Ses services, installés 61, rue Montceau, répercutent sur la Gendarmerie de la zone nord les instructions gouvernementales en matière de police.
De concert avec Laval et Darnand, Oberg, le 5 janvier, arrête les attributions et les pouvoirs qui doivent être dévolus au secrétaire général au Maintien de l’ordre. Il les confirme dans un courrier adressé à Laval le 6 janvier.
Selon le souhait exprimé par Oberg, Darnand jouit de prérogatives plus larges que celles de Bousquet. Le décret n° 256 du 10 janvier 1944 lui donne délégation pour exercer son autorité sur l’ensemble des forces de police, corps et services qui assurent la sécurité intérieure de l’État. Une autre délégation l’habilite à signer « tous actes, arrêtés ou décisions relatifs à l’organisation, l’administration, ou l’emploi de ces mêmes forces. » En fait, la législation place sous ses ordres Police nationale, sapeurs-pompiers, gardes-voies de communication, polices spéciales, contrôle économique, services pénitentiaires et enfin Gendarmerie. D’où la subordination à Darnand de tous les directeurs des grands services : Parmentier, directeur général de la Police nationale, général Perré, directeur de la Garde, Amédée Bussière, préfet de police, général Labarthe, directeur général des G.M.R., général Martin, directeur général de la Gendarmerie.
Si le chef du Gouvernement, au regard de la loi, conserve la Gendarmerie sous sa coupe, en pratique il partage avec Darnand des fonctions essentielles comme le pouvoir disciplinaire, pour les affaires graves. Le secrétaire général au Maintien de l’ordre décide et signe des révocations.
Une loi du 20 janvier, signée par Laval et Gabolde, garde des Sceaux, accorde en outre des compétences judiciaires à Darnand. Elle l’autorise à créer, par arrêté, des cours martiales pour juger les « individus agissant isolément ou en groupe, arrêtés en flagrant délit d’assassinat ou de meurtre, de tentative d’assassinat ou de meurtre commis au moyen d’armes ou d’explosifs, pour favoriser une action terroriste. »
En vertu d’un arrêté pris le 4 février 1944, Darnand décide que la Gendarmerie participera aux exécutions capitales des individus condamnés à mort par ces juridictions. Dans un chapitre ultérieur, on examinera les modalités de sa mise en œuvre.
En quelques semaines, les mesures prises par Darnand pour combattre la Résistance sont fin prêtes. Comme il l’écrit : « les bandes du maquis seront attaquées partout où elles seront avec les effectifs et les moyens nécessaires. »
Le 3 janvier, Darnand convoque le général Martin. L’entrevue, orageuse, rapportée par le directeur général de la Gendarmerie, laisse augurer des conflits qui vont opposer les deux hommes :
« Il me dit, note le général Martin, tout le mal qu’il pensait de la Gendarmerie et de ses chefs, il me reprocha notre passivité et il m’ordonna de rendre la Gendarmerie ardente, chaude, révolutionnaire comme la Milice. Je lui répondis calmement que mon Arme était disciplinée, obéissante à la loi et à ses chefs, mais qu’elle ne serait jamais partisane et que ce ne serait pas moi qui l’engagerait dans cette voie. »
Dans les milieux collaborationistes, et tout spécialement dans la Milice, l’arrivée de Darnand provoque une joie débordante. On ne se gêne pas pour dire que tout va changer.
Les Allemands envisagent des opérations communes avec les forces de Gendarmerie. Une note de la Kommandantur de Dijon confirme leur intention. Le 21 janvier, devant les intendants du Maintien de l’ordre réunis au Thermal, le général Martin, informé des projets de l’occupant, s’élève vigoureusement contre une telle éventualité.
Fin janvier 1944, Darnand entend unifier toutes les polices en uniforme et placer ainsi la Gendarmerie, jusqu’alors relativement indépendante, sous ses ordres directs, ceci par le truchement d’une direction des personnels commune à tous les services. Le capitaine Gervais, détaché à l’état-major du S.T.M.O., a vent de son dessein. Il en rend compte au directeur général dont l’intervention, auprès de Laval, porte ses fruits. L’organisme imaginé par Darnand ne verra jamais le jour.
* *
*
Doté de pouvoirs très étendus, le secrétaire général au Maintien de l’ordre cherche, par tous les moyens, à diriger la Gendarmerie.
En zone nord, Max Knipping convoque le lieutenant-colonel Sérignan aux réunions hebdomadaires qui regroupent, au plus haut niveau, tous les chefs des services de police. Le représentant de la Gendarmerie y défend les intérêts de l’Arme, sans cesse critiquée. Il s’oppose à toutes les tentatives des hommes de Darnand visant à perturber son fonctionnement et à remettre en cause les principes de son action. Il soutient aussi la cause des militaires de la Gendarmerie menacés par la Milice.
D’avril 1944 jusqu’à la Libération, le délégué du secrétaire général au Maintien de l’ordre et l’inspecteur général au Maintien de l’ordre, qui travaillent en liaison étroite avec les services de police allemands, convoquent fréquemment le lieutenant-colonel Sérignan. Ce dernier doit répondre à des accusations ou dénonciations touchant le plus souvent des officiers. Dans ces circonstances il est amené à défendre plusieurs commandants de légion. Il évite l’internement au colonel Le Du (légion de Gendarmerie de Paris-nord) et des sanctions graves au colonel Charollais (légion de Paris-est), Le Guennec (légion de Bourgogne), Pouilly (légion de l’Orléanais), Samson (légion d’Aquitaine), Maujean (légion de Bretagne), Simonpoli (école d’application de Courbevoie). Une telle pugnacité n’est pas du goût de Darnand qui, à plusieurs reprises, dénonce son attitude à la direction générale.
Pour sa part, la direction de la Gendarmerie, sans toujours réussir, intervient auprès de Darnand pour que les gendarmes ne soient pas soustraits à l’autorité directe de leurs chefs, ni détournés de leurs missions traditionnelles.
Par télégramme n° 1089/1090 du 23 janvier 1944, Darnand demande aux préfets de sanctionner les gendarmes qui manqueraient à leurs obligations dans la lutte contre « les terroristes ». Dès la réception de cette directive les destinataires invitent les commandants de légion à leur signaler toute « défaillance des personnels sous leurs ordres et de proposer les sanctions adéquates. »
Le S.G.M.O., par note n° 303 du 31 janvier, beaucoup plus dissuasive, fait connaître à tous les services de Police et de Gendarmerie que Darnand, au vu des rapports circonstanciés établis par les directeurs généraux des services, Gendarmerie, Garde, Police nationale, sanctionnera personnellement « les gardes, gendarmes et gardiens qui se laisseraient désarmer par les terroristes, soit par manque de vigilance, soit par leur désir de composer avec leurs adversaires. »
Le général Martin n’admet pas que les préfets puissent punir les gendarmes. Aussi rappelle-t-il avec insistance à Darnand que les questions de discipline sont exclusivement de son ressort. Madré, le secrétaire général au Maintien de l’ordre contourne la difficulté. Par circulaire n° 88/S.G.M.O. du 4 mars il modifie les dispositions initiales en indiquant aux préfets que « leur action ne saurait avoir pour conséquence, en ce qui concerne la Gendarmerie et la Garde, de soustraire leur personnel à l’action directe des chefs hiérarchiques de l’Arme, action qui comporte des pouvoirs disciplinaires dont le partage ne saurait se concevoir. »
À défaut de sanctions disciplinaires, Darnand prescrit aux préfets de prendre des mesures administratives contre les gendarmes défaillants ou négligents dans la lutte contre les « terroristes ». L’internement se substitue aux punitions à caractère strictement interne.
La direction s’incline. Par dépêche du 20 avril, le directeur général donne l’ordre aux commandants de légion de rendre compte aux préfets des sanctions disciplinaires prises à l’encontre des gendarmes ayant manqué à leurs obligations, ceci pour qu’ils puissent prendre, le cas échéant, des mesures administratives contre eux.
Pour éviter l’internement aux gendarmes menacés, des officiers freinent, autant qu’ils le peuvent, les procédures engagées.
Courant avril 1944, au petit matin, en Dordogne, au lieu-dit « La Roche » 6 individus armés et masqués enlèvent une passagère, dans le train départemental Excideuil-Périgueux, malgré la présence de deux gendarmes totalement passifs.
Quarante-huit heures après, les ravisseurs, membres de la Résistance, la ramènent à son domicile. Elle n’a subi aucun sévice et déclare qu’elle ne peut fournir le moindre renseignement car on lui a bandé les yeux. Le gendarme C…, chef de patrouille, fait l’objet d’une proposition de révocation et le gendarme M… d’une suspension d’emploi pour une durée de 6 mois.
Comme le prévoient les instructions de Darnand, le commandant de légion informe le préfet régional de Limoges des sanctions proposées. Ce dernier lui répond :
« Je ne puis qu’approuver les sanctions disciplinaires que vous avez proposées à la direction de la Gendarmerie. J’estime, en ce qui me concerne, que ces deux militaires âgés respectivement de 37 et 34 ans méritent d’être affectés d’urgence au S.T.O. en Allemagne. Je vous prie de bien vouloir me faire connaître d’urgence si vous approuvez cette manière de voir et, dans l’affirmative, je vous adresserai sans délais des arrêtés prescrivant l’internement des gendarmes C… et M… au centre de séjour surveillé de Nexon. »
Pas plus que le préfet, le commandant de légion n’est pressé de clôturer l’affaire. Il demande à l’autorité administrative de différer l’application de la mesure envisagée jusqu’à ce qu’une décision définitive, sur le plan disciplinaire, soit prononcée et notifiée aux intéressés.
Nous sommes alors le 19 mai. Le 6 juin, la brigade d’Excideuil, à laquelle appartiennent les deux gendarmes incriminés, rallie le maquis. Parmi les déserteurs se trouvent les gendarmes C… et M…
La direction n’entérine les propositions de sanctions que le 19 juin. Manifestement, le dossier n’a pas été traité avec célérité.
Au mois d’avril 1944, le Gouvernement confère de nouveaux pouvoirs à Darnand. La loi n° 185 du 15 avril, inspirée par les miliciens, renforce son autorité sur les forces de l’ordre. Ce texte subordonne Police et Gendarmerie aux intendants du Maintien de l’ordre. Cette subordination est dommageable à l’Arme car, pour la plupart, ils ne la connaissent pas et n’ont aucune idée de son organisation, de son service, de sa déontologie et de ses possibilités.
Dans les zones dites « d’opération », Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Vichy, Dijon, etc. les intendants délèguent leurs pouvoirs si bien que les gendarmes des unités territoriales et supplétives se trouvent souvent sous les ordres de miliciens, de G.M.R. ou d’officiers de la Garde.
En Auvergne, le lieutenant-colonel commandant le groupement des forces de Maintien de l’ordre de Clermont-Ferrand coiffe la gendarmerie départementale. De même, dans le Limousin, le milicien de Vaugelas exerce son autorité sur l’ensemble des forces de Gendarmerie.
Datée également du 15 avril, la loi n° 184 porte création d’une super-police politique : l’inspection générale du Maintien de l’ordre. Sa mission : contrôler l’activité des forces de police, corps et services qui assurent la sécurité publique et la sûreté intérieure de l’État. Cet organisme comprend un inspecteur général, trois inspecteurs généraux adjoints et vingt-deux chargés de mission temporaire, tous assermentés et ayant la qualité d’officier de police judiciaire.
La Gendarmerie est assujettie au contrôle de l’inspection générale du Maintien de l’ordre. Obligation lui est faite, s’ils en font la demande, de communiquer à ses membres « tous les renseignements qu’elle détient relativement aux questions qui lui sont posées. »
Laval annonce ces mesures lors d’une réunion au Thermal. Déjà il pressent les réactions qu’elles ne vont pas manquer de susciter :
« Cela, indique-t-il, va faire bondir et protester le préfet de police et le directeur de la Gendarmerie qui, jusqu’à présent, avaient leur hiérarchie propre et leur indépendance. Qu’ils se rassurent. Le décret d’application sera étudié avec eux et il sera tenu compte de leurs désirs et de leurs observations. »
Le général Martin prend acte de l’engagement de Laval. Cependant les motifs de désaccords entre les services de Darnand et la Gendarmerie, loin de s’atténuer, s’accentuent. Ils portent essentiellement sur les questions de discipline, de commandement et d’emploi des unités.
Des intendants du Maintien de l’ordre exigent des gendarmes qu’ils saluent les miliciens. D’autres veulent prononcer des mutations, voire des nominations. Certains même commandent directement sur le terrain des formations de Gendarmerie. Bref, il y a une tentative de mainmise totale sur la Gendarmerie. Ce ne sont pourtant que les signes avant-coureurs d’une situation qui ne tarde pas à dégénérer.
Au mois d’octobre 1943, l’intendant de police Hornus, en poste à Toulouse, à l’occasion d’une visite au camp d’internement de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) donne au capitaine commandant les forces de Gendarmerie chargées de la surveillance des ordres à l’opposé de ceux que l’intéressé a reçus de sa hiérarchie. L’officier en prend note mais affirme clairement à l’intendant qu’il n’exécutera ses directives que dans la mesure où elles seront confirmées par la direction de la Gendarmerie. Hornus de rétorquer : « Trêve de plaisanterie M. René Bousquet donne des ordres à la direction de la Gendarmerie. »
Fin décembre 1943, Hornus provoque un nouveau litige. Il se rend au siège de la section de Gendarmerie de la Haute-Garonne et déclenche, sans en référer à l’officier responsable, une alerte pour tester les réactions des gendarmes dans l’hypothèse d’une agression contre la maison d’arrêt de Toulouse. L’exercice terminé, il invite un des gradés présents à prévenir le commandant de section.
Dans les jours qui suivent, le général commandant la région de Gendarmerie adresse des représentations écrites au préfet régional :
« […] En vous informant de ces faits je me vois dans l’obligation de vous demander d’user de votre autorité pour mettre un terme à de tels abus que la Gendarmerie et ses officiers, formés à la suite de concours et d’une longue pratique, ne méritent pas. »
Autre exemple de conflit provoqué par des fidèles de Darnand. Le 16 juin 1944, une violente altercation oppose le lieutenant-colonel Vernageau, commandant la légion du Languedoc, à l’intendant du Maintien de l’ordre, Hornus, muté de Toulouse à Montpellier et à Reboulleau directeur de cabinet du préfet régional M. Montbeyrié. En l’absence de ce dernier, arrêté par les Allemands, l’administration préfectorale est au main des hommes de Darnand. Reboulleau, en uniforme de capitaine de la Milice, invective le commandant de légion qu’il a convoqué pour assister à une réunion :
« Les gendarmes, de beaux salauds, vocifère-t-il, qui se rendent sans combattre, sans tirer un coup de fusil. »
De son côté, Hornus insiste pour que le commandant de légion fasse comme lui et s’installe dans le bureau de Reboulleau pour pouvoir donner plus vite ses ordres à ses commandants de compagnie. Il lui demande ensuite d’engager les forces de Gendarmerie dans des opérations offensives contre le maquis, conjointement avec la Milice. L’officier refuse formellement et quitte immédiatement le bureau.
Le 17 juin, sur ordre de Darnand, la direction relève le lieutenant-colonel Vernageau de ses fonctions. Le 19, le colonel D…, inspecteur par intérim de la 7e région, lui notifie la décision. Admis à la retraite d’office, le 20 juin, le commandant de légion est définitivement rayé des contrôles le 15 juillet.
À la mi-juin 1944, Laval nomme Darnand secrétaire d’État à l’Intérieur, fonction qu’il cumule avec celle de secrétaire général au Maintien de l’ordre. Pour forcer l’obéissance des membres de la force publique, Darnand institue, en vertu de la loi n° 331 du 15 juin, les tribunaux du Maintien de l’ordre. Ces juridictions instruisent et jugent « les abandons de poste » et les autres crimes et délits contre le devoir et la discipline, qu’ils soient commis par des policiers ou des gendarmes. Les jugements rendus, exécutoires immédiatement, ne sont susceptibles d’aucun recours ni pourvoi en cassation.
En apprenant, courant mai, par l’intermédiaire de l’officier de liaison au S.G.M.O., que la loi est en préparation, le directeur de la Gendarmerie tente de dissuader les services de Darnand d’élaborer ce projet inadapté à la Gendarmerie. En effet, les gendarmes, militaires par leur statut, bien que rattachés au chef du Gouvernement, ont déjà leur tribunal spécial, le tribunal militaire qui réprime précisément les infractions justiciables des tribunaux du Maintien de l’ordre.
Darnand ne semble pas devoir céder malgré les arguments développés par le général Martin. Celui-ci, néanmoins, lui arrache des concessions appréciables. D’une part, il obtient que la loi ne sera pas applicable aux gendarmes pour des infractions commises antérieurement au 15 juin. Pour Darnand, la loi devait être rétroactive. Ainsi, en cas d’arrestation, les nombreux gendarmes qui, depuis le début juin, ont abandonné leur poste pour rallier la Résistance risqueront une condamnation moins sévère devant une juridiction militaire que devant un tribunal du Maintien de l’ordre où siègent des miliciens. D’autre part, le directeur de la Gendarmerie prend l’initiative de modifier les conditions de saisine du tribunal lorsque des gendarmes sont susceptibles d’être incriminés. Pour Darnand, préfets et intendants du Maintien de l’ordre sont habilités à saisir directement le tribunal lorsqu’ils ont connaissance, de quelques manières que ce soit, que des gendarmes se sont rendus coupables d’une infraction à la loi du 15 juin. Le directeur de la Gendarmerie considère que c’est lui seul, sous sa responsabilité, qui soumet à Darnand les dossiers des personnels placés sous son autorité. Le 15 juin, il rédige dans ce sens l’instruction d’application de la loi à la Gendarmerie. Comme le révèle cette note, le général Martin n’en est pas moins inflexible sur les sanctions à prendre à l’égard des gendarmes défaillants. Parmi eux il distingue plusieurs catégories.
La première regroupe les officiers, gradés et gendarmes passés volontairement « dans les rangs des éléments de désordre ou de résistance ». Ils sont passibles de la procédure prévue par la loi. Pour lui, les intéressés se sont exclus volontairement de la Gendarmerie. Dans ces conditions, quel que soit leur sort, ni eux ni leurs familles n’ont en conséquence plus aucun droit en matière de solde, d’indemnité, de secours, de collecte-décès.
La seconde comprend tous les personnels qui ont désobéi à l’ordre de regroupement donné par Darnand, le 8 juin, en se cachant provisoirement ou en restant sur place dans leurs brigades. Eux aussi tombent sous le coup de la loi.
À la troisième catégorie appartiennent ceux qui, passés involontairement dans les rangs de la « dissidence », n’ont rien tenté de ce qu’il leur était possible de faire pour résister avec quelques chances de succès. Dans la mesure où une enquête complète et minutieuse peut déterminer s’ils ont eu la faculté de résister, le directeur leur accorde le bénéfice du doute. Les militaires contraints de se joindre aux maquisards sont assurés de l’impunité. Ce dernier cas sera fréquemment invoqué dans les rapports hiérarchiques pour protéger les personnels partis au maquis en toute connaissance de cause.
L’application de la loi du 15 juin, comme il fallait s’y attendre, génère de multiples incidents, malgré les précautions prises par le général Martin pour en atténuer la portée.
En Auvergne, le 27 juin, sans que le commandement de la Gendarmerie n’en soit informé, et alors qu’il était convenu que seul le directeur de la Gendarmerie pouvait adresser des propositions de traduction de gendarmes devant les tribunaux du Maintien de l’ordre, le délégué de Darnand fait comparaître deux gendarmes devant une de ces juridictions pour des faits relevant d’une simple sanction disciplinaire. Bien qu’acquittés, après le jugement qui les innocente, malgré l’intervention de leurs chefs, ils restent 18 jours sous réquisition d’écrou.
Moins de deux semaines après, le lieutenant-colonel de la Garde, commandant les forces du Maintien de l’ordre, propose directement aux services de Darnand la comparution devant la même juridiction de deux gendarmes désarmés par des maquisards à la suite d’une attaque surprise.
Sur l’ensemble du territoire, et sans jamais prendre l’avis de la direction de la Gendarmerie, des autorités administratives font comparaître une vingtaine de gendarmes devant les tribunaux du Maintien de l’ordre. Le général Martin obtient leur relaxe comme à Nîmes, Marseille, Lyon, etc. Sans succès, il demande même des sanctions contre plusieurs présidents de ces juridictions « pour attitude illégale et inhumaine. »
Les réactions du commandement, à l’égard des personnels justiciables de la loi du 15 juin, varient d’une légion à l’autre.
La décision du général Martin d’apprécier personnellement l’opportunité d’envoyer des gendarmes devant un tribunal du Maintien de l’ordre décharge les échelons intermédiaires d’une mission redoutable et redoutée.
Entre le 15 juin et la mi-août, les dossiers concernant les déserteurs affluent par milliers à Vichy assortis de transmissions lapidaires des échelons hiérarchiques du type :
« Le gendarme C… a quitté sa brigade le 18 juin 1944. Il est déserteur et justiciable du tribunal chargé de juger les éléments du M.O. »
Dans les fichiers, les notices de recherches des déserteurs s’accumulent.
Sur ordre de la direction, beaucoup de légions suspendent le paiement de la solde des militaires qui ont abandonné volontairement leur poste pour rallier le maquis. Certains chefs prennent une position moins radicale et signalent que leurs subordonnés ont été amenés de force. En cas d’arrestation ils leur évitent d’être traduits devant les tribunaux du Maintien de l’ordre. D’autre part, les familles continuent de percevoir la solde due aux gendarmes « enlevés ».
Plus audacieux, des gradés et des officiers diffèrent purement et simplement l’envoi des dossiers. Tous les prétextes sont bons pour les refouler : renseignements incomplets, complément d’information demandé, etc. Beaucoup n’arriveront jamais à l’administration centrale.
En l’état des informations actuelles, on peut considérer que le directeur de la Gendarmerie n’a jamais adressé à Darnand des dossiers proposant l’envoi de personnels de l’Arme devant les tribunaux du Maintien de l’ordre.
Des commandants de légion et de région, en revanche, n’ont pas hésité à mettre à la disposition de la justice militaire des sous-officiers déserteurs. Très peu nombreux, la plupart d’ailleurs ne seront jamais jugés. Ainsi, le 8 août, à quelques semaines de la libération, le colonel D…, commandant une région d’inspection en zone sud rend compte à la direction que « le gendarme S… de la brigade de L… déserteur du 12 juin 1944, arrêté fin juin est mis à la disposition du commissariat régional à la Défense de L… en date du 5 août en vue de sa traduction devant un tribunal militaire. » Le gendarme S… recouvre la liberté, fin août, au départ des troupes allemandes en déroute.
En matière de sanctions, des autorités étrangères à la Gendarmerie se substituent à la hiérarchie pour punir ou récompenser des gendarmes selon qu’ils se mettent en évidence par des actions d’éclat ou qu’ils se signalent défavorablement. Dans différentes zones d’opérations, des commandants de groupements de forces du Maintien de l’ordre, n’appartenant pas à la Gendarmerie, mettent et détiennent aux arrêts des militaires de l’Arme sans en avertir leurs chefs. D’autres délivrent aux gendarmes méritants des satisfecit. Le directeur du groupement d’opérations de Limoges cite à l’ordre du groupement, au cours du premier trimestre de l’année 1944, le lieutenant L… commandant le groupe des pelotons motorisés stationnés en Corrèze :
« Au cours d’une opération de police dans la région d’Ussel, mentionne le libellé de la citation, a montré de belles qualités professionnelles dans les recherches poursuivies pendant deux jours de dangereux individus. Par des dispositions habiles a réussi à découvrir le repaire et à capturer cinq malfaiteurs avec un stock important de munitions et d’explosifs. »
Comme les personnels des forces supplétives, les gendarmes des brigades obtiennent félicitations et gratifications. Le milicien de Vaugelas cite en mai 1944 le gendarme B… de la brigade de Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) qui s’est distingué, au début du mois, lors de l’attaque de la caserne par un groupe de la Résistance :
« Assailli le 1er mai 1944 par six terroristes armés, et mis en demeure de faire ouvrir la porte du bâtiment de sa brigade, a refusé catégoriquement. S’est ensuite dégagé sous le feu et a réussi à rallier les éléments de renforts qui ont participé au dégagement de la Gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Gorre avec lesquels il a eu une conduite exemplaire. »
Darnand n’hésite pas à stimuler les gendarmes. Le 7 mars 1944, le général Martin lui adresse « les tableaux des statistiques générales du service » de l’année 1943. Ce document récapitule l’activité annuelle de l’ensemble des unités. En réponse à ce courrier, Darnand exprime ses très vives félicitations aux officiers et gendarmes :
« Je note avec satisfaction l’importance des résultats obtenus par la Gendarmerie dans les divers domaines de son activité. J’en apprécie d’autant la valeur qu’ils ont été acquis dans des circonstances chaque jour plus difficiles et malgré une augmentation sans cesse croissante des nombreuses charges qui pèsent sur votre corps. La Gendarmerie a donné, au cours de l’année écoulée, une nouvelle preuve de son loyalisme et de son esprit de sacrifice ainsi qu’en témoignent les lourdes pertes qu’elle a subies… »
À cette occasion, il annonce son intention de réduire au maximum la participation de la Gendarmerie aux opérations importantes de maintien de l’ordre pour lui permettre, comme l’a demandé à plusieurs reprises le général Martin, de se consacrer à sa mission primordiale de surveillance du territoire. Cet effet d’annonce n’aura pas de suite. Au lieu d’être réduit, l’engagement de la Gendarmerie s’intensifie dans des conditions qui ne correspondent absolument pas à ses règles d’emploi.
En Bourgogne, courant mars 1944, l’intendant du Maintien de l’ordre, en exécution d’une instruction du 28 février, met sur pied, à titre expérimental, trois corps francs mixtes chargés de traquer les « terroristes » dans la région. Ces formations ont une ossature à base de gendarmes ou de G.M.R. et d’inspecteurs de police.
Le groupe franc « Côte d’Or », de la Gendarmerie, commandé par un officier, comprend quatre inspecteurs de la police de sûreté et trente gendarmes. Après quelques semaines de fonctionnement, il compte à son actif l’arrestation de 57 « terroristes » et la saisie de plusieurs tonnes d’armes et d’explosifs. Malheureusement, un groupe de maquisards, capturés le 21 avril à Fontsegrive, connaît une fin tragique. Une Cour martiale instituée à Besançon en condamne six à la peine capitale. Les autres, livrés aux Allemands, sont déportés.
Fort des succès obtenus, le représentant de Darnand en Bourgogne invite le général Durand, inspecteur de la Gendarmerie de la 4e région, à organiser des unités de ce type dans chacun des départements placés sous son autorité. Dans le même temps, il demande à Vichy la généralisation de l’expérience.
Max Knipping le félicite et lui annonce son intention de créer, en zone nord, des corps francs similaires. En zone sud, plusieurs intendants du Maintien de l’ordre essayent de convaincre les préfets de région de s’engager dans la même voie. À Toulouse, l’intendant Pierre Marty souscrit avec enthousiasme à l’idée de constituer des corps francs. S’adressant au préfet il écrit :
« Il n’est pas douteux qu’à l’heure actuelle l’organisation de la Gendarmerie, se traduisant, en définitive, par une dissémination de poussières de brigades de deux à quatre unités, sur l’ensemble du territoire de la région, rend presque toujours inopérante l’action de ce corps du maintien de l’ordre. Il est certain que deux ou trois gendarmes, perdus dans une campagne infestée de maquisards, ont une tendance bien naturelle à ne pas manifester une activité qui mettrait en danger non seulement leurs jours mais ceux de leurs familles. Actuellement le gendarme se sent isolé, perdu, sans défense, au milieu de bandes organisées, puissamment armées et sans pitié. Il me semble donc qu’il y aurait intérêt, dans chaque département, non pas à regrouper la totalité des brigades mais à constituer, par prélèvement sur les plus importantes d’entre elles, une sorte de « brigade de choc » constituée par 20 ou 25 gendarmes sous le commandement d’un officier énergique et plein d’allant… »
Ayant fait part de son projet au colonel D…, inspecteur par intérim de la 7e région de Gendarmerie, ce dernier, selon Pierre Marty « a paru s’y intéresser et en a admis le principe ». Il est déjà trop tard. Nous sommes en juin 1944. Le débarquement des Alliés en Normandie et le regroupement des unités territoriales bouleversent toutes les prévisions si bien qu’à l’exception du corps franc créé en Côte-d’Or aucun autre ne voit le jour dans la Gendarmerie.
De février à août 1944, Darnand intègre les forces supplétives de Gendarmerie dans les groupements d’opérations qui traquent les maquisards dans les régions de Vichy, Limoges, Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Châlons-sur-Saône. Ces forces sont placées indifféremment sous les ordres de miliciens, d’officiers de la Garde ou des G.M.R.
Dans la région administrative de Limoges, les forces supplétives de Gendarmerie employées initialement en renfort des brigades territoriales passent, début mars 1944, sous l’autorité directe de l’intendant Chauvin et du commandant des forces du Maintien de l’ordre. À la création du groupement des forces de Limoges, en avril 1944, le milicien de Vaugelas coiffe l’ensemble du dispositif. On observe des situations comparables dans d’autres régions.
La gendarmerie départementale n’échappe pas à l’emprise des féaux de Darnand. Une dépêche ministérielle du 21 janvier 1944 enjoint aux commandants de brigades de porter à la connaissance des directeurs des groupements d’opérations, en mission sur leurs circonscriptions, tous les renseignements se rapportant aux activités « terroristes ».
La subordination de la Gendarmerie aux intendants du Maintien de l’ordre et aux directeurs des groupements d’opérations se poursuit, insidieusement, par touches successives. Les commandants de légion reçoivent l’ordre de remettre à ces autorités un exemplaire de la notice de chiffrement utilisée par la Gendarmerie pour protéger la transmission de ses informations internes.
La tendance se généralise ensuite d’employer les forces supplétives de Gendarmerie dans des opérations offensives. Deux cents gendarmes de la région parisienne, déplacés en Auvergne pour remplir initialement des missions statiques (gardes d’installations sensibles), sont finalement engagés dans la recherche des maquisards.
Dès novembre 1943, le secrétaire d’État à l’Intérieur, en prévision de troubles graves, invite les préfets régionaux à établir des plans de maintien de l’ordre. Ceux-ci prévoient l’emploi de la Gendarmerie. Dans l’éventualité de désordres généralisés, le plan de M.O. donne aux préfets la totalité des pelotons de réserve territoriale de la région, malgré leur caractère intégral de réserve ministérielle, et une partie des pelotons de réserve motorisés ainsi que des sections dites « supplétives ». Ces dernières sont constituées par prélèvement sur les effectifs des brigades territoriales, déduction faite des personnels nécessaires à la mise sur pied de pelotons de réserve territoriale.
Au cours du premier trimestre de l’année 1944, le Gouvernement affine le dispositif. Le 23 mars, Laval diffuse une instruction générale aux forces françaises du Maintien de l’ordre pour leur fixer la conduite à tenir en cas de débarquement ou d’opérations militaires se déroulant sur le territoire.
Une circulaire secrète du 25 avril, diffusée sous n° 171 S.G./S.T.M.O., précise les conditions d’application des mesures énumérées dans l’instruction générale. Dans ses grandes lignes, elle prévoit l’arrestation des individus considérés comme spécialement dangereux répertoriés dans les fiches « S ». Elle définit également l’articulation des forces du M.O. en vue de leur emploi dans une situation insurrectionnelle. À l’échelon départemental, le commandant de compagnie de Gendarmerie devient commandant des forces statiques en uniforme. Dans cette hypothèse, la police urbaine, les douanes, les gardes des voies de communication relèvent de son autorité. Ce schéma ne s’applique pas dans les grandes villes. Quant aux forces mobiles, constituées par la Garde, les G.M.R., la Milice, elles dépendent d’un responsable régional, chef milicien ou intendant du Maintien de l’ordre le plus souvent.
Le plan conçu par Darnand, mis en œuvre à partir du 6 juin 1944, bien qu’aménagé, ne résistera pas à l’épreuve des événements.
La mainmise qu’exerce Darnand sur la Gendarmerie, par le truchement de diverses autorités, provoque un effet désastreux sur le moral des personnels. Elle suscite une réaction du commandement.
Dans le rapport qu’il adresse à Darnand, le 20 juillet 1944, le général Martin s’élève contre les excès dont la Gendarmerie et ses personnels sont victimes. Ce n’est pas un hasard si son intervention coïncide avec celle du général Perré, directeur de la Garde, confronté aux mêmes difficultés.
La protestation du directeur a un double effet. D’abord, Darnand invite par télégramme tous les préfets régionaux à n’employer la Gendarmerie que pour l’exécution de missions statiques. Ensuite, il organise une conférence à laquelle participe un représentant de la section technique du M.O. au cours de laquelle il donne l’assurance qu’elle ne recevra plus d’ordres d’autorités qui lui sont étrangères : chefs miliciens, officiers de la Garde et des G.M.R.
Le mal est si profond que la démarche du chef de la Gendarmerie n’a pas, sur le terrain, les effets escomptés. Sans doute, est-elle trop tardive, comme l’est la réprobation exprimée par Pétain dans une lettre du 6 août adressée au secrétaire général du Maintien de l’ordre :
« Depuis plusieurs mois de nombreux rapports me signalent l’action néfaste de la Milice. La Garde et la Gendarmerie me semblent particulièrement atteintes. Une agitation constante est menée contre ces armées de métier, des soupçons sont quotidiennement proférés contre leurs chefs. Les demandes de radiation succèdent dans le désordre à des mises à la retraite ou, au contraire à des promotions injustifiées qui désorientent les esprits et désorganisent le commandement de ces forces dont le seul but devrait être de servir loyalement le pouvoir légal. »
* *
*
L’État français, en cette fin juillet, agonise. La direction générale de la Gendarmerie vit, elle-même, ses derniers jours.
Le général Martin quitte Vichy, pour Paris, le 9 août. Le 14, Knipping l’informe de l’imminence du désarmement, par la police allemande, des G.M.R., de la Garde et des pelotons motorisés de Gendarmerie stationnés en zone nord. Darnand ne se résigne pas. Il demande à la direction de recruter des gendarmes volontaires en vue de constituer de nouvelles unités de combat, puissamment armées, qui combattraient aux côtés de la Milice contre les « terroristes ». La Gendarmerie ne donne aucune suite à sa demande qui ne recueillera pas davantage l’adhésion de la Garde et des G.M.R. Le projet, à peine conçu, avorte.
Le 16 août marque la fin de la tutelle de Darnand sur la Gendarmerie. Par l’entremise du colonel Charollais, commandant la Garde de Paris, le colonel Martin obtient une entrevue avec un responsable de la Résistance. La rencontre avec le colonel Lizet, dit « Margueritte », chef départemental des F.F.I. de la Seine, a lieu à la caserne des Célestins. Le directeur de la Gendarmerie propose au colonel Lizet de mettre à sa disposition les quelque 6 000 gendarmes dont il dispose. À cette offre de service, pour le moins tardive, son interlocuteur ne répond pas.
Déjà, depuis le 13, le Comité directeur du Front national de la Gendarmerie de l’Île-de-France et de l’Orléanais, en liaison avec le colonel Rol-Tanguy, a décidé une véritable « grève » de la Gendarmerie. Par délégation du colonel commandant la Gendarmerie de l’Île-de-France et de l’Orléanais, le président du Comité directeur s’adresse, par note de service, à tous les chefs responsables de casernes :
« 1° – Le personnel sous vos ordres devra se mettre en tenue civile.
2° – N’assurer aucun service en tenue militaire.
3° – Mettre en lieu sûr tout le matériel (autos, motos, bicyclettes) non encore réquisitionné par l’ennemi (les archives des bureaux, les vivres de réserve, les effets d’habillement).
4° – Prévoir repli pour les familles.
5° – Éventuellement prendre sans hésitation le maquis (avec les armes).
6° – Ne pas quitter la région parisienne et se tenir prêt à répondre à tout appel lancé par le colonel commandant la Gendarmerie de l’Île-de-France, l’Orléanais et le comité directeur. »
Le 14, par voie d’affiches, le commandant de la région de Paris des F.F.I. lance un appel aux membres des forces de l’ordre, Police parisienne, Garde républicaine, Gendarmerie, Garde, G.M.R., pour qu’ils se rangent aux côtés des patriotes.
Quelques jours après, le 19, Alexandre Parodi, délégué du Gouvernement provisoire de la République, place sous le commandement de Rol-Tanguy les forces de la Résistance et gouvernementales (Police, Garde de Paris, Gendarmerie). Comme on se méfie des gendarmes, on ne leur donne pas d’instructions précises.
En cette fin du mois d’août 1944, la pression des F.F.I. autour de Vichy s’accentue. Le 26, les Allemands évacuent la ville. Depuis le 20, contraint par l’occupant, Pétain sous escorte a pris la route de l’Allemagne pour rejoindre Singmaringen. Quant à Laval, il s’enfuit aussi vers le Reich avec ses miliciens.
La Gendarmerie de l’État français a vécu.
Dans le message radiodiffusé qu’il adresse au pays, le 20 juin 1940, pour lui annoncer la signature de l’armistice, le maréchal Petain, dernier chef de Gouvernement de la IIIe République agonisante tenue pour responsable de la défaite avec les francs-maçons, les socialistes, les communistes et les Juifs, laisse entendre son intention d’instaurer un ordre nouveau :
« Nous tirerons, déclare-t-il, la leçon des batailles perdues. Depuis la victoire, l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu’on a servi. On a voulu épargner l’effort, on rencontre aujourd’hui le malheur. »
Moins d’un mois plus tard, investi par l’Assemblée nationale de tous pouvoirs pour rédiger une nouvelle Constitution, le maréchal engage le pays dans la voie « du redressement intellectuel et moral », toile de fond du programme de la Révolution nationale.
IV – L’ENTREPRISE D’ASSUJETTISSEMENT
CHAPITRE 10 – L’EMPREINTE DE L’ÉTAT FRANÇAIS
À l’instar de toutes les administrations, la Gendarmerie adopte les valeurs nouvelles qui reposent sur le culte du maréchal, la purification du corps social, l’exaltation de la Patrie, des principes religieux et moraux.
En imposant aux hauts fonctionnaires et aux agents de l’administration l’adhésion à la personne du chef de l’État, considéré comme « l’homme providentiel », le régime de Vichy n’innove pas. Dans le passé, pour ne rappeler qu’un exemple, sous la monarchie de juillet, fonctionnaires et militaires jurent fidélité au souverain Louis Philippe ainsi qu’obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.
Dès le mois d’octobre 1940, comme les militaires, les gendarmes prêtent le serment de fidélité au maréchal libellé en ces termes :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l’État, promettant de lui obéir en tout ce qu’il me commandera pour le bien du service et le succès des armes de la France. »
Véritable acte d’allégeance, il lie sur l’honneur, à Pétain, ceux qui le prononcent.
Le nouveau statut de la Gendarmerie, élaboré en 1942, en prévoit expressément les modalités dans les articles 16 et 22. Le premier dispose que « le personnel de la Gendarmerie, officier compris, prête serment de fidélité au chef de l’État conformément à l’acte constitutionnel n° 8. » Le second stipule que « le serment de fidélité au chef de l’État est prêté par écrit, dès admission dans la Gendarmerie, par tous ceux qui ne l’ont pas fait antérieurement, suivant la formule fixée par l’acte constitutionnel n° 8. L’acte de prestation est ensuite classé dans le dossier des intéressés. »
Aucune solennité, du moins dans la Gendarmerie, n’entoure cette formalité contrairement à l’assermentation relative au service spécial, fondée sur le devoir d’obéissance, moins chargée d’affectivité et de passion, reçue par les présidents des tribunaux de première instance siégeant en audience publique. Du reste son contenu n’a pas varié depuis l’Occupation.
« Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. »
Le 23 juillet 1944, avant même que le territoire ne soit libéré, une instruction provisoire, émanant du nouveau commandement de la Gendarmerie, prescrit à tous les échelons d’extraire des dossiers du personnel les documents manuscrits constatant prestation de serment de fidélité au chef de l’État en vue de les détruire. Dès lors, toute exploitation malveillante de ce document devenait impossible.
Le refus de se soumettre à l’obligation du serment entraîne la révocation immédiate. La menace d’exclusion incline la quasi-totalité des fonctionnaires et militaires à ne pas s’y dérober. Deux personnalités font exception à la règle qui refusent de s’y plier : le juge Didier et un membre du Conseil d’État, M. Blondeau.
Dans la Gendarmerie, on ne connaît pas d’irréductibles. Tout le monde, semble-t-il, signe. Un petit bout de phrase tombait à pic qui allait emporter la décision des hésitants : il fallait obéir au chef de l’État en tout ce qu’il commanderait pour le bien de la France. Or ce bien là, la majorité le voulait. À l’évidence, les termes généraux de la formule n’incluaient pas, explicitement, d’engagement à l’égard de la politique du Gouvernement.
Commandant la section de Louhans, en 1943, le général Giguet, quarante ans plus tard, donne son sentiment sur le serment :
« J’ai, comme tout le monde, moi aussi, signé effectivement par obligation un imprimé, classé dans mon dossier à la légion. Mais j’ai toujours considéré que ce geste faisait partie de la comédie indispensable pour tromper l’occupant et reste persuadé d’être en accord avec la pensée intime du maréchal. »
Le jugement du général Omnès diffère totalement de celui de son aîné. N’écrit-il pas en 1991 :
« Le 12 août, le serment de fidélité est imposé aux fonctionnaires et aux militaires. N’étant pas suffisamment courageux pour refuser en bloc ou faire grève, ils signeront. »
On ne saurait dénier aux officiers et sous-officiers qui se sont opposés aux exigences de l’occupant ou qui se sont engagés dans l’action clandestine, au prix souvent de leur vie, d’avoir manqué de courage. Pourtant, tous avaient signé le serment de fidélité au chef de l’État.
En exprimant ouvertement leur opposition au serment, des officiers qui se sont pourtant résolus à signer ont été pénalisés. Dans ses mémoires, Armand Annet, gouverneur général de Madagascar en 1942, évoque les réticences du chef d’escadron Pourchier à cet égard. Le commandant des troupes de Madagascar dont il dépendait, au courant de son état d’esprit, lui en tiendra rigueur. Est-il besoin de dire que tout au long de l’Occupation, le souvenir du serment de fidélité ne tourmente qu’un minimum de consciences.
De bonne foi, quelques militaires de la Gendarmerie contraints par les événements de faire un choix, à un moment où pourtant la fin de l’État français apparaît comme inéluctable, restent obstinément fidèles à leur engagement. Invoquant le serment prêté, ils refusent de se laisser détourner de leur mission.
Le capitaine B…, à la tête d’un détachement de 60 gendarmes, assure la défense extérieure du camp d’internement de Mauzac (Dordogne). Le 7 juin 1944, avec la complicité de surveillants acquis à la Résistance et grâce à la passivité de plusieurs gendarmes de garde, les maquisards investissent les lieux. Quinze gendarmes se rallient immédiatement, 7 autres le lendemain.
Le 9 juin, tous se joignent aux insurgés. Pour sa part, le capitaine B…, reste sourd aux sollicitations des chefs du maquis qui l’invitent à adopter la même attitude que ses subordonnés. À un officier des F.F.I. qui tente de le raisonner en lui disant que s’il persiste dans son refus il risque de perdre le bénéfice de sa retraite, il rétorque :
« Si je n’ai pas de retraite, je reprendrai la charrue. Mon honneur souffre assez de n’avoir pu défendre le camp et, cette fois, j’entends quoi qu’il m’arrive, conserver l’honneur d’être resté fidèle. Les serments prêtés ne sont pas pour moi un chiffon de papier. »
À ce vieux serviteur blessé à trois reprises au cours de la guerre 1914-1918, titulaire de quatre citations, de la médaille militaire et de la Légion d’honneur, on ne tiendra pas rigueur :
« Par ordre du commandant militaire du secteur de Lalinde, le prévenu capitaine B… est rendu à la liberté ce jour, 21 juin 1944. Signé Drion. »
Le comportement du capitaine B… n’est pas spécifique aux militaires de la Gendarmerie. À la même époque, le 6 juin 1944, le colonel Favier, commandant l’école de la Garde, à Guéret, refuse de rejoindre l’A.S. en se retranchant, lui aussi, derrière le serment qui le lie au maréchal Pétain. Néanmoins, il laisse toute latitude à ses subordonnés pour prendre une décision. Le commandant Corberand passe à la Résistance avec une partie de l’école, l’autre partie, indécise, suit son chef et feint d’ignorer les événements.
Comme tous les services de l’État, la Gendarmerie exhorte ses personnels au loyalisme et à une obéissance absolue envers le chef de l’État et du Gouvernement. Ces concepts, inséparables du serment de fidélité, reviennent tel un leitmotiv dans toutes les circulaires, instructions, directives émises par le commandement supérieur.
En 1942, les généraux de Gendarmerie placés à la tête des régions d’inspection, nouvellement créées, ont pour mission de « veiller à ce que le loyalisme le plus absolu soit toujours à la base des actes accomplis par les personnels de tout grade aussi bien dans la vie privée que dans l’accomplissement des devoirs professionnels ».
Au moment où apparaissent, à partir de 1943, les signes du déclin de la Révolution nationale, le commandement multiplie les appels au loyalisme. Le directeur général, M. Chasserat, dans une instruction du 9 juin 1943, appelle l’attention de tous les personnels « sur le devoir qui, plus que jamais, s’impose à eux d’une soumission absolue aux ordres du chef du Gouvernement, d’une exécution totale et sans arrière-pensée de ses décisions ».
Pour les convaincre il stimule et menace :
« Je saurai, écrit-il, reconnaître et récompenser les services rendus. Par contre, à ceux qui ne comprendraient pas ou oublieraient leur devoir, je dis qu’ils n’attendent de ma part aucune faiblesse dans l’application des sanctions qui viendraient les frapper. »
Visitant le 29 octobre 1943 l’école d’application de la Gendarmerie nouvellement installée à Courbevoie, le général Martin, son successeur, précise aux élèves-officiers récemment admis que « sous tous les régimes, et à toutes les époques de trouble, le Gouvernement a su qu’il pouvait compter sur la fidélité absolue de la Gendarmerie ».
Deux mois plus tard, dans le premier numéro du Bulletin d’études et d’informations de la Gendarmerie, il signe un éditorial intitulé « Je jure d’obéir à mes chefs » dans lequel il met l’accent sur l’engagement qu’ont pris les personnels en servant dans la Gendarmerie et l’obligation qu’ils ont de s’y conformer :
« Nous vivons des temps difficiles. En présence d’un passé douloureux et d’un présent tragique, certains d’entre vous peuvent être tentés de s’interroger. Qu’ils se rassurent et gardent foi dans l’avenir, quelles que soient les circonstances, ils resteront de bons gendarmes et de bons français en respectant leur serment « Je jure d’obéir à mes chefs. »
Au moment du débarquement, le 6 juin 1944, il tente, sans grand succès, d’endiguer la vague de défections qui affecte les rangs de la Gendarmerie en lançant un vibrant appel pour que chacun reste fidèle à ses engagements :
« Isolés par petites fractions dans la tempête de désordre et de violence qui vient de submerger une partie de notre France, vous avez, dans votre immense majorité, accompli, malgré les plus graves difficultés, ce traditionnel devoir d’obéissance. Je vous en remercie. Bon nombre d’entre vous, contraints par la violence de suivre les éléments de désordre ont réussi à s’échapper et à rejoindre leurs formations. Leur geste efface largement l’erreur coupable de quelques égarés, heureusement peu nombreux, pour entacher une arme qui conserve intact le culte de l’honneur et de la loyauté. »
Une dernière fois, sans illusion, le 20 juin 1944, il en appelle à l’obéissance. Il vient juste de créer la Fondation « La Maison de la Gendarmerie », œuvre sociale ayant pour vocation de venir en aide aux veuves, aux orphelins, aux malades en convalescence et aux invalides. Pour voir le jour, son projet a nécessité une première mise financière très importante. Le président Laval, qui a eu connaissance de son initiative, lui a remis, prélevé sur ses fonds secrets, la somme de trois millions cinq cent mille francs. Geste de générosité ? Calcul ? Nul ne le sait. Quoi qu’il en soit, lorsque le général Martin annonce la création de la Fondation, il invite le personnel à témoigner, en retour, au Président, une obéissance sans faille :
« En le remerciant en votre nom à tous, j’ai affirmé au Président que tout le personnel de notre Arme tiendrait à lui manifester sa gratitude par sa discipline et son obéissance. Je suis sûr que vous ne m’infligerez pas de démenti et que vous témoignerez votre reconnaissance en continuant à servir honnêtement, courageusement, en soldats de tout votre cœur. »
Non seulement le commandement à l’obligation d’exhorter les personnels au loyalisme, mais il lui appartient aussi de l’évaluer périodiquement. Tous les trimestres, les commandants de légion établissent un rapport sur l’état d’esprit et le moral dans lequel, entre autres points, ils apprécient le loyalisme des officiers et sous-officiers. L’analyse des jugements portés en la circonstance requiert prudence car le discours tenu ne correspond pas toujours à la réalité, encore que certains chefs affichent une réelle indépendance d’esprit.
En avril 1942, le commandant de la 11e légion (Nantes) affirme que « tous les officiers sont animés d’un ardent patriotisme et font confiance au maréchal pour sauver le pays et le doter d’institutions qui assurent son avenir ».
Dans les premières années de l’Occupation, l’image de Pétain, a priori, n’est pas mauvaise. En dépit des questions que se posent certains officiers et gendarmes, tous, dans l’ensemble, lui font confiance sans pour autant être germanophiles. On considère le vainqueur de Verdun comme le meilleur rempart contre l’occupant.
Au début de l’année 1943, la plupart des commandants de légion s’accordent pour affirmer que le loyalisme de leurs subordonnés ne laisse apparaître aucune faille. Dans un rapport du premier trimestre 1943, l’un d’entre eux note que « le loyalisme des officiers à l’égard du maréchal chef de l’État et du Gouvernement n’est pas à mettre en doute » et il assure « qu’ils serviront avec fidélité quoi qu’il advienne. » Son sentiment concernant les sous-officiers, est identique :
« Il demeure certain que le plus grand nombre de gradés et de gendarmes n’oublient pas le serment qu’ils ont prêté à leur admission dans l’Arme, pas plus d’ailleurs que le serment de fidélité au maréchal chef de l’État. Il est à présumer qu’en cas d’événements graves, ils ne se départissent pas d’une attitude loyale, tout au moins aussi longtemps que leurs officiers leur donneront l’exemple du respect de la parole donnée. »
Un autre officier aboutit à des conclusions similaires dans son rapport du mois de juin 1943 :
« On peut faire confiance aux officiers de la légion. Aucun ne manifeste devant les obligations actuelles de la tiédeur ou de l’hésitation. Le commandant de légion n’a qu’à se louer de la façon dont il est compris et suivi. Il se croit en mesure de se porter garant du zèle et du loyalisme de tous. »
Les rapports du troisième trimestre apportent les mêmes échos. Un chef de corps écrit :
« Fidèles à leur serment les officiers demeurent attachés à la personne du maréchal et au chef du Gouvernement… »
Le ton est comparable dans les évaluations concernant le dernier trimestre :
« L’obéissance totale à ses chefs, le loyalisme envers le Gouvernement, la vénération pour le maréchal font que la Gendarmerie sortira intacte de la passe difficile que traverse le pays… »
En 1944, le doute commence à s’installer au point que certains chefs nuancent leurs appréciations. Un commandant de légion souligne que « malgré les dangers de toutes sortes auxquels sont exposés les officiers et qui seraient de nature à altérer leur moral celui-ci reste bon et leur loyalisme est certain, du moins les apparences sont telles. »
Toujours à cette époque, un autre indique :
« Quelles que soient les difficultés de l’heure présente, je crois pouvoir compter entièrement sur leur loyalisme et leur dévouement… »
Après le débarquement du 6 juin, il n’est plus question de loyalisme. Un commandant de légion constate amèrement la réalité de la situation : « Les événements du mois de juin ont permis de se rendre compte d’une façon exacte de la valeur de l’état d’esprit et du peu de solidité du moral de nos gradés et gendarmes. L’expérience est concluante, on sait maintenant ce qu’on peut attendre d’eux, c’est-à-dire bien peu de chose… »
Enfin, on encourage le personnel dans la voie du loyalisme par des récompenses. Le 24 décembre 1941, quand l’amiral Muselier investit avec quelques bâtiments des forces navales Françaises Libres l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon défendu par une poignée de gendarme (8 sous-officiers) et que la population se prononce, dès le 25, pour le ralliement à la France Libre à 99 %, deux gendarmes du détachement se déclarent ouvertement hostiles aux gaullistes. Vichy, à titre exceptionnel, les décore de la médaille militaire au motif « qu’ils ont préféré se laisser interner par les forces militaires gaullistes plutôt que de collaborer avec elles, donnant ainsi des preuves éclatantes de leur loyalisme. »
Courant juillet 1943, le Gouvernement accorde à la Gendarmerie un contingent important de médailles militaires, ceci « pour tenir compte des efforts exceptionnels fournis dans les circonstances présentes par les personnels et pour récompenser les mérites les plus éclatants ». Une des conditions requises pour être proposable est « de se montrer à la hauteur de la tâche dans les circonstances actuelles. » Dans le tableau spécial, publié le 30 décembre 1943, figurent 163 gradés et gendarmes. Quinze jours plus tard, à titre exceptionnel, un nouveau tableau confère la Médaille militaire à 443 sous-officiers. Pour tous, un libellé commun :
« A fait preuve d’un sentiment élevé du devoir et d’une haute conscience professionnelle dans l’exercice des missions délicates incombant actuellement à la Gendarmerie. »
Entre décembre 1943 et mai 1944, on dénombre 58 nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur, dont 28 concernant des sous-officiers, ce qui est tout à fait exceptionnel, encore doit-on savoir que plus du tiers d’entre elles l’ont été à titre posthume.
Alors que la défiance ne cesse de grandir à l’égard du régime et que la situation se dégrade à travers tout le pays, la tâche des gendarmes devient de plus en plus ingrate. Le chef du Gouvernement décide de multiplier les encouragements pour mieux les conforter dans l’accomplissement de leur mission. Le 5 avril 1944, le général Martin, s’adressant aux commandants de légion, écrit :
« Pour récompenser les efforts particulièrement méritoires fournis dans les circonstances actuelles par le personnel de la Gendarmerie, aux divers échelons, j’envisage, en dehors de l’attribution de décorations, citations et gratifications, la possibilité d’inscrire à titre exceptionnel, sur une liste d’aptitude ou un tableau d’avancement supplémentaire, certains chefs d’escadrons, officiers subalternes, gradés et gendarmes qui se sont tout spécialement distingués dans la répression du désordre et se sont acquis ainsi des titres particuliers. »
À la Libération, la suspicion prévaut à l’égard des récompenses et promotions obtenues pendant l’Occupation. Par décret du 22 septembre 1944, le Gouvernement décide de rétrograder systématiquement tous ceux qui ont été promus au choix ou à l’ancienneté après le 8 novembre 1942. Le 12 mars 1945, une circulaire ministérielle prévoit la révision des récompenses. Les généraux commandant les régions militaires, investis du pouvoir de révision, frappent d’annulation toutes celles qui ont sanctionné des actions contre des résistants ou des opposants au régime, par contre ils valident toutes les autres.
Confirmant des directives antérieures, en août 1942, Pierre Laval rappelle que la Gendarmerie « doit apporter son concours à l’œuvre de redressement du pays. » Dans les écoles de formation, pour une part qui reste modeste, les programmes sont adaptés en conséquence.
La circulaire relative à la réouverture de l’école d’application de la Gendarmerie, diffusée le 17 décembre 1940, détermine la façon dont il convient de concevoir l’enseignement. Elle met l’accent sur l’instruction morale et la formation des officiers comme chefs et instructeurs :
« Il importe que les officiers soient bien pénétrés du rôle que la Gendarmerie doit jouer dans la rénovation du pays et, à cet effet, des qualités qu’ils doivent inculquer à leur personnel tant du point de vue moral que professionnel, et de celles qu’ils doivent posséder eux-mêmes. » Parmi les qualités énumérées, retenons « un dévouement absolu au Gouvernement du maréchal de France, chef de l’État français. »
Dans les écoles préparatoires de Gendarmerie, l’éducation morale revêt une grande importance. Un des objectifs est « d’exalter, chez les élèves gendarmes, le dévouement sans limite à la cause du redressement national. » Les programmes intègrent l’étude de toutes les vertus à cultiver ayant trait à la famille, au travail et à la patrie. Parmi les devoirs du Français figurent « le loyalisme envers le chef de l’État, l’État hiérarchique et le respect de l’autorité, l’obéissance aux lois ». Les commandants d’écoles ont toute latitude pour organiser des conférences d’information générale. À titre indicatif, l’instruction ministérielle relative à la formation des élèves gendarmes donne des exemples de thèmes à développer : « L’œuvre de la Révolution nationale, le régionalisme, etc. »
Les futurs gradés, astreints à l’exécution de travaux écrits, réfléchissent à des sujets d’ordre général ou à caractère historique, parfois en rapport avec l’esprit de la Révolution nationale comme l’attestent quelques échantillons. Ainsi en est-il du libellé de ce travail :
« Le maréchal résume son programme de rénovation nationale en trois mots : travail, famille, patrie. Montrez que ces trois idées fondamentales avaient été perdues de vue par la majorité des Français et justifiez la nécessité d’y revenir pour le relèvement et la grandeur de notre pays. »
Autre devoir d’inspiration semblable :
« L’histoire est faite d’alternances entre des périodes d’autorité dégénérant en tyrannie et des périodes de liberté engendrant la licence. Justifiez cette affirmation du maréchal. »
Tous ces efforts de sensibilisation n’ont finalement qu’un impact très limité sur les hommes.
* *
*
Autre conséquence de la Révolution nationale, au prix de déchirements compréhensibles, la Gendarmerie est contrainte de se plier à l’entreprise d’assainissement interne qui a pour objectif l’élimination des rouages de l’État des éléments douteux ou indésirables considérés comme les boucs émissaires de la décadence du pays. Entre juillet 1940 et avril 1941, le Gouvernement édicte une série de lois discriminatoires grâce auxquelles il pourra justifier l’épuration des administrations.
La loi du 17 juillet 1940, autorise les ministres, par simple décret, à relever de leurs fonctions, sans autre formalité qu’un rapport des chefs hiérarchiques, « les magistrats, fonctionnaires, agents civils et militaires de l’État qui ne présentent pas les garanties requises pour accomplir leur mission. » En fait révoquées, les victimes de la loi ne bénéficient d’aucun traitement, indemnité ou retraite.
Dans la Gendarmerie, on a recours à ce texte pour se séparer des personnels qui se signalent de façon coutumière par des carences professionnelles graves. Cependant, certains sont « juilletisés » en raison de leur hostilité aux idées nouvelles.
Le capitaine Guillon, commandant la section de Villefranche-de-Rouergue, est parmi d’autres, un des exclus. Nommé en décembre 1940, en Aveyron, il ne tarde pas à opter pour la Résistance. Aux victimes de la politique du Gouvernement de Vichy (communistes, juifs, gaullistes, etc.), son aide est assurée. Il dirige, par une filière, sur Montauban et les Pyrénées, ceux qui veulent rejoindre les Forces françaises Libres. Son action ne reste pas longtemps ignorée. Ses chefs saisissent l’administration centrale. Peu de temps après, il apprend la mort dans l’âme sa révocation. De retour à la vie civile, il ne renie pas ses convictions et poursuit son action. La Gestapo l’arrête le 2 mai 1944. C’est ensuite la déportation au camp de Nuengamme. De retour en France, le 26 juin 1945, très affaibli, il ne peut reprendre le service. Placé en congé de longue durée, il s’éteint quelques mois plus tard.
Seconde loi discriminatoire, celle du 13 août. Elle dissout et interdit, sans le nommer, les associations à caractère occulte. Les décrets d’application pris d’août 1940 à mars 1941 désignent la franc-maçonnerie (Grand-Orient de France, Grande loge de France, la Société théosophique, le Droit humain, etc.).
La législation vise autant les individus que les organismes. Dans le rapport introductif à la loi, Adrien Marquet, secrétaire d’État à l’Intérieur et Raphaël Alibert, garde des Sceaux, soulignent la nécessité « d’exiger de tous ceux qui sont investis d’une fonction publique un engagement sur l’honneur attestant qu’ils n’appartiennent pas et n’appartiendront jamais à des organisations à caractère occulte. » Effectivement, la loi prévoit l’établissement, par chaque agent de l’État, d’une déclaration et d’un engagement écrits. Toute fausse déclaration entraîne la démission d’office de son auteur. Dès la mi-août, les ministères, par circulaire, donnent des instructions pour que les personnels relevant de leur autorité fournissent ces documents.
Dans la Gendarmerie, très peu nombreux sont ceux qui souscrivent à cette obligation. Aucun moyen de contrôle n’existe pour vérifier l’exactitude des déclarations. Le régime organise un Service des sociétés secrètes rattaché au cabinet civil du maréchal Pétain, dirigé par un officier de marine, le capitaine de frégate Labat, sous la haute direction d’un universitaire, le professeur Fay. Une des 5 sections de cet organisme est spécialement chargée du contrôle des déclarations. Pendant une année, le Service des sociétés secrètes, à partir des documents saisis dans les loges (tableaux des membres de 1920 à 1940), dresse la liste, par obédience, des francs-maçons.
La loi du 11 août 1941 annonce la publication au Journal officiel des noms des dignitaires (tout franc-maçon dont le grade est supérieur au 3e degré) des loges, notion étendue aux premiers grades par les services de Labat. Elle déclare démissionnaires d’office les fonctionnaires, les agents civils ou militaires ainsi répertoriés. Entre le 12 août et le 22 octobre 1941, le Journal officiel dévoile plus de 15 000 noms. Au fur et à mesure des publications, la direction est tenue de porter à la connaissance du secrétaire d’État à la Guerre les fonctions « actuelles » occupées par les personnels dont les noms figurent sur les listes. Le couperet est prêt à tomber.
Aux armées en général, dans la Gendarmerie en particulier, la loi ne semble pas avoir été appliquée de façon systématique. Darnand d’abord, Laval ensuite, ne font pas du combat antimaçonnique leur cheval de bataille préféré. Ceci explique en partie que les mesures de radiation prises à l’encontre des personnels, membres de la franc-maçonnerie, s’échelonnent de septembre 1941 à juin 1944. Curieusement, des dossiers restent en attente pendant des mois alors que d’autres sont traités dès la publication des noms au Journal officiel.
Le colonel Tubert est un des premiers à être démissionné d’office par arrêté en date du 3 septembre 1941. Par la suite, il constitue en Algérie une association des victimes des lois d’exception du régime de Vichy.
Le chef T…, de la brigade de J…, appartenant à la loge « Les enfants de Mars », le capitaine B…, membre de la loge « La parfaite union de Rodez », le capitaine C…, de la loge « L’étoile de Mascara », le gendarme D…, de la loge « L’école de la Sagesse » et plusieurs dizaines d’autres militaires voient leurs noms divulgués.
Le chef d’escadron Meunier, qui sera nommé en novembre 1944 directeur de la Gendarmerie, est rayé des cadres par arrêté du 30 septembre 1941. Le gendarme B… est un des derniers à être « démissionné d’office ». La décision qui le concerne est datée du 13 juin 1944.
Dans quelques cas très rares, des personnels radiés des contrôles, en raison de leur appartenance à une société secrète, sont réintégrés. Le chef d’escadron Favre, commandant la compagnie de la Charente-Maritime, à la Rochelle, reprend le service à la suite de circonstances probablement uniques. Lorsque son nom est publié au Journal officiel, il ne se manifeste pas. Pourtant, le processus de son éviction se déclenche. Le 8 décembre 1941, de Brinon agissant conformément aux instructions du secrétaire d’État à la Guerre signe la décision qui l’élimine de la Gendarmerie. Le 18, le colonel Blanchard, commandant la 18e légion à Bordeaux, lui notifie l’arrêté. L’officier en accuse réception le même jour. Rayé des contrôles le 20, il cesse immédiatement ses fonctions.
À la demande de ses amis résistants, l’officier, membre du réseau « Alliance », établit une demande de réintégration qu’ils se chargent d’appuyer par personnes interposées influentes à Vichy : le colonel Pascot, appelé à succéder à Borotra au commissariat général à l’Éducation et aux Sports et le lieutenant-colonel d’aviation Bordage. Les intervenants obtiennent satisfaction. Le dossier du chef d’escadron Favre est transmis à la commission spéciale de dérogation instituée par le Gouvernement. Celle-ci se réunit le 20 février 1942 pour statuer. Elle émet un avis favorable à sa réintégration. Par décret du 13 mars, le chef de l’État lève la mesure d’exclusion. Les attendus précisent « que M. Jean Favre, ex-commandant de Gendarmerie du département de la Charente-Maritime a dès longtemps témoigné de son renoncement complet à l’activité maçonnique, qu’il a d’autre part, depuis juin 1940, accompli ses fonctions de commandant de Gendarmerie du département de la Charente-Maritime avec courage et dévouement, qu’il a manifesté son attachement total à l’ordre nouveau… »
Le 23 mars 1942, l’officier reçoit notification de la décision signée par le général Revers, chef d’état-major de l’armée d’armistice, un des futurs chefs de l’O.R.A. Il reprend son activité professionnelle qu’il mène de pair avec son engagement dans la Résistance. Avec vingt-cinq de ses gendarmes, il agit inlassablement au sein du groupe « Honneur et Patrie » de l’O.C.M. Muté à Draguignan, il jouera un rôle déterminant dans la libération de la ville.
Le dossier du gendarme L…, de la brigade de Beaumont (Dordogne), lui aussi « fils de la veuve », est gelé de longs mois avant qu’une décision ne soit prise. Par lettre du 3 mai 1943, le secrétaire général, puis le chef du Gouvernement signalent à la direction générale de la Gendarmerie que ce gendarme a souscrit une fausse déclaration en matière d’associations secrètes. L’affaire traîne en longueur. Plusieurs mois passent avant que le commandant de légion ne retourne son dossier à Vichy.
Dans la nuit du 20 décembre 1943, les Allemands investissent la caserne de Beaumont. Malgré un tir nourri d’armes automatiques et de jets de grenades dans les logements occupés par les familles, les gendarmes refusent d’ouvrir les portes. Après un siège de plusieurs heures, les agresseurs, à l’aide d’explosifs, forcent l’entrée du bâtiment. Ils arrêtent le chef L… et le gendarme L… L’un et l’autre sont déportés. Lorsque Darnand, par arrêté du 26 février 1944, déclare démissionnaire d’office le gendarme L…, sa décision reste sans effet faute de pouvoir la notifier à l’intéressé détenu en Allemagne dans un camp de concentration.
Après les francs-maçons, le pouvoir vichyssois s’attaque aux israélites. Une loi du 3 octobre 1940 porte statut des juifs. Après avoir défini ouvertement la notion de race juive, elle les exclut de la fonction publique et des professions libérales.
La circulaire n° 697/3 cab. du 12 janvier 1941, précise les modalités d’application de la loi du 3 octobre aux personnels civils et militaires du département de la Guerre. Pour faciliter la détermination de ceux auxquels devra s’appliquer la loi, elle prévoit que chacun souscrira une déclaration.
La Gendarmerie, contrairement aux armées, n’exige pas systématiquement ce document des personnels en activité de service. Par contre, les candidats à la Gendarmerie n’en sont pas exemptés.
L’élimination des officiers et sous-officiers qui entrent dans le champ de la loi commence en février 1941 et se poursuit jusqu’en mai 1944. Le lieutenant G… est un des premiers à être radié des cadres par arrêté du 13 mai 1941. Réintégré à la Libération il recouvre, comme toutes les victimes des lois d’exception, l’intégralité de ses droits. Il terminera sa carrière général de brigade à la tête du commandement des écoles de la Gendarmerie. Le gendarme T… est rayé des contrôles par arrêté du 27 septembre 1941. Le gendarme A… subit un sort identique le 28 mai 1942. Le chef d’escadron Z… n’est exclut que le 3 mai 1944.
Dans la chaîne du commandement des officiers escamotent des dossiers ou s’arrangent de telle sorte que leur exploitation traîne en longueur. La prolifération, à cette époque, des documents administratifs les aide dans leur entreprise.
La loi du 3 avril 1941 interdisant aux fonctionnaires et militaires, qui ne sont pas nés d’un père français, l’accès aux emplois publics, procède encore de la volonté du pouvoir de « purifier » le corps social. Elle pénalise des militaires de la Gendarmerie obligés d’interrompre leur carrière.
Les officiers et sous-officiers qui tombent sous le coup des lois discriminatoires réagissent de deux manières. Les uns, pour en devancer l’application, présentent immédiatement leur démission. Les autres, sans doute par excès de confiance, attendent. Ils espèrent échapper aux mesures prises. Malheureusement, ils devront en subir les effets.
Une instruction du 20 juin 1941 aménage les modalités de recrutement dans la Gendarmerie pour les mettre en harmonie avec la nouvelle législation. Ce document précise dans son article 1er les conditions d’admission :
« 1° Avoir 27 ans au moins et avoir accompli le temps de service militaire fixé par des instructions particulières.
2° Ne pas être Juif selon la définition de la loi du 2 juin 1941.
3° Posséder la nationalité française à titre originaire ou appartenir à l’une des catégories suivantes… »
Tout candidat joint obligatoirement à son dossier une déclaration sur sa nationalité, sa non-appartenance à la race juive et sa situation au regard des associations secrètes.
Les mesures d’exception prises par l’État français ont une incidence sur la vie privée des personnels. Comme par le passé, le mariage est soumis à autorisation préalable – il le sera encore de nombreuses années après la Libération – mais une disposition spéciale est introduite dans l’instruction du 6 octobre 1942 qui le réglemente. L’article 3 stipule qu’en principe, « toute autorisation de contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère ou de race juive sera refusée au personnel de la Gendarmerie. » Cependant, dans des cas tout à fait exceptionnels, la direction peut déroger à cette règle.
Pour apprécier les conséquences, dans la Gendarmerie, d’une véritable épuration qui n’ose dire son nom, réalisée sous le couvert de lois perverses, il suffit de se reporter aux journaux officiels des années 1945 à 1947 dans lesquels figurent les décrets portant réparation du préjudice de carrière subi par ceux qui en ont été les victimes. Les noms des 4 000 officiers et sous-officiers éliminés par le régime y apparaissent avec les dates et motifs de leur renvoi. Ce chiffre inclut les personnels révoqués à la suite de sanctions disciplinaires. Quelques exemples donnent une idée sur la nature des griefs imputés aux gendarmes.
Le capitaine Dupuy est « mis en réforme pour faute grave dans le service » par décision du 3 septembre 1943. Motif de son éviction : fin 1942, une lettre anonyme adressée au chef du Gouvernement dénonce son activité dans la Résistance. Le commandement ouvre une enquête. Le général sous-directeur l’entend sur les faits qui lui sont reprochés. L’officier ne dissimule pas son opposition au régime. Il ne fournit aucun renseignement et refuse la mutation qu’on lui propose pour le soustraire aux Allemands car elle l’empêcherait de remplir « sa mission » dans la clandestinité. À la révocation s’ajoute la détention au camp d’internement d’Evaux-les-Bains. Un de ses pairs va le tirer de ce mauvais pas. Le capitaine Fournier, avec quelques amis, organise son évasion.
Le 29 mars 1944, le chef L…, de la brigade de Lapleau, est révoqué « par mesure de discipline pour faute grave dans le service et faute contre l’honneur. » Quel fait recouvre cette sanction ? Le 10 février 1944, ce gradé ne s’est pas opposé au désarmement du personnel de sa brigade par des éléments du maquis.
En mai 1944, la direction générale radie des contrôles le gendarme M…, de la brigade de Châteauroux, « pour faute grave contre la discipline. » Son fils étant rentré en contact avec une organisation clandestine, dans le but de partir à l’étranger, il « s’est abstenu d’en rendre compte à ses chefs et l’a accompagné à un rendez-vous pour un départ qui n’a d’ailleurs pu avoir lieu en raison des circonstances. »
De même, fin juin 1944, la direction raye des cadres, « par mesure de discipline, pour faute contre l’honneur », le gendarme Georges Guillaudot de la légion du Berry. À l’issue de son stage à l’E.P.G. de Pamiers, il rejoint son affectation à la brigade motorisée d’Annecy et met à profit l’amitié qui lie son père, commandant la compagnie du Morbihan, avec le colonel Lelong, nommé par Darnand, en janvier 1944, directeur des opérations et du Maintien de l’ordre en Haute-Savoie, pour se faire détacher à son état-major. Grâce aux facilités que lui procure ce poste, il renseigne les défenseurs des Glières sur les opérations projetées, transporte des armes et des résistants dans des véhicules de la Gendarmerie, établit des laissez-passer. À la suite d’une dénonciation la police l’arrête le 20 mars 1944, au terme d’une permission, alors qu’il se présente à la brigade de l’Isle-Jourdain où il vient d’être muté. Les inspecteurs le conduisent au siège de la légion du Dauphiné à Grenoble car son ancien commandant de légion, le colonel B…, désire le questionner. Puis, la police de Darnand l’incarcère à Lyon, à la prison Saint-Paul, avant qu’il ne soit déporté à Dachau puis à Kempten. Rapatrié en 1945, il reprend du service dans l’armée et termine sa carrière avec le grade de capitaine.
Mesure d’exclusion encore celle prise à l’encontre du gendarme T… pour avoir, en visite de commune, « prévenu un étranger qu’il savait affilié à un groupe de résistance de recherches dont il était l’objet et ne l’a pas arrêté. » Pareillement, la révocation sanctionne l’attitude du gendarme L… qui « au cours d’une attaque de la caserne par une bande armée a failli à son devoir en ne ripostant pas de son logement au feu des assaillants qui ont envahi et désarmé la brigade. »
En fait, le pouvoir exerce une pression constante sur le commandement pour qu’il sévisse avec fermeté contre les personnels passifs ou complaisants à l’égard des opposants au régime.
Au plan statutaire, un décret du 18 février 1943 interrompt le fonctionnement des conseils de discipline qui se réunissaient pour émettre un avis avant toute décision de suspension d’emploi, de révocation ou de mise à la retraite d’office. Après la suppression de cette garantie, sur simple proposition des commandants de légion, le chef du Gouvernement prend directement les sanctions qu’il juge utiles.
Au début de l’année 1944, à la demande de Darnand, la direction générale de la Gendarmerie ordonne d’accélérer l’établissement des procédures et des dossiers disciplinaires contre « les personnels convaincus de défaillance dans la lutte antiterroriste » pour pouvoir les sanctionner plus rapidement. À cet effet, le délai d’envoi de ces documents à Vichy ne doit pas excéder un maximum de douze jours. Par ailleurs, il n’est plus question pour les militaires en instance de punition d’émarger les pièces constitutives de leur dossier.
À la même époque, Darnand rappelle aux directeurs généraux de la Gendarmerie, de la Garde et de la Police nationale la nécessité de réprimer impitoyablement tous les manquements des membres des forces de l’ordre :
« Il arrive très fréquemment que des membres des forces de l’ordre, isolés ou en détachement, soient désarmés par des terroristes sans qu’un seul coup de feu ait été échangé. Ces incidents ne peuvent s’expliquer que par le manque de vigilance des gardes, gendarmes et gardiens qui se laissent surprendre ou par leur désir de composer avec leurs adversaires. Une telle situation, dont les conséquences éventuelles ne peuvent échapper à votre attention, ne saurait se prolonger. »
Le général Martin, à son tour, réagit énergiquement. S’adressant aux commandements de légion, il écrit en janvier 1944 :
« L’honneur militaire interdit au soldat de rendre ses armes avant d’avoir épuisé tous les moyens de combat ou d’abandonner le poste dont la garde lui a été confiée tant qu’il lui est possible de le défendre.
Il m’est particulièrement pénible de rappeler ces règles élémentaires d’honneur et de devoir militaire au personnel d’une Arme dont les membres, par une longue tradition d’héroïsme et de courage, avaient toujours, jusqu’à ces derniers temps, donné l’exemple du dévouement et du sacrifice au service de l’ordre public… Je suis décidé à ne pas tolérer que des défaillances individuelles, d’un caractère aussi infamant, puissent porter atteinte au bon renom de la Gendarmerie que nous avons tous l’obligation de maintenir. »
En conclusion, le directeur général demande de proposer les sanctions les plus graves à l’égard de ceux qui n’auraient pas accompli totalement leur devoir. Il n’exclut pas leur traduction devant un tribunal militaire.
Tous ces avertissements ne restent pas lettre morte. Courant 1944, le général B…, commissaire régional à Lyon, donne l’ordre d’incarcérer à la prison militaire de Vancia le chef M…, les gendarmes G…, M…, B… et C…, détachés aux forces de Gendarmerie rassemblées en Haute-Savoie, prévenus d’avoir par négligence laissé s’évader des résistants de la prison d’Annecy, en vue de les mettre à la disposition du juge d’instruction près du tribunal militaire de Lyon.
Pour le commandement, en règle générale, il n’y a pas d’autre issue que celle de punir lorsque les gendarmes commettent une faute professionnelle. Escamoter un dossier ou fermer les yeux sur un manquement comporte des risques. La disparition d’une arme, ou l’évasion d’un prisonnier ne se justifient pas facilement. Et puis, comment ne pas obtempérer aux injonctions de l’occupant qui parfois, sous la menace, exige des sanctions ?
Courageusement, à tous les échelons, des officiers s’efforcent, chaque fois qu’ils le peuvent, de minimiser les « fautes » de leurs subordonnés. Ils prennent aussi leur défense lorsque des dénonciations dévoilent aux autorités de Vichy leurs sentiments patriotiques. À propos d’un de ses commandants de brigade, le chef Cazals, le capitaine Caubarrus écrit :
« En conflit constant avec ceux qui collaboraient ou s’accommodaient de l’ordre nouveau, le maréchal des logis-chef Cazals fit l’objet de plaintes de la part de certains membres de la Légion des combattants aux yeux desquels il était suspect de gaullisme. Son maintien au Malzieu m’était signalé inopportun. Il put néanmoins s’y maintenir jusqu’à la Libération. »
Pour prévenir les risques auxquels s’exposent des personnels du fait de leur action patriotique et éviter ainsi que la Gendarmerie ne subisse des mesures de rétorsion de la part de l’occupant, le commandement supérieur, aussi paradoxal que cela puisse paraître, se montre attentif à leur situation.
Lorsqu’en fin d’année 1943, le colonel Boutillon, commandant la légion de Nancy, apprend que le gendarme Joyeux, de la brigade d’Épinal, milite activement dans la Résistance, sans toutefois connaître le rôle qu’il y joue, il le convoque. Son intention est d’éloigner l’intéressé d’Épinal en le faisant affecter dans une brigade perdue au fond du terroir. Paul Joyeux refuse. Le chef de corps l’envoie alors à Vichy, à la direction générale, nanti d’un mot de recommandation, pour y régler son propre cas auprès du chef du bureau du personnel, le chef d’escadron Piqueton.
Ce dernier reçoit Paul Joyeux qui met immédiatement cartes sur table. Il déclare exercer des responsabilités au sein d’un service de renseignements et vouloir continuer son action tout en restant à Épinal ou dans les environs immédiats. Le chef d’escadron Piqueton lui conseille de se faire porter malade :
«… Je vous laisse à Épinal mais attention, il vous faudra des certificats médicaux émanant d’un médecin militaire. En connaissez-vous un ? »
Sur la réponse affirmative de son interlocuteur l’officier ajoute :
« Parfait, dès votre retour vous en informerez le commandant Rémy (commandant de compagnie). Soyez prudent ! »
Administrativement couvert, Paul Joyeux peut se consacrer entièrement à son réseau avant de passer dans la clandestinité quelques semaines plus tard.
À l’évidence, de plus en plus policier et répressif au fil des mois, l’État français a marqué la Gendarmerie d’une empreinte profonde génératrice de désarroi pour les uns, de zèle intempestif pour les autres et, pour le plus grand nombre, d’une légitime prudence.
L’ingérence de l’occupant et de son satellite, la Milice, dans le service de l’Arme, va encore aggraver considérablement une situation déjà intolérable.
Pendant l’Occupation, la Gendarmerie n’a pas pu s’abstenir d’avoir des contacts avec les Allemands, les uns dictés par les circonstances, les autres imposés par des prescriptions prises conjointement par le régime de Vichy et les autorités allemandes. Tous s’inscrivent dans un rapport de force favorable à l’occupant.
D’une part, dans les semaines qui suivent la fin des hostilités, pour pouvoir assurer dans les territoires occupés la continuité de la sécurité publique, les différents échelons, en l’absence d’instructions, se rapprochent du commandement militaire allemand territorial. D’autre part, la commission d’armistice de Wiesbaden crée, dès le mois de juillet 1940, une délégation pour la Gendarmerie, dans les conditions précédemment relatées, pour négocier les modalités de réinstallation et d’organisation de la Gendarmerie en zone occupée.
CHAPITRE 11 – L’OMNIPOTENCE DE L’OCCUPANT
Plusieurs accords conclus par le Gouvernement français avec les autorités allemandes induisent des obligations à l’égard de l’occupant auxquelles la Gendarmerie ne peut se soustraire. La convention franco-allemande d’armistice place les pouvoirs publics sous la dépendance de l’occupant. Cette subordination, comme le stipule l’article 3 de la convention, s’étend à l’administration et aux services publics :
« Le Gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux dispositions des autorités allemandes et à collaborer avec elles d’une manière correcte. »
Les dispositions de cet alinéa reconnaissent implicitement aux Allemands le droit absolu de donner des ordres aux fonctionnaires et agents de l’État. La Gendarmerie va devoir en supporter, pour sa part, les conséquences.
Le 28 mai 1942, le général Stulpnagel notifie au Gouvernement français l’entrée en fonction, à partir du 1er juin, du général Oberg, commandant supérieur des SS et de la police allemande en France. À cette occasion, dans le droit fil de l’article 3, il incite Vichy « à donner instruction à toutes les autorités françaises des territoires occupés pour que ces dernières donnent suite à toutes les décisions prises par le commandant supérieur des SS et les services placés sous ses ordres, installés au siège de chaque préfecture régionale. »
D’autres impératifs résultent des accords Oberg-Bousquet de coopération des polices signés au cours de l’été 1942, puis étendus à la zone sud en avril 1943. En échange d’une relative indépendance, la police française, y compris la Gendarmerie, est tenue d’apporter son appui à la police allemande « dans la lutte contre les communistes, les terroristes et les saboteurs. »
Du point de vue des principes, la situation est nette. Le Gouvernement français souscrit aux règles voulues par les Allemands. La police française, en apparence, jouit d’une certaine autonomie. Pourtant, concrètement, l’occupant exerce sur la Gendarmerie un pouvoir absolu, sans aucune limite que celle de ses intérêts.
* *
*
Dans le domaine missionnel, la Gendarmerie continue son activité traditionnelle de surveillance générale et de police. Elle veille au respect des lois françaises. Par surcroît, les autorités allemandes lui assignent, dès juillet 1940, de nouvelles attributions. Le spectre qu’elles couvrent est très large.
Certaines revêtent un caractère permanent. Les gendarmes sont tenus de vérifier que leurs concitoyens se conforment aux ordonnances édictées par le commandement militaire allemand. Pour eux, le service se complique car ils doivent adresser directement aux autorités d’occupation procès-verbaux et comptes rendus se rapportant à ces nouvelles activités.
En édictant ses propres lois (ordonnances), l’occupant ne respecte pas la souveraineté française. Il viole délibérément les dispositions de l’article 43 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 qui stipule « le respect, sauf empêchement absolu, des lois en vigueur dans le pays. »
Dans les semaines qui suivent l’armistice, la Gendarmerie reçoit l’ordre de renseigner directement les Feldkommandantur de tous les événements permettant de conclure à une activité ennemie (descente de parachutistes, actes de sabotages, préparation d’attentats, etc.) ou qui viennent troubler la tranquillité publique (incendie de forêts, naufrages, grèves, etc.).
L’exécution de services mixtes, avec la Feldgendarmerie, n’est guère prisée des gendarmes français. Le commandant de la brigade de Saint-Jean-Pied-de-Port précise dans un rapport du 29 novembre 1944 :
« Les services exécutés avec la Feldgendarmerie étaient freinés et sabotés dans la mesure du possible, notamment en matière de circulation et de défense passive, en prévenant la population du service projeté ou en conduisant les Allemands dans des endroits où il n’y avait aucune chance de relever des infractions. »
Les enquêtes effectuées en commun, pour identifier les auteurs de menaces ou d’attentats contre les troupes d’occupation, aboutissent rarement. À la suite de la découverte, devant le bureau du commandant d’armes allemand d’Auray, en 1941, d’une lettre « en caractères dessinés » menaçant de mort cet officier à la moindre mesure prise contre des otages, les investigations, diligentées de concert par la Gendarmerie et la Feldgendarmerie, ne donnent rien, selon un rapport allemand.
L’envoi aux brigades, très souvent par la Feldgendarmerie, d’avis de recherche ou d’arrestations de prisonniers français évadés place les gendarmes dans des situations embarrassantes. Le chef de corps de la 11e légion saisit, à ce sujet, la direction de la Gendarmerie le 11 janvier 1942 :
« Cela amène les gendarmes, écrit-il, à interroger les familles qui s’étonnent, à juste titre, de voir la Gendarmerie française pourchasser des militaires qui, en droit international, peuvent chercher à s’évader. Il serait désirable que la direction de la Gendarmerie interdise ces recherches qui sont, à mon avis, du strict ressort de la Gendarmerie allemande. »
Dans la plupart des cas, les autorités allemandes agissent par l’intermédiaire des préfectures. Tous les gendarmes ne cèdent pas aux injonctions que leur adresse l’administration. En fin d’année 1940, le préfet d’Ille-et-Vilaine ordonne par écrit, au chef d’escadron Guillaudot, commandant la compagnie, de rechercher, d’arrêter et de remettre aux Allemands un prisonnier de guerre évadé. L’officier renvoie le courrier à l’expéditeur en lui indiquant que la Gendarmerie française, partie intégrante de l’armée, n’arrêterait jamais un autre militaire pour un tel motif. Le préfet convoque le commandant à son cabinet et lui enjoint d’exécuter l’ordre qui émane des Allemands. Le commandant de compagnie se montre intransigeant :
« J’indiquais au préfet, écrit-il, que mon fils aîné, prisonnier des Allemands, s’était lui aussi évadé et avait réussi, grâce au dévouement de la population de l’Est qui l’avait abrité, habillé, ravitaillé et qu’une fausse carte d’identité lui avait été faite par un commissaire de police, qu’il ne pouvait donc être question pour moi, en dehors de la considération précédente, de faire arrêter un militaire évadé et que, de plus, mon devoir était de favoriser toutes les évasions possibles. »
Aux missions permanentes s’ajoutent des tâches occasionnelles dictées par des autorités locales : Feldgendarmerie, douane allemande, Gestapo, militaires. Elles répondent à des besoins de circonstance.
À la fin mars 1944, une commission de contrôle allemande, en déplacement dans le Limousin, disparaît, corps et biens, entre Ussel et Eymoutiers, capturée par les maquisards du colonel Guingoin. À la demande de l’inspection de contrôle de Bourges, la Police française est tenue de fournir une escorte aux commissions lorsqu’elles se déplacent dans des régions spécialement dangereuses. En l’absence de G.M.R. ou de gardes, hypothéqués par des missions prioritaires, la Gendarmerie, à plusieurs reprises, fournit les moyens exigés. Les représentations du commandement auprès des préfets se heurtent à des fins de non-recevoir.
À l’occasion d’opérations de police, des commandants d’unités de l’armée allemande contraignent des gendarmes à leur servir de guide. Lorsque l’ost-bataillon 799 investit les Combes, entre Montignac et La Chapelle-Aubareil (Dordogne), où stationne le groupe F.T.P. Jacquou le Croquant, il charge les gendarmes de Montignac de le conduire sur place. Pendant la marche d’approche, un des sous-officiers désigné tire un coup de feu pour alerter les maquisards qui réunissent à s’esquiver.
Les autorités d’occupation confient des missions statiques à la Gendarmerie. En zone nord, elle participe à la surveillance des lignes téléphoniques et des voies ferrées. En zone sud, au mois de mai 1944, l’inspecteur de l’administration de guerre Hemerling fait garder, par un détachement de 10 gendarmes, près de Saint-Martory (Haute-Garonne), un chantier de forage exploité par la société allemande Continental. Dans de nombreuses agglomérations, les gendarmes assurent la sécurité des hôtels occupés par les personnels administratifs de l’armée allemande.
Lorsqu’ils sont victimes d’attentats ou d’embuscades, policiers et militaires allemands, en règle générale, alertent la Gendarmerie et demandent son intervention, soit pour enquêter sur les faits, soit pour les guider dans leurs opérations de recherche ou encore leur prêter main-forte.
En décembre 1943, deux sections de soldats allemands se rendent au lever du jour à Lévignac-de-Guyenne (Lot-et-Garonne). Ils perquisitionnent au domicile de l’ancien maire pour y rechercher un dépôt d’armes qui leur a été signalé. À leur arrivée, une fusillade se déclenche. Jets de grenades alternent avec le crépitement des mitraillettes. Le chef de détachement demande à la section de Gendarmerie de Marmande d’envoyer immédiatement sur place des gendarmes. L’officier en réfère à sa hiérarchie. Le commandant de légion, par message téléphoné, donne les consignes ci-après :
« Ne pas intervenir directement dans l’action entreprise par les militaires allemands. Détacher immédiatement le nombre de gendarmes nécessaires pour garder les voies d’accès conduisant à la maison. Identifier et, le cas échéant, arrêter tout individu porteur d’armes qui aurait participé à l’agression. Les livrer ensuite à l’autorité judiciaire française. »
Lorsque les gendarmes arrivent sur place, le combat a cessé. Les Allemands déplorent un tué et quatre blessés déjà évacués. Trois cadavres non identifiés gisent dans l’habitation d’où sont partis les premiers coups de feu. La police allemande enlève les armes découvertes par les militaires et arrête six personnes du voisinage.
La mise à exécution d’ordres d’arrestation établis par les Allemands est une des missions qui affecte le plus le moral des personnels. Juifs et étrangers en sont les principales victimes.
Le 6 mai 1942, la Feldgendarmerie convoque le commandant de section de Rouen. Elle lui prescrit de fournir, pour dix-neuf heures, quarante gendarmes pour participer à une opération. Aucun renseignement n’est fourni sur la mission. Le soir, à l’hôtel de la ville, fixé comme point de rassemblement initial, les gendarmes dont l’effectif a pu être réduit à quatorze, à la suite des démarches faites par le commandant de section, reçoivent l’ordre d’arrêter vingt-quatre Juifs désignés nominativement sur une liste qui leur est remise au dernier moment. La police locale participe à l’opération. Les Allemands ordonnent une discrétion absolue et, pour toute intervention infructueuse, l’établissement d’un compte rendu justificatif. À l’issue de la rafle, policiers et gendarmes déposent à la prison de Rouen respectivement soixante-cinq et dix-sept personnes.
Le chef d’escadron Brunet, commandant la compagnie de Seine-Inférieure, expose le 7 mai, dans un rapport confidentiel, les observations qu’appelle le procédé utilisé par les autorités allemandes :
« J’ai l’honneur de signaler qu’il n’est pas possible, à l’échelon exécutant, de protester contre de tels ordres qui ne sont même pas transmis par l’intermédiaire d’une réquisition de l’autorité préfectorale, ni donnés par écrit. »
Il insiste, d’autre part, sur l’impact très défavorable de la mission exécutée par la Gendarmerie :
« Une telle manière de faire, laissant à la Gendarmerie et à la Police française toute l’apparence de la responsabilité entière de l’opération est extrêmement préjudiciable à l’encontre de celles-ci. Des scènes pénibles ont eu lieu, des réflexions acerbes ont été entendues par les exécutants. Les faits seront demain largement connus et amplifiés. Ils déclencheront certainement contre nous une poussée d’antipathie dont il n’était certes pas besoin, actuellement, alors que déjà, d’autres motifs de notre indispensable action, ont cette regrettable résultante. »
Policiers et militaires allemands obligent des brigades à garder temporairement et à surveiller des personnes qu’ils viennent d’arrêter, ceci pour des durées qui s’échelonnent de quelques heures à plusieurs jours, en attendant leur transfert dans les centres d’internement allemands.
Pourtant, par note n° 525 Pol cab. du 18 décembre 1943, Bousquet, fort des assurances qu’il avait obtenues de ses interlocuteurs allemands, rappelait aux services de Police et de Gendarmerie qu’une telle pratique n’était pas admissible. L’occupant en décide autrement. Après le débarquement, Darnand rapporte les instructions de son prédécesseur. Gendarmes et policiers se trouvent alors totalement désarmés pour s’opposer à la prise en charge des individus interpellés par les Allemands.
* *
*
Non seulement l’occupant met en œuvre la Gendarmerie comme bon lui semble et se décharge sur elle de tâches impopulaires, mais encore il s’immisce dans le commandement. Pour les besoins de son information, il sollicite, auprès des divers échelons, des renseignements à caractère interne sur les unités, les personnels, le service, etc.
À la demande d’Oberg, à partir d’avril 1943, la direction générale de la Gendarmerie adresse périodiquement à son état-major une courte note sur les attentats commis contre les personnels et leurs conséquences.
De son côté, le chef de la police allemande du maintien de l’ordre en France exige, en 1944, l’envoi trimestriel d’un tableau renseigné sur le stationnement des brigades motorisées de la zone sud.
Dans plusieurs régions, les Kommandeurs réclament, chaque mois, un état numérique des arrestations effectuées consécutives d’une part aux délits de droit commun, de l’autre à des actions subversives ou terroristes.
Après le débarquement, les états-majors de liaison de la zone sud ordonnent de leur signaler d’urgence « toute désertion, attaque, ou désarmement du personnel par des éléments du maquis ».
Les services d’Oberg, en fin d’année 1943, recueillent auprès des commandants de légion des informations sur les officiers : nom, prénom, grade, emploi, date de naissance, situation de famille, adresse exacte. Selon les consignes, toutes modifications aux états fournis doivent être actualisées, au fur et à mesure qu’elles se produisent. Un commandant de région s’entoure de précautions avant d’autoriser ses subordonnés à répondre. Il demande la marche à suivre à la direction générale de la Gendarmerie. Le général Martin, en janvier 1944, répond :
« J’estime qu’il n’est pas possible, eu égard à la situation actuelle, de refuser au commandant de la police allemande du maintien de l’ordre les renseignements qu’il vous a demandés en ce qui concerne les officiers de Gendarmerie. » Les projets élaborés par l’administration centrale, de portée individuelle ou générale, ne reçoivent une suite que dans la mesure où ils obtiennent l’agrément des autorités allemandes. Leur approbation est ainsi nécessaire concernant les officiers, en matière de mutation d’une zone à l’autre et de recrutement.
À la fin de l’année 1943, plus de 80 postes d’officiers subalternes sont vacants malgré les mesures prises pour les combler : maintien en activité d’officiers au-delà de la limite d’âge, recrutement interne s’adressant aux gradés et gendarmes ayant effectué des études supérieures à la deuxième partie du baccalauréat, titulaires d’une licence ou d’un ou plusieurs certificats, ou admissibles à une grande école. Le recours à des officiers démobilisés de l’armée d’armistice constitue la solution la plus satisfaisante pour pallier à l’insuffisance de la ressource.
Le 26 janvier 1944, le général Martin adresse à Oberg le projet de circulaire relatif au recrutement de dix capitaines et soixante lieutenants et sous-lieutenants. Le document précise :
« Les admissions, faites sur pièces, seront prononcées par arrêté du chef du Gouvernement, après agrément de la commission de reclassement des officiers démobilisés. Elles ne seront prononcées qu’après une enquête très sérieuse établissant le loyalisme de l’intéressé et de sa famille à l’égard du chef de l’État et du chef du Gouvernement… »
Pour les questions se rapportant à l’armement, la direction ne possède aucun pouvoir de décision. Elle doit s’en remettre à l’occupant. On connaît sa méfiance. Or, depuis juillet 1940, l’état de l’armement, vétuste (revolver Mle 1892 et mousqueton Mle 1916) et qui souvent fonctionne mal, ne cesse de se détériorer.
Des armes sont réformées, d’autres enlevées par le maquis au cours de l’attaque de brigades et de patrouilles. Ce type d’actions se multiplie à travers le pays à partir de l’année 1943. La direction, dépourvue de réserves, n’est pas en mesure de les remplacer. Dans le même temps, la liste des gendarmes abattus en service s’allonge. Le personnel se sent en état d’infériorité. Plus par souci défensif que par intention belliqueuse, la direction demande, de façon pressante, le recomplètement et l’augmentation de l’armement.
Le 18 octobre 1943, le général Oberg fixe les nouvelles dotations des forces du Maintien de l’ordre. Leur mise en place est subordonnée à deux conditions : participer à des opérations importantes et obtenir des résultats significatifs contre les « terroristes ».
Les dotations des gendarmes restent pratiquement en l’état. Sans en référer à Oberg, par dépêche du 9 novembre 1943, la direction générale de la Gendarmerie invite les commandants de légion à conserver et à prendre en compte les armes récupérées provenant de saisies ou de parachutages. Ayant eu fortuitement connaissance de ces dispositions, le 15 janvier 1944, Oberg s’adresse à Darnand au sujet des armes confisquées, en France méridionale, par la Gendarmerie :
« C’est ainsi que la direction générale de la Gendarmerie française dans une circulaire du 9 novembre 1943, adressée aux commandants de légion a déclaré que les autorités allemandes avait autorisé l’emploi pour l’armement de la Gendarmerie des armes parachutées ou saisies par la Gendarmerie française. J’attire expressément votre attention sur le fait qu’une telle autorisation n’a jamais été accordée par moi-même ni par les services placés sous mes ordres… La circulaire ci-dessus mentionnée devra être rapportée. »
Le 22 mars 1944, le général Martin s’incline. Il abroge la dépêche visée et rappelle à tous les échelons « que toutes les armes découvertes ou saisies par la Gendarmerie, qu’elles proviennent de parachutages ou de dépôts d’armes non déclarés de l’ancienne armée d’armistice, devront être remises, sans condition, aux services de police allemande occupante ».
L’ingérence de l’occupant dans le commandement se manifeste également au plan de l’organisation. Courant 1943, il donne l’ordre de transférer immédiatement la brigade de Le Verdon (Gironde) à Soulac. De même, en mars 1944, il force la direction à lui céder, dans des délais extrêmement brefs, l’école préparatoire de Romans ou six cents élèves-gendarmes sont en cours de formation.
Le commandement n’a plus seul l’apanage de l’action disciplinaire. Il reçoit des mises en demeure des autorités allemandes pour muter, punir et révoquer des personnels.
Le chef Gatillon et le gendarme Lannaud, de la brigade de Couhé (Vienne), font l’objet, en mars 1943, d’une mutation immédiate pour ne pas avoir signalé à l’occupant l’identité des organisateurs d’une manifestation patriotique interdite.
Comme tous les fonctionnaires français en uniforme, les gendarmes doivent le salut aux officiers allemands. Une circulaire de la direction fixe les règles à observer à la suite d’un rappel à l’ordre du commandement allemand. En juillet 1943, elle invite les chefs de corps à rappeler aux unités sous leurs ordres « ces prescriptions impératives sur l’échange du salut qui ne semblent pas toujours appliquées et à l’observation desquelles elles doivent tenir la main ». Quelque temps après, deux gendarmes d’une légion affectent de ne pas voir des officiers de la Feldgendarmerie. Ceux-ci réclament une sanction. Un seul des deux gendarmes est identifié. Le commandement le sanctionne de dix jours d’arrêts. À propos de cette affaire, le chef de corps rend compte « qu’il est à remarquer que si les officiers répondent au salut que leur adressent toujours les premiers les officiers français, aucun officier allemand, en revanche ne salue jamais le premier un officier français d’un grade supérieur ». Dans la même légion, en janvier 1944, le lieutenant B… se voit infliger une punition de 8 jours d’arrêts « pour ne pas avoir salué un officier supérieur allemand. »
En présence de gendarmes qui ne se conforment pas aux marques extérieures de respect, des officiers allemands s’emportent et profèrent des menaces. Le 14 février 1944, le gendarme Huguenet, de la brigade de Toulouse, se rend à bicyclette au poste de grade où il est détaché. En cours de route, il croise un détachement allemand. À peine l’a-t-il dépassé qu’un militaire sort des rangs et braque sur lui un pistolet-mitrailleur parce qu’il n’a pas salué l’officier. Ce dernier s’approche d’Huguenet en vociférant et fait cingler sa cravache, par deux fois, près du visage du gendarme qui rectifie alors la position. Un gradé lui demande de présenter ses papiers. Il acquiesce et peut reprendre sa route. Au terme de l’enquête effectuée à la suite de cet incident, le commandement de la Gendarmerie classe l’affaire sans suite. Il estime que le gendarme Huguenet « de bonne foi, n’a pas reconnu l’officier et qu’il a conservé son sang-froid, son tact et sa dignité lorsqu’il a été pris à parti sur la voie publique. »
Sur ordre des services d’Oberg, le commandement met en position de réforme, le 28 décembre 1943, le chef d’escadron Meurs. Dans les mêmes conditions, il révoque d’autres personnels. On a vu comment M. Nouvel, chargé de missions auprès de la direction générale, doit cesser ses fonctions.
Les Allemands ne se contentent pas d’employer la Gendarmerie à leur profit ou d’interférer dans le commandement, ils la surveillent étroitement. Les Kommandeurs régionaux actionnent à cet effet les commissions de contrôle, la police d’ordre ou le Sipo/SD.
En février 1944, un major allemand de la police d’ordre, accompagné de deux civils du Sipo/SD, se présente au camp d’internement de Saint-Sulpice-La-Pointe (Tarn) pour contrôler le détachement de Gendarmerie qui en assure la défense extérieure. Il interroge longuement le lieutenant qui commande le dispositif constitué de trois pelotons. Les questions posées portent sur les modalités d’organisation du service, la nature de l’armement, le dispositif de défense adopté. D’après le compte rendu du chef de détachement, l’officier allemand « s’est d’abord étonné que chaque F.M. (fusil-mitrailleur) ne soit pas doté de mille cartouches, puis il a estimé que la dotation actuelle était insuffisante compte tenu de l’armement individuel du personnel… »
De leur côté, les autorités militaires suivent attentivement le comportement des gendarmes. Chaque corps d’armée établit mensuellement une synthèse de leur activité, à partir des rapports fournis par les divisions.
Le XXVe corps d’armée, stationné en Bretagne, relève en juillet 1941 « qu’outre l’arrestation à Brest de trente-sept personnes de la bande gaulliste, signalée dans le rapport de juin, sept autres personnes ont été arrêtées, dont un gendarme français convaincu d’aide à l’évasion d’un Canadien vers l’Angleterre ». En août 1941, la 205e division note « que de Français bien-pensants indiquent, à plusieurs reprises, au cours de conversations, que les gendarmes français, par exemple à Quiberon, Auray, Lorient sont pro-Anglais et contre la nouvelle orientation. » Le 28 novembre 1941, la 709e division reconnaît les efforts de la Gendarmerie française. C’est ainsi qu’elle a pu « avec la collaboration de la population civile, arrêter quelques aviateurs anglais descendus en parachute de leur appareil en flammes, le 5 novembre près de Saint-Aubin et les livrer aux autorités allemandes. » Une autre synthèse souligne en fin d’année 1942 « l’attitude de la Gendarmerie française qui, à Angers, a procédé à la réquisition de tracts ennemis. » Le compte rendu relatif à la période du 6 juin au 31 juillet 1944, indique que « dans la nuit de l’invasion, beaucoup de membres de la Gendarmerie nationale ont abandonné leur service et se sont joints aux terroristes qui ont déployé une activité intense ». On relève le 4 août : « Central à répétition de Vannes investi, à 12 h 15, par les terroristes guidés par des gendarmes français et sommé de se rendre. »
* *
*
Pour mettre au pas la Gendarmerie, les Allemands ne reculent devant aucun moyen : arrestation, condamnation, déportation, chantage, menace, provocation, etc. L’évocation de quelques situations donne la mesure exacte de leur machiavélisme.
Comme la population, les gendarmes ne sont pas épargnés par le comportement inquisitorial de l’occupant qui s’intensifie à partir du début de l’année 1943 jusqu’à la Libération. À la mi-septembre 1943, les troupes d’opérations investissent Casteljaloux (Lot-et-Garonne) en vue d’y rechercher de l’armement, des munitions et du matériel parachuté. Les armes à la main, elles font irruption à la Gendarmerie sous la conduite d’un officier. L’adjudant Montariol, commandant la brigade, tente de s’y opposer, mais en vain. L’officier passe outre. Commence alors une fouille minutieuse des locaux de services (bureaux, garage, etc.) et de tous les appartements. Informée des faits, la direction des services de l’armistice, section guerre, est impuissante à en prévenir la répétition.
Les cas d’intrusion se multiplient. Début janvier 1944, après avoir placé des sentinelles aux différents accès de la caserne de Valence, une dizaine de Feldgendarmes pénètrent dans le bâtiment et s’emparent de plusieurs postes de radio qu’ils démontent et chargent sur un camion. À Pierrelatte (Drôme), le 16 mars 1944, les SS désarment les gendarmes et les gardent à vue toute la journée.
Les Allemands estiment insuffisante la réaction des cadres et élèves-gendarmes (deux compagnies et demie) de l’école préparatoire de Pamiers lors de l’attaque de la caserne par le maquis, à deux reprises, les 8 et 13 juin 1944. En représailles ils les désarment et les internent au camp du Vernet (Ariège). En particulier, ils reprochent à quelques stagiaires d’avoir fraternisé avec les maquisards – poignées de mains, acceptation de cigarettes – et de les avoir même aidés en poussant leurs camions remplis du matériel « enlevé » à l’école.
L’arrestation du gendarme Nicolas Domballe, de la brigade de Bonneville (Haute-Savoie), s’inscrit dans un contexte différent. La Gestapo, qui lui reproche d’avoir aidé des réfractaires à échapper au S.T.O., l’arrête le 29 septembre 1943. En tant qu’Alsacien, elle le sollicite pour servir le Reich dans la police ou l’armée allemande. Il lui oppose un refus ferme. Transféré immédiatement au fort Montluc, à Lyon, il est ensuite déporté au camp de Mauthausen (Autriche). Il y meurt le 9 juin 1944, victime des mauvais traitements et des coups reçus.
Autre arrestation, autre cause. En juin 1941, au cours d’une enquête de routine, le gendarme Marsault, de la brigade de Poitiers, se rend au domicile des époux X…, sur le territoire de la commune de Jaunay-Clan. Deux photographies du maréchal Pétain sont apposées dans le hall d’entrée. À leur vue, il dit à ses interlocuteurs « qu’ils feraient mieux de les remplacer par un portrait du général de Gaulle. » Au cours de la conversation, les intéressés lui font part de leur certitude que la guerre se terminera par la victoire des Allemands. Le gendarme Marsault affirme le contraire. Au mois de décembre, des collaborateurs, au nombre desquels le couple X, assistent à Jauney-Clan à une conférence d’un militant du P.P.F., le docteur Michel Guérin de Poitiers. Des perturbateurs conspuent l’orateur. L’incident dégénère. Avisée des faits par les organisateurs, la Gestapo se livre à une enquête. Elle entend les époux X qui lui répètent les propos tenus, six mois plus tôt, par le gendarme Marsault. Fin janvier 1942, ce sous-officier est placé en détention en même temps que trois autres gendarmes accusés de ne pas avoir assuré le service d’ordre avec assez de vigilance pendant la réunion organisée par le P.P.F. Le tribunal de guerre allemand de Poitiers condamne le gendarme Marsault à deux ans de prison « pour avoir favorisé l’ennemi en tenant des propos gaullistes. » L’intéressé subit sa peine au camp de Bückloé (Bavière). Sa libération intervient le 19 mars 1944.
Sur intervention de Bousquet, auprès d’Oberg, au moment des discussions sur la coopération des polices, les autorités allemandes libèrent trois autres gendarmes détenus et huit civils impliqués dans l’incident. Dans une note adressée au chef du Gouvernement, le 26 juillet 1942, Bousquet écrit :
« L’affaire des gendarmes est réglée. Ils sont relâchés. Il faudrait d’urgence prier Chasserat de les affecter en zone libre. »
Tout autre est le motif qui provoque l’incarcération du capitaine Peytou, commandant la section de Mont-de-Marsan (Landes). Le 23 avril 1941, le tribunal de la Feldkommandantur 541 délivre un mandat d’arrêt contre lui parce qu’il a contrevenu à des prescriptions édictées par les autorités d’occupation :
« Étant donné, indique le chef d’inculpation, qu’après la conclusion de l’armistice entre l’Allemagne et la France il a expédié, par le canal de la poste de service, de la correspondance privée de gendarmes français de la zone occupée et vice-versa, tout en abusant du sceau du service de la Gendarmerie française, crime contre le décret concernant la communication postale et télégraphique dans les territoires occupés de l’ouest du 30 décembre 1940 et parce que le but d’information exige sa détention. »
Au terme de l’instruction, le tribunal condamne l’officier à trois mois de cellule du 23 avril au 23 juillet 1941. Le chef Roques, secrétaire du commandant de section, purge quelques mois plus tard une peine identique.
Toutes les arrestations n’ont pas le même épilogue. Certaines s’achèvent tragiquement. Au début de mars 1944, le gendarme Doulcier, de la brigade de Cordes (Tarn), arrête un individu armé, étranger à la région, qui menace d’abattre quiconque voudrait l’interpeller. Le personnage, fiché comme repris de justice, déclare être un auxiliaire de la Gestapo. Le gendarme Doulcier, très imprudent, lui dit alors « qu’il aimerait mieux le remettre aux terroristes qu’aux Allemands ». La Feldgendarmerie d’Albi confirme que l’intéressé travaille pour la police allemande et somme les gendarmes de le libérer. L’affaire paraît close. Le 20 avril, la Feldgendarmerie arrête le gendarme Doulcier et le conduit successivement à Albi puis à Toulouse. Dernière destination : l’Allemagne. Toutes les démarches faites pour avoir de ses nouvelles échouent. Marié, père de quatre enfants âgés de dix, sept, cinq et quatre ans, ce sous-officier meurt en déportation en février 1945.
Les Allemands arrêtent des gendarmes à titre de représailles. À la suite d’un engagement contre des éléments de la Résistance, près d’Estang (Gers), en juin 1944, les troupes d’opérations pénètrent dans la caserne de la Gendarmerie et appréhendent le chef Verdier, les gendarmes Capdeville et Méligner. Tous trois sont déportés. Le gendarme Capdeville ne reviendra pas des camps de la mort où il succombe le jour de Noël 1944.
En mars 1944, les gendarmes de la brigade de Rouffignac (Dordogne) connaissent le même sort que ceux d’Estang. Des maquisards exhibent, dans un café de l’agglomération, trois prisonniers allemands, dont un officier. Alors qu’ils quittent les lieux, ils se heurtent à une patrouille ennemie. Dans la confusion, deux des captifs s’évadent. Le lendemain, d’importantes forces allemandes investissent Rouffignac. Parmi les otages qu’elles rassemblent sur la place publique, les gendarmes Grenier, Cantot, Sureau et Duberger. Avant d’incendier Rouffignac, en fin de journée, les troupes d’opérations interceptent le chef Longuechaud et les gendarmes Malaurie et Andrieux qui rentrent d’un service externe. Détenus au fort Montluc, à Lyon, ces trois militaires recouvrent la liberté en août 1944. En revanche, les Allemands déportent les gendarmes Sureau, Grenier, Cantot et Duberger. Aucun d’eux ne reverra la France.
À Argenton-sur-Creuse, le 9 juin 1944, les SS sont plus expéditifs. Ils prennent les gendarmes en otage et les fusillent sur-le-champ. Dans la matinée, le maquis les a désarmés puis consignés dans leur caserne avant d’attaquer un train d’essence, gardé par un petit détachement de l’armée allemande, rapidement neutralisé. Une compagnie du régiment Der Führer, de la division Das Reich, reçoit l’ordre de dégager Argenton. Elle y arrive en fin de journée. Après avoir rassemblé les hommes, au nombre d’une centaine, un officier SS fait sortir des rangs les fonctionnaires de police. L’adjudant Carmier, les gendarmes Thimonier et Bodineau, un brigadier de police et deux gardes-voies des communications obtempèrent. Les Allemands les exécutent sans explication. Au petit matin, le 10 juin, les SS abattent à la carrière de Gramagnat dix autres otages parmi lesquels les fils du gendarme Thimonier, âgés de seize et dix-huit ans. Le plus jeune avait été retenu car dépourvu de papier d’identité. Son frère Ernest se justifie. Les SS le libèrent. Désespéré de voir son cadet emmené, il s’approche du camion pour l’embrasser et le réconforter une dernière fois. Les SS le font monter à son tour dans le véhicule. Le destin, un moment plus tard, les réunit dans la mort.
Le meurtre occupe une bonne place dans la panoplie des moyens utilisés par l’occupant pour punir les gendarmes trop indépendants. L’agression commise en 1943, contre la brigade de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), le démontre amplement.
À deux heures du matin, le 7 décembre, une voiture s’immobilise devant la Gendarmerie de Sainte-Foy-la-Grande. Deux militaires allemands accompagnés d’un civil en descendent. Les visiteurs actionnent la cloche de la caserne, puis frappent violemment à la porte d’entrée. Le gendarme assurant le service de « planton », réveillé en sursaut, demande depuis la fenêtre de son logement quel est l’objet de cet appel. Dans la pénombre, une injonction : « Police allemande, ouvrez, descendez comme vous êtes ». Le gendarme Peleuse prévient les deux gradés, l’adjudant Pradier et le chef Castets. Tous trois rejoignent le bureau bientôt suivis des gendarmes Métais et Barreau.
À peine introduits dans la caserne, les visiteurs pressent l’adjudant Pradier de questions sur l’attentat dont a été victime, quelques jours auparavant, le nommé Verdier, délégué à la propagande du maréchal Pétain et ami intime de Henriot. Subitement, ils mettent les gendarmes en joue avec leurs mitraillettes et ouvrent le feu en criant : « Au mur, Verdier va être vengé ! » Mortellement touchés, les gendarmes Métais et Barreau s’effondrent. Les mêmes rafales couchent au sol le chef Pradier, blessé à la cuisse, ainsi que le gendarme Peleuse. Le chef Castets, indemne, se jette au sol pour éviter la tuerie. Rapidement, les agresseurs arrachent les fils du téléphone, puis quittent le bureau après avoir collé sur la porte d’entrée, un papillon portant la mention « À la mémoire de Verdier ».
Plus de huit mille personnes, quelques jours après, assistent aux obsèques des deux victimes. La collecte, organisée à l’initiative de la municipalité, en faveur des deux veuves et de leurs enfants, permet de recueillir deux cent mille francs. Par sa ferveur et sa générosité, la population signifiait en quelle estime elle tenait « ses gendarmes ». Quant à l’occupant, il considère l’hommage rendu aux victimes comme une manifestation d’hostilité à son endroit, ce qui accentue son courroux.
L’agression perpétrée contre les gendarmes a son origine dans l’exécution de Verdier, neveu du cardinal archevêque de Paris décédé au printemps de l’année 1940. Domicilié au château de La Fosse, à Riocaud, Verdier, âgé de trente-neuf ans, a pour voisin Philippe Henriot, propriétaire d’une maison à Picou, près de Sainte-Foy-la-Grande. Collaborateur notoire, il ne trouve pas auprès des gendarmes l’aide espérée pour combattre les adversaires du régime. Peu enclins à se laisser manipuler, à plusieurs reprises, les gendarmes n’hésitent pas à le verbaliser pour des abattages clandestins. D’où l’inimitié qu’il leur voue. Dans un rapport remis en mai 1943 à Jacques Guérard, secrétaire général du chef du Gouvernement, il se plaint des difficultés de tous ordres auxquelles il se heurte et qui l’empêchent de mener à bien son action. En particulier, il dénonce la tiédeur des gendarmes :
« Les gendarmes eux-mêmes, souligne-t-il, ne sont pas sûrs : dans mon arrondissement, sur un effectif de cent, cinq seulement suivent le maréchal. »
Sur ses indications, entre le 4 novembre et le 3 décembre 1943, les troupes d’opérations arrêtent une vingtaine de personnes dans la région de Sainte-Foy-la-Grande. La Résistance ne tarde pas à réagir. Dans la soirée du 1er décembre, alors qu’il rejoint son domicile, en automobile, des inconnus tirent sur lui plusieurs coups de feu. Blessé, il est transporté à l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande situé à moins de cent cinquante mètres de la Gendarmerie.
Le 3 décembre, il reçoit plusieurs visites, dont celle de Philippe Henriot. Deux jours plus tard, à la tombée de la nuit, deux hommes en uniforme de gendarme s’introduisent dans l’hôpital et se dirigent vers la chambre de Verdier où se trouvent son épouse et sa nièce. Plusieurs coups de feu claquent. Puis, c’est le silence suivi de la découverte des trois corps. Le 7 décembre, les Allemands s’en prennent aux gendarmes de Sainte-Foy-la-Grande.
Comme on l’apprendra par la suite, les auteurs de l’attentat contre Verdier et sa famille appartiennent au groupe de résistance Martin. Il n’y avait aucun gendarme parmi eux. Seuls deux membres du commando portaient un uniforme de gendarme fourni par un tailleur de Bergerac.
Allemands et collaborateurs soupçonnent de complicité les gendarmes de Sainte-Foy-la-Grande, principalement le chef Pradier. Ils reviennent d’ailleurs, quelques jours plus tard, pour lui arracher des aveux.
« Le 12 décembre à 17 h 15, écrit le chef Pradier, un officier allemand, accompagné de quatre militaires venant de Bordeaux, vint pour m’interroger. Mon interrogatoire dura 6 h 30, de 17 h 30 à minuit. M’étant refusé à leur donner les noms des membres de la Résistance et des principaux chefs, ainsi que les emplacements du maquis, ils menacèrent de me conduire sur le champ au fort de Hâ à Bordeaux. Je fus traité de « gaulliste », terroriste, vendu, traître, n’étant pas derrière le maréchal Pétain, etc. Bien que je sois blessé, l’officier ne me donna jamais l’autorisation de m’asseoir. Constatant que mes forces m’abandonnaient, cet officier devint plus menaçant allant jusqu’à la violence en me bousculant durement. Je ne me laissais pas intimider et il finit par m’accorder un moment de repos. Ma famille ayant quitté la caserne le matin même, vers 0 h 30, réunissant mes forces, je me sauvai à travers la campagne. »
Pour soustraire ce gradé aux périls qui le menacent, ses chefs le placent momentanément en congé avant de le muter à Brive le 1er avril 1944.
L’approche de la défaite, après le débarquement, décuple la cruauté de l’occupant aux abois. Lorsqu’ils entament leur retraite, à partir d’août 1944, les Allemands abattent sauvagement des gendarmes. En Gironde, le 22 août 1944, ils prennent de force le chef Carraze et le gendarme Giret du poste de Cazaux. Les trois hommes, enfermés dans la centrale électrique, sont exécutés à la mitraillette. Ils achèvent le gradé d’une balle dans la nuque. Des scènes semblables se déroulent sur l’ensemble du territoire entre juin et décembre 1944.
Les Allemands usent aussi de la menace pour intimider les gendarmes. En avril 1944, un officier allemand, qui participe aux opérations engagées dans le Limousin pour réduire les maquis, convoque à la mairie de Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) l’adjudant Montagnac, commandant la brigade. Il met ce gradé en demeure de désigner, dans le quart d’heure qui suit, l’endroit exact où sont réfugiés « les hors-la-loi », l’emplacement précis des dépôts d’armes et de dresser une liste nominative des personnes de sa circonscription sympathisantes avec la Résistance. Le chef de la police allemande qui accompagne les troupes, à défaut de renseignements, menace d’exécuter les gendarmes. Suivent de longues heures d’angoisse pour l’adjudant et ses gendarmes regroupés à la mairie. Tous s’attendent au pire. Ils affirment ne rien savoir. En fin de journée, les Allemands les remettent en liberté.
Même scénario, dans le Lot, en mai 1944. Le 11 au matin, la compagnie du Lot signale par message téléphoné au commandant de légion l’arrivée des troupes allemandes dans le département :
« Opération allemande massive au nord Figeac. Brigades Gramat, Latronquière, Lacapelle-Marival occupées. Bureaux de poste Saint-Céré, Sousceyrac ne répondent pas. »
À Saint-Céré, des éléments de la division Das Reich cernent la Gendarmerie, désarment le personnel et conduisent les gendarmes sur la place de la mairie. Entre huit heures et seize heures, un officier SS interroge à trois reprises le commandant de brigade sur l’existence de « groupes terroristes dans la région. » Il menace de le traduire devant un tribunal militaire s’il ne fournit pas de renseignements. Le gradé persuade son interlocuteur qu’il ne sait rien. On le libère en début de soirée.
Dans toutes les brigades, les SS opèrent de la même manière. Cependant, à Sousceyrac, ils arrêtent le chef Teyssié, les gendarmes Vergnes, Bailly, Hugon, Mompontet. Emprisonnés à Montauban, ils sont relâchés le 14 mai. Ceux de Souillac, au nombre de six, devront attendre le mois d’août pour être libérés. Quant aux gendarmes Bernardin, Carles et Blondet de Latronquières, ils sont déportés au camp de Neuhengame.
À Figeac, les SS fouillent la Gendarmerie de fond en comble, par deux fois, les 11 et 12 mai. En même temps que des centaines de Figeacois, ils gardent les gendarmes à vue. Pendant deux heures, ils soumettent le commandant de section à un interrogatoire sur les services effectués par la Gendarmerie et les opérations contre « les terroristes ».
Le témoignage du chef Sablayrolles rend compte de leur agressivité : « Après en avoir reçu l’ordre, écrit-il, l’un des militaires allemands m’a plaqué au mur et m’a tenu en joue avec sa mitraillette pendant toute la durée de l’opération (fouille de la caserne). Le résultat ayant été négatif, j’ai été relâché. Quelques instants plus tard, j’ai été plaqué une deuxième fois au mur, la même arme braquée sur moi. La colère des Allemands atteignait son paroxysme et ma mort paraissait certaine. Au même instant, j’ai reçu l’ordre de commander aux gendarmes qui se trouvaient encore dans la cour de se rendre au domicile du sous-préfet et du docteur B… J’ai été informé aussitôt que la non-exécution de cet ordre entraînerait ma mort. Le docteur B… était absent de son domicile. Le sous-préfet, après quelques réticences, s’est rendu à la caserne accompagné des deux gendarmes et a provoqué ma libération. »
L’emploi de la menace est fréquent pour forcer l’obéissance des gendarmes. Afin d’éviter que son convoi ne soit attaqué par la Résistance, un officier allemand, chef d’une colonne, demande en juin 1944 au commandant de brigade de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) de lui fournir deux gendarmes pour l’accompagner. Le gradé refuse. Sous la menace de leurs armes, des soldats obligent deux militaires de la brigade à prendre place dans les véhicules. On les informe qu’ils seront fusillés si, en cours de route, les maquisards attaquent le détachement.
Beaucoup plus insidieux est le recours à la provocation qui permet à l’occupant, grâce à des agents à sa solde, de tester les réactions des gendarmes à son égard. En septembre 1943, une brigade des Basses-Pyrénées appréhende un inconnu qui, ostensiblement, attire l’attention. Conduit à la Gendarmerie pour vérification d’identité, il déclare aux gendarmes qu’il a l’intention de passer en Espagne pour rejoindre l’Afrique du Nord et combattre dans l’armée française. Les gendarmes pressentent un piège. Pour le déjouer, ils placent l’intéressé en garde-à-vue.
Inquiet de la tournure que prennent les événements, ce dernier avoue travailler pour les Allemands et avoir reçu pour mission de découvrir les passeurs de la région. La douane allemande confirme aux gendarmes qu’il s’agit d’un de ses agents. Elle leur recommande de ne pas ébruiter l’affaire. Les gendarmes qui connaissent bien les passeurs du secteur ne manquent pas de les informer.
Quelques mois plus tard, le général Balley, inspecteur général de la Gendarmerie en zone nord, par note confidentielle, diffusée dans les deux zones, met en garde tous les gendarmes contre « les dangers que leur font courir les agents provocateurs qui chercheront à les entraîner hors du devoir ou à les faire parler pour les dénoncer ensuite. » Si, à première vue, ces recommandations peuvent paraître équivoques, les cas concrets qui les accompagnent ne laissent planer aucun doute sur la qualité des provocateurs.
En zone nord, début 1944, une brigade apprend qu’un groupe d’individus armés vient de descendre dans un hôtel. Le commandant de section, alerté, investit les lieux avec des moyens étoffés. Les gendarmes neutralisent rapidement les intéressés au nombre de six, tous armés.
Ceux-ci refusent de décliner leur identité et déclarent faire partie d’une section antiterroriste, travaillant pour le compte des Allemands, chargée d’observer la brigade locale pour voir comment elle se comporte. La police allemande ordonne de les remettre en liberté et de leur restituer leurs armes.
Dans le même temps, deux autres individus de ce groupe, alors qu’ils circulent en véhicule, arrivent sur un poste de contrôle de Gendarmerie. Ils déclarent faire partie du maquis. Les gendarmes les laissent passer sans difficulté. Poursuivant leur route, ils se heurtent à un nouveau barrage. Les vérifications d’identité se déroulent dans les règles. Une fouille approfondie permet de découvrir des armes. Conduits à la Gendarmerie pour y être interrogés, l’un se donne comme capitaine canadien français, l’autre comme lieutenant, tous deux membres de la Résistance. Ils proposent aux gendarmes de les laisser s’enfuir et de tirer des coups de feu pour laisser croire à une évasion. Le chef de poste refuse, mais il à l’imprudence d’accompagner sa réponse de commentaires favorables à la Résistance. Dans les heures qui suivent, la police allemande donne l’ordre à la Gendarmerie de libérer ses protégés. Le lendemain, la Gestapo arrête le gradé et les trois gendarmes qui avaient laissé poursuivre leur route aux deux individus disant appartenir à une organisation clandestine.
Aux provocations s’ajoutent des brimades humiliantes qui relèvent de la barbarie quand elles s’exercent sur des gendarmes privés de liberté. Qu’ont-ils à redouter d’eux, les bourreaux, dans les camps de concentration ? En 1955, Edmond Michelet témoigne du supplice infligé au chef d’escadron Veyssières, commandant la compagnie du Lot, arrêté et déporté à Dachau en mai 1944 en raison de sa complaisance à l’égard des patriotes.
« Voici, rapporte-t-il, un officier de Gendarmerie, le commandant Veyssières, à qui dans la pagaïe de l’arrivée, les SS ont laissé son képi et son baudrier. Un jour, histoire de s’amuser, le Blockführer, à la sortie d’une séance de douches, lui a retiré tous ses autres accessoires. L’effet du ridicule est tout à fait réussi : dix fois, vingt fois, il a fallu que Veyssières défile sur le front des haftlingues (détenus) ahuris : « schnell, schnell ! » L’autre éclata de rire en se tapant sur les cuisses. À la fin, l’officier français n’en pouvant plus s’est abattu de rage et de honte devant ses camarades aux dents serrées. »
Transféré à Niekargerack, l’officier y contracte le thyphus. Son état nécessite son départ « en transport » dans un camp sanitaire où les conditions de vie sont pires qu’à Dachau. On le laisse sans couverture, sans nourriture, rongé par la vermine. À sa libération, le 7 avril 1945, il ne pèse que vingt-cinq kilos. Quatre jours après, il s’éteint en terre allemande à Spire.
Jusqu’en juin 1941, date d’entrée en guerre de la Russie, qui coïncide avec le passage brutal des organisations communistes à la Résistance, la coopération entre la Gendarmerie et l’occupant se limite, d’une façon générale, à des actes administratifs et techniques. Les gendarmes s’y plient avec résignation. Lorsque la coopération les engage dans des actions contre les Juifs, les réfractaires au S.T.O., les maquisards, leur réticence ne fait que croître.
Leur comportement n’échappe pas à l’occupant. Il détermine de sa part de vives réactions. Dépité de ne pouvoir faire du gendarme un allié, il le traite en suspect et en ennemi. De là, les procédés iniques mis en œuvre pour le forcer à collaborer, une collaboration dont les Allemands ne veulent pas se priver, car ils ne disposent pas d’une infrastructure suffisante pour prendre à leur compte, sur l’ensemble du territoire, la totalité des problèmes de sécurité.
Du printemps de l’année 1943 au mois d’août 1944, la Gendarmerie subit l’action néfaste de la Milice qui engendre progressivement une situation conflictuelle. Celle-ci atteint son point culminant en juin 1944. Avant l’examen des faits, il importe de situer cette organisation par rapport à la Gendarmerie, ce qui revient à rappeler sa nature, son rôle et ses structures.
La Milice n’est pas un organisme d’État, mais une simple association fondée par Laval à la demande des autorités allemandes désireuses de voir les services de sécurité officiels renforcés par une police supplétive dévouée à la politique de collaboration. La loi du 30 janvier 1943 portant sa création la reconnaît « d’utilité publique » et la place sous les ordres du chef du Gouvernement. L’administration et la direction effective du mouvement incombent à un secrétaire général. Pierre Laval confie le poste au chef du Service d’ordre légionnaire, Joseph Darnand.
CHAPITRE 12 – L’EMPREINTE DE LA MILICE
L’article 46 du règlement général sur son organisation met l’accent sur le rôle qu’elle est appelée à jouer dans le maintien de l’ordre.
« La Milice est donc employée dans les manifestations dirigées contre l’État et son Gouvernement. Éventuellement, elle est employée pour réprimer les troubles et les émeutes possibles, bref, pour participer au maintien de l’ordre chaque fois que celui-ci est troublé. »
En avril 1943, le maréchal Pétain confirme, sans équivoque, le rôle qui lui est dévolu :
« La Milice doit être investie de toutes les missions d’avant-garde, notamment celle relative au maintien de l’ordre, à la garde des points sensibles, à la lutte contre le communisme… »
Organisme à la fois nationaliste, fidèle à Pétain et collaborationniste dans les premiers temps de sa création, la Milice se transforme, fin 1943, en police supplétive allemande. Selon les estimations, elle comprend près de 29 000 inscrits parmi lesquels de nombreux anciens membres du Service d’ordre légionnaire et de nouveaux adhérents recrutés dans toutes les catégories socioprofessionnelles.
La Milice repose sur une organisation territoriale calquée sur les circonscriptions administratives, à savoir le département et la région. À chacun de ces niveaux un chef a sous son autorité l’ensemble des miliciens. Son organe d’exécution militarisé prend le nom de Franc-garde. Encadré par d’anciens officiers et sous-officiers, il se subdivise à partir de juin 1943. D’une part en Franc-garde permanente, ce sont les « militaires » de la Milice, encasernés, payés et armés, d’autre part, en Franc-garde bénévole, il s’agit de miliciens mobilisables qui s’engagent à rejoindre la Franc-garde permanente au premier appel de leurs chefs. Forte d’un millier d’hommes en janvier 1944, la Franc-garde, à la veille du débarquement, atteint l’effectif de 5 000. La main (5 hommes) constitue l’unité élémentaire de la Franc-garde structurée par ailleurs en dizaines, trentaines, centaines et cohortes (300 hommes).
Pour former les dirigeants, chefs régionaux et départementaux ainsi que les officiers de la Franc-garde, Darnand crée, en février 1943, une école des cadres à Saint-Martin-d’Uriage (Isère).
Si l’on se réfère à leur statut, on observe que la Milice et la Gendarmerie présentent des caractéristiques communes. Toutes deux relèvent, en dernier ressort, de l’autorité du chef du Gouvernement. Avec l’accession de Joseph Darnand aux fonctions gouvernementales de secrétaire général au Maintien de l’ordre et la nomination de chefs miliciens dans les postes d’intendants régionaux du Maintien de l’ordre habilités à régler l’utilisation de la Gendarmerie, la Milice occupe une position prépondérante. Signe de son influence, le protocole accorde à ses représentants, dans les cérémonies officielles, une place de choix. À Foix (Ariège), lors d’une manifestation patriotique, le chef départemental occupe le 9e rang sur 42 invités, devancé certes par le maire et le président du conseil départemental, mais précédant le commandant de Gendarmerie et l’inspecteur d’Académie.
Second point commun, l’une et l’autre sont investies d’une mission de maintien de l’ordre. Rien de plus normal pour la Gendarmerie, force de police traditionnelle. Elle participe depuis plusieurs siècles à la sécurité publique. Prérogative singulière pour la Milice qui s’inscrit dans un contexte idéologique.
La coexistence de deux forces aussi dissemblables, appelées à agir conjointement, s’annonce difficile tant est profond le fossé qui les sépare. Pour la Milice, au service d’un régime et d’un homme, la fin justifie les moyens. Pareille conception ouvre la voie à tous les abus. La Gendarmerie, au contraire, parfaitement intégrée dans la hiérarchie de l’État, respectueuse des lois et des populations avec lesquelles elle fait corps, s’interdit toute mission occulte ou politique. Militaires formés dans le moule de la discipline et de l’obéissance, rigoureusement sélectionnés, préparés à l’exercice de leurs fonctions, les gendarmes s’opposent aux miliciens, policiers amateurs, souvent indisciplinés, ignorant les lois et règlements, ardents collaborateurs, authentiques spadassins pour certains, n’ayant que mépris pour tous ceux qui n’appartiennent pas à leur camp.
Dans la phase d’organisation du mouvement qui s’échelonne de février à mai 1943, les questions de recrutement, de formation et d’équipement mobilisent les responsables. Une des priorités des fondateurs est d’armer les miliciens. Les autorités allemandes, à l’époque, y sont hostiles.
Début mai 1943, à la demande de plusieurs chefs départementaux, la direction générale de la Gendarmerie accepte que des affiches en faveur du mouvement soient placardées dans les brigades. Conscient du caractère insolite de ce concours, le général Fossier, sous-directeur, invite les commandants de légion à y donner une suite favorable certes, mais « uniquement à l’intérieur des bureaux. »
* *
*
Rarement par conviction, plutôt abusés par le rôle dévolu à la Milice par les hautes autorités de l’État, des militaires de la Gendarmerie se rapprochent d’elle à titre personnel. Tel est le cas du chef d’escadron B…, commandant la compagnie des Hautes-Pyrénées. Il entretient des relations étroites avec maître L…, chef départemental de la Milice et son adjoint F… Son devoir, estime-t-il, est de collaborer avec le mouvement. N’a-t-il pas été créé par Laval ? Autre raison : ses statuts lui assignent un rôle de premier plan dans le domaine de l’ordre public.
Dans cet esprit, au cours du premier semestre 1943, il accepte de faire aux miliciens de la région plusieurs conférences sur « le combat de rue ». La qualité de sa prestation, alliée au zèle qu’il déploie, conduisent ses amis à le recommander à de La Noüe du Vair, premier directeur de l’école des cadres. Celui-ci lui offre un emploi du professeur. L’officier accepte la proposition à condition d’être simplement détaché de son Arme. M. Chasserat, directeur de la Gendarmerie, pressenti par le secrétariat général de la Milice ne voit pas d’objections au départ de l’officier sous réserve qu’il démissionne. L’affaire en reste là.
Fort de l’appui des miliciens, le commandant de compagnie, à plusieurs reprises, tente d’imposer ses vues au préfet. Un contentieux naît entre les deux hommes. Il s’aggrave au point que le représentant du Gouvernement porte à la connaissance du commandement, l’attitude de l’officier « indicateur de la Milice à laquelle il adresse des rapports officieux et confidentiels ». Son accusation se fonde sur le relevé d’une interception téléphonique mise en place sur ses instructions. Dans ce document, des membres de la Milice, auteurs d’un attentat et qui craignent d’être identifiés, font allusion à l’aide que pourrait leur apporter le chef d’escadron pour se soustraire aux investigations. L’intéressé se défend énergiquement sans pouvoir cependant apporter la preuve de ses dénégations. Dès qu’elle est informée de la situation, la direction le mute à l’école préparatoire de Brive.
Durant le second semestre 1943, plusieurs commandants de légion saisissent le commandement supérieur pour signaler l’action entreprise par des chefs départementaux de la Milice en vue de connaître la position des militaires de l’Arme à l’égard de leur organisation.
Un commandant de section, dans la région d’inspection de Lyon, reçoit la visite d’un responsable local qui vient s’enquérir auprès de lui des possibilités de collaboration entre miliciens et gendarmes. Les commandants de brigades de l’arrondissement sont questionnés à leur tour par des miliciens. Ceux-ci leur demandent, en outre, d’établir des fiches individuelles de renseignements sur leurs subordonnés précisant en particulier leur filiation, la date de leur entrée en fonction, leur sympathie éventuelle pour la Milice, l’opportunité de les maintenir sur place ou de les déplacer. Le commandement ne donne aucune suite à ces requêtes.
Les miliciens, inlassablement, essayent d’arriver à leur fin. En janvier 1944, le général N…, inspecteur de la région de Marseille, rend compte à la direction que la Milice, d’après une information qui vient de lui parvenir, se prépare à ficher systématiquement tous les personnels. Le général Martin proteste auprès de Darnand. Il est hors de question, pour la Gendarmerie, de fournir les données nécessaires à l’élaboration d’un fichier.
* *
*
La Milice se considère insuffisamment équipée et convoite du matériel de la Gendarmerie. Elle saisit toutes les occasions, soit pour en demander le prêt, soit pour s’en emparer indûment.
En mai 1944, le docteur S…, chef départemental de la Milice du Gers, sollicite à 6 heures du matin, sans même l’avoir informé préalablement, le chef d’escadron C…, commandant la compagnie pour obtenir un fourgon-car avec un chauffeur en vue d’effectuer une opération de police, dans la région, placée sous le commandement de son adjoint. Ce dernier est en possession d’une lettre de service de l’intendant régional du Maintien de l’ordre. Elle lui donne tout pouvoir. L’officier ne croit pas devoir refuser cette prestation car il a reçu des instructions verbales de la hiérarchie ordonnant de satisfaire toutes les demandes du genre, à condition que le carburant soit fourni par la Milice.
Aux yeux de la population, de tels concours desservent l’image de la Gendarmerie tout en hypothéquant ses moyens.
La Milice ne recule devant aucun procédé pour arriver à ses fins. Tout est bon, depuis le vol jusqu’à l’attaque à main armée. Le 8 juin au matin, les gendarmes de la brigade motorisée de Grignols (Lot-et-Garonne) constatent la disparition d’une partie des véhicules du peloton de réserve motorisé n° 219 : 9 side-cars et 4 motocyclettes. Au moment des faits, l’unité est en déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Pour économiser le carburant, de plus en plus rare, les motos sont restées au dépôt. Les premiers éléments de l’enquête permettent de reconstituer les circonstances du vol. D’après un témoin, vers minuit le 8 juin, deux camions plate-forme se garent près du garage du peloton motorisé. Une trentaine d’individus débarquent et se rassemblent, d’une manière parfaitement disciplinée et militaire, sur deux rangs. Puis, ils chargent à bras les motocyclettes des gendarmes. L’opération d’enlèvement s’achève à deux heures du matin.
Pendant six jours, les gendarmes ratissent la région sans découvrir le moindre indice. À la mi-juin, ils recueillent un renseignement selon lequel le baron B… de L…, au château du même nom, camouflerait le matériel volé. Chef de la 4e cohorte de la Milice de la section de Bouglon, B…, après avoir tenté d’aiguiller les gendarmes vers une autre piste, celles des Chantiers de jeunesse, avoue connaître l’emplacement du matériel de la Gendarmerie. Il refuse de répondre à toute question sur son activité milicienne et ne se prononce pas davantage sur les conditions de restitution des motocyclettes. Il se retranche derrière l’autorité du chef départemental de la Milice, le pharmacien de P… Immédiatement entendu, celui-ci reconnaît avoir organisé « l’enlèvement ». Selon son intime conviction, c’est la justification qu’il tente d’accréditer, il s’agissait de véhicules sur le point d’être saisis, soit par une organisation « antigouvernementale », soit par les troupes d’opérations. Au cours de leurs investigations, les gendarmes interpellent sept individus à la solde de la Milice impliqués dans le vol. Tous refusent de répondre aux enquêteurs.
Aucune sanction ne frappe les auteurs de ce vol. Pourtant, l’autorité judiciaire a été informée du déroulement de l’affaire et saisie par une procédure.
Le commandant de légion dénonce, avec indignation, le comportement des miliciens. Il écrit à ce sujet :
« Comment des chefs miliciens peuvent-ils s’approprier des véhicules sur simple présomption qu’ils ont été camouflés ? Il est surprenant que des gestes aussi graves aient été accomplis avec une pareille légèreté. Il est pourtant facile de connaître les détenteurs de ce matériel roulant. Sans effort de l’esprit, on devait tout naturellement penser à la brigade locale. C’est le prestige de la Milice qui sort amoindri de cette vilaine opération. C’est aussi, hélas, celui du Gouvernement que l’on rend responsable du choix malheureux des hommes de la Milice […]. Pour calmer l’opinion et aussi pour des raisons de justice j’estime qu’une sanction sévère à la fois administrative et judiciaire doit frapper les inspirateurs et les auteurs de cette déplorable opération. »
L’audace de la Milice, pour parfaire ses équipements, n’a pas de limite. En juin 1944, après l’attaque par les maquisards de l’école préparatoire de Gendarmerie de Pamiers (Ariège), les autorités allemandes décident sa fermeture. Dès le lendemain, 14 juin, la Milice de l’Ariège occupe les installations. Le chef départemental se présente au commandant de l’école muni d’un ordre du préfet régional qui l’autorise à percevoir immédiatement du matériel d’habillement et des équipements divers pour ses unités de la Franc-garde. Le commandant de l’école ne se satisfait pas d’un ordre écrit et exige une confirmation verbale de l’autorité préfectorale. À la demande du chef de la Milice l’intendant régional du Maintien de l’ordre renouvelle téléphoniquement ses instructions. Au cours de la journée les miliciens enlèvent dans les magasins deux camions de matériel tout en interdisant aux gendarmes d’en dresser l’inventaire. Le 15 juin, l’opération se poursuit, sans aucune réquisition, malgré les protestations des gendarmes. Les intrus forcent les ateliers du service automobile. Pendant qu’ils s’emparent de l’outillage, un homme armé en interdit l’entrée. En fin de journée, la Milice s’est appropriée la presque totalité du parc automobile ainsi que cinq camions d’habillement, de matériel de campement et d’équipements divers. Pour clore leur expédition, les miliciens vident la soute à essence.
Devant l’ampleur du pillage, le chef d’escadron commandant l’école informe le préfet impuissant. L’officier obtient pleins pouvoirs pour liquider le reste du matériel au mieux de l’intérêt général. Il remet au sous-préfet de Pamiers un lot important de literie, de couvertures et de vaisselle susceptible de servir pour accueillir des réfugiés.
Le 26 juin, la Milice prend possession de la caserne où le chef régional a décidé d’installer une école de cadres. Déjà la presse évoque la création de ce centre de formation et fait de la propagande pour le recrutement de nouveaux miliciens. Pas plus que le préfet, la direction de la Gendarmerie ne réussit à obtenir la restitution du matériel dérobé.
On ne compte pas, dans les derniers mois de l’Occupation, les vols commis par la Milice au détriment de la Gendarmerie. Début juin 1944, à Aups (Var), elle dérobe le véhicule de la brigade. Le 20, dans le Vaucluse, en l’absence des gendarmes regroupés dans les chefs-lieux de sections, elle pille les brigades de Lauris et de Cadenet. À Nevers, le 24 août, en fuite vers l’Allemagne avec leurs familles, des miliciens s’emparent, sous la menace de leurs armes, des véhicules de la Gendarmerie regroupés à la compagnie.
Aux vols s’ajoutent des exactions comme l’incendie de la caserne de Plouguenast le 27 juin.
* *
*
Plus que les simples prestations matérielles, le concours missionnel que la Gendarmerie apporte à la Milice est lourd de conséquences. Il entraîne des gendarmes dans des actions contre la Résistance. À la demande des miliciens, des préfets requièrent des détachements de Gendarmerie pour participer à des opérations conjointes.
Dans la nuit du 2 au 3 juin 1944, le préfet du Gers requiert le commandant de compagnie pour appuyer une intervention de la Milice contre un groupe de résistants signalé dans le secteur d’Arrouède. Pour soutenir la trentaine chargée de l’effort principal, la Gendarmerie fournit 3 pelotons. Les maquisards, alertés, accueillent les miliciens par des coups de feu. Un des assaillants est mortellement blessé lors de l’attaque de l’objectif. Le rapport établi par le chef de trentaine, à l’issue de l’affaire, indique que « les forces de Gendarmerie, après la chute de la ferme, ont pris à leur compte la poursuite du combat et effectué un ratissage difficile, par suite du terrain, sans pouvoir renouer le contact avec les réfractaires. »
Dans la Vienne, à Montmorillon, en vue d’exploiter un renseignement émanant de la Milice, le préfet réquisitionne un peloton de Gendarmerie. Ce dernier reçoit pour mission de neutraliser une bande repérée aux environs de Lathus sur le bord de la rivière « La Gartempe ». Le 28 mars 1944, après une marche d’approche nocturne, 27 gendarmes et 5 miliciens investissent les lieux. Seules subsistent des traces de passage dans le campement désert.
Quelques rares chefs optent pour la répression et la collaboration avec la Milice. Ils prennent des initiatives qui se retournent contre les gendarmes comme cela s’est produit en Dordogne au début de l’année 1944.
Le 6 février 1944, le directeur départemental de la police informe le capitaine R…, commandant la section de Sarlat, de la présence probable d’un groupe de 8 réfractaires dans un hameau à 3 km d’Auriac-du-Périgord. En accord avec le capitaine P…, commandant provisoirement la compagnie, l’officier décide d’effectuer une opération de police. Le préfet Popineau donne son assentiment.
Le détachement de Gendarmerie se compose des deux officiers, de 15 gendarmes de la section de Périgueux plus 14 de celle de Sarlat et de 5 miliciens à l’origine du renseignement. Les brigades chargées de fournir les effectifs reçoivent l’ordre de regroupement initial, dans la soirée du 7 février, par message téléphoné chiffré. Aucune indication n’est donnée sur la mission connue seulement des officiers. L’action est prévue au lever du jour. Le commandant de compagnie fixe le rassemblement à 5 h 30, au carrefour d’Auriac-en-Périgord.
L’élément en provenance de Périgueux où se trouvent les miliciens arrive au lieu indiqué en avance d’une dizaine de minutes sur l’horaire prévu. Alors que les véhicules ralentissent pour s’arrêter, un coup de feu retentit. Les gendarmes prennent ce bruit pour l’éclatement d’un pneu. À peine ont-ils débarqué que la fusillade crépite. C’est l’embuscade. Les gendarmes se dispersent et s’abritent dans le remblai de la route avant de riposter avec leurs mousquetons. Trois hommes tombent : le gendarme B…, tué sur le coup, et deux miliciens grièvement blessés. Au bruit des armes succède le silence. Les maquisards s’évanouissent dans la nuit pour regagner leur base. L’opération projetée tourne court. À 6 heures, gendarmes et miliciens repartent en direction de Thénon où un médecin donne les premiers soins aux blessés dirigés ensuite sur l’hôpital de Périgueux.
Quant au gendarme B…, de la brigade de Saint-Pierre-de-Chignac, malheureuse victime de l’expédition, il n’y était pas venu de bon gré selon les témoignages, ses camarades le transportent auprès des siens. Le jour de ses obsèques, le commandant de compagnie épingle sur son cercueil la médaille militaire. Une citation laconique accompagne cette décoration posthume :
« Gendarme brave et courageux tout à son devoir. Le 8 février 1944, au cours d’un engagement dans une zone troublée, est tombé à son poste de combat. »
Quelques semaines plus tard, le 28 mars, le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur lui décerne la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement.
Analysant son échec, le commandant de l’opération a l’intime conviction que les « terroristes » ont eu connaissance de l’intervention projetée. Les témoignages de quelques protagonistes du drame, après la guerre, confirment cette impression.
Le 7 février, les brigades de la section de Sarlat, dont celle de Montignac, reçoivent l’ordre de se rendre, le lendemain à 5 h 30, entre le carrefour du Chambon et Auriac-du-Périgord en vue de se joindre à une colonne en provenance de Périgueux pour participer à une opération de police dans la région. À Montignac, le gendarme Manon prévient Pierre Morlet, un des pionniers de la Résistance dans le département. Celui-ci annonce la nouvelle à Lescure, chef de l’école des cadres F.T.P. installée dans le canton. Après un rapide conseil de guerre, il décide d’attaquer le premier. Objectif visé : l’élément de Périgueux composé, pense-t-il, d’Allemands et de miliciens. À son tour, Lescure transmet l’information aux gendarmes auxquels il conseille de se présenter avec du retard au rendez-vous.
Le convoi de Périgueux, un car et deux voitures arrive le premier sur les lieux. Le piège, destiné en fait aux Allemands étrangers à l’opération, se ferme sur lui. Un coup de feu prématuré tiré par un F.T.P. inexpérimenté déclenche un tir nourri de la trentaine d’hommes embusqués près de la route, dans une position en surplomb. Les trois véhicules s’arrêtent. Les phares s’éteignent. Les gendarmes se mettent à l’abri. Alors que les F.T.P. décrochent, apparaissent au loin les gendarmes des brigades de la Bachellerie et de Montignac qui ignorent tout du drame qui vient de se jouer.
Des militaires de l’Arme refusent de s’associer à la Milice dans les opérations offensives contre les maquisards. Ce choix ne va pas sans risques comme le montre la position prise par le commandant de compagnie de Draguignan.
D’abord, les circonstances. Le 6 juin 1944, le maquis de la région d’Aups monte une embuscade contre des véhicules allemands. Elle coûte à l’occupant 3 tués et 3 blessés. Une forte colonne revient sur place le lendemain. Harcelée à plusieurs reprises, elle n’insiste pas et se replie.
Le 8 juin, la Feldkommandantur 800 de Draguignan charge les autorités françaises d’assainir les environs de la petite cité du Haut-Var. Le chef régional de la Milice, Durandy, confie la mission à la centaine stationnée au chef-lieu du Var, placée sous les ordres de Verrion. Ce dernier n’est pas un foudre de guerre. Alors il désigne le chef d’escadron Favre non seulement pour préparer le plan d’attaque, mais encore pour commander l’action.
Sur l’injonction de Durandy et du préfet, l’officier se résigne à établir l’ordre d’opération. Selon les directives reçues, il en adresse un exemplaire à Durandy. Secrètement, il en fait parvenir un double au chef du maquis, le commandant Vaillier. Pressé par Verrion, il temporise et lui annonce qu’il doit en référer à ses chefs. À dessein, ce n’est que le 11 juin, veille de l’attaque, qu’il rend compte, par la voie hiérarchique, au général commandant la 6e région d’inspection à Marseille :
« J’ai l’honneur de vous rendre compte, écrit-il, qu’une opération de répression est décidée pour lundi matin sur le village d’Aups. J’estime ne pouvoir commander effectivement l’opération, la Milice n’étant pas sous mes ordres… »
Le 12 juin, au matin, le chef d’escadron Favre ne se présente pas au départ des miliciens. Verrion, contraint, prend le commandement du dispositif renforcé par des SS.
Le 15 juin, le commandement réagit au refus du chef d’escadron Favre. Le général N… le désapprouve et exige de lui des explications. Pour se justifier, l’officier déclare que l’instruction n° 171 STMO du 25 avril 1944 ne prévoit pas expressément que la Milice soit placée sous les ordres des officiers désignés à l’échelon départemental pour commander les forces en uniforme. Malicieusement, il conclut son argumentation en ces termes :
« Pour éviter toute divergence d’interprétation, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me fixer sur le point de savoir si la Milice doit être considérée comme une force en uniforme placée effectivement sous mon commandement pour des opérations exécutées par elle seule, sans le concours de la Gendarmerie ou de la Police… »
La réponse de la hiérarchie ne tarde pas. Le général lui inflige un blâme et menace de le faire traduire devant un tribunal du Maintien de l’ordre.
Les signes annonciateurs de la fin du régime tempèrent les rigueurs du haut-commandement. L’affaire en reste là.
À l’acharnement que manifeste la Milice dans l’action engagée par Darnand contre la Résistance s’oppose la tiédeur, sinon la passivité, de beaucoup de gendarmes. Aussi dénonce-t-elle leur attitude équivoque. Presque toujours, elle préfère à la persuasion des méthodes plus radicales pour inciter les gendarmes à coopérer.
La suspicion qu’elle nourrit à leur égard est telle qu’avant d’entreprendre des opérations répressives, pour éviter des fuites, elle n’hésite pas à placer sous haute surveillance les unités de Gendarmerie.
Dans la Drôme, le 16 avril 1944, des miliciens neutralisent une dizaine de brigades (Tain-l’Hermitage, Tournus, Saint-Nazaire-en-Royans, Romans, La Chapelle-en-Vercors, etc.) avant d’effectuer arrestations et perquisitions chez des suspects. Ils cernent les casernes, occupent les locaux de service, gardent les gendarmes à vue, les font interroger par des inspecteurs de police, contrôlent les communications téléphoniques.
« Pour les chefs miliciens, écrit le commandant de compagnie de la Drôme, la neutralisation des brigades de Gendarmerie était une mesure de principe prise systématiquement au début de toute opération de police afin d’assurer le secret des actions… »
Le milicien de Barnonville note, à propos des gendarmes, dans son rapport du 19 avril consécutif aux opérations de son groupement dans la Drôme :
« Est-il besoin d’ajouter que je n’ai aucune intention de nuire à l’autorité, déjà si compromise, de ces représentants de l’ordre, ni de me venger d’une façon quelconque des « pandores ». Mais, j’ai seulement le souci de mener à bien la tâche qui m’est confiée… »
Il insiste sur le comportement douteux des gendarmes. La rumeur publique n’accuse-t-elle pas trois d’entre eux de complicité dans l’assassinat, le 10 janvier 1944, de l’adjudant A…, de la brigade de Saint-Jean-en-Royans (Drôme), abattu à coup de pistolet parce qu’il entendait appliquer la rigueur de la loi.
Le jugement qu’il porte sur les gendarmes est tout à leur honneur. Pour les contrecarrer, les miliciens, comme leurs maîtres les Allemands experts en la matière, ne reculent devant aucun procédé : assassinats, menaces, arrestations, entraves dans l’exécution du service, représailles contre les familles. Sans doute, en instaurant un climat de terreur, croient-ils obtenir l’adhésion des gendarmes.
Lors de leur expédition sur Aups, le 12 juin 1944, des coups de feu retardent leur progression. Pour éviter des pertes, ils s’accrochent au terrain. Avant de revenir à Draguignan, ils montent un guet-apens dans lequel tombent plusieurs maquisards au nombre desquels figurent deux gendarmes. Duchatel, âgé de 28 ans, pris les armes à la main est abattu sur-le-champ. Son camarade, Bouet, embarqué dans un camion, pour le moins promis à un tribunal du Maintien de l’ordre, réussit à leur fausser compagnie en sautant dans un ravin boisé.
Les miliciens épient les moindres faits et gestes des gendarmes pour pouvoir sévir contre eux s’ils n’agissent pas selon leurs souhaits. Le chef départemental de la Milice de Belfort propose de sanctionner le capitaine Brepson, commandant la Gendarmerie du territoire, parce qu’il n’a pas assisté au service religieux organisé par les autorités à la suite de la mort de Philippe Henriot, abattu par la Résistance. Il rappelle, dans son rapport, avoir déjà signalé le comportement de cet officier qui, antérieurement, a assisté en tenue à une messe célébrée à la mémoire d’un « terroriste ».
Dans le Lot, en avril 1944, les G.M.R., lors d’un accrochage en gare de Gourdon, tuent deux maquisards. Le chef départemental de la Milice rend compte de leurs obsèques au chef régional, quelques jours plus tard. Il y note l’absence de la Gendarmerie :
« Naturellement, souligne-t-il, à l’enterrement, le tout Gourdon y était sauf la Gendarmerie, les gardes mobiles, la marine, les services de la mairie et de la sous-préfecture, à l’exclusion du concierge… »
Dans un tel contexte, on comprend les précautions que prennent les gendarmes et autres fonctionnaires pour ne pas afficher leurs véritables sentiments.
La Milice s’en remet aussi aux Allemands pour qu’ils punissent les gendarmes complices de la Résistance. Sur dénonciation d’un milicien, le 6 février 1944, les Allemands arrêtent le M.D.L.-chef Pfirsch et les gendarmes Limosin, Roussey et Traffey de la brigade de Brenod (Ain) qui entretenaient ouvertement des relations avec les hommes de Romans-Petit, chef des maquis de l’Ain. Après un passage au camp de transit de Compiègne, les Allemands les dirigent sur Mathausen. Le gendarme Roussey y décède le 21 avril 1945 et son camarade Traffey le 19 octobre 1944.
Dans le Lot, début juin 1944, les miliciens de Gourdon exigent du lieutenant Dauquier, commandant la section, le prêt d’un camion pour déménager des archives et des bagages appartenant à leurs familles. L’officier refuse de céder à leur injonction. À la demande des miliciens, les Allemands emprisonnent l’officier à la prison Saint-Michel à Toulouse. Le préfet tente en vain d’obtenir sa libération. C’est ensuite le départ, via le camp de Compiègne, pour la déportation d’où il ne reviendra pas.
D’une façon générale, les miliciens se chargent eux-mêmes de mettre les gendarmes au pas. Le 17 février 1944, les miliciens du chef Lemoine menacent, désarment et gardent à vue des gendarmes déplacés en Haute-Savoie qui refusent dans la région de Thonon de les accompagner dans leurs opérations de pillage. L’intendant du Maintien de l’ordre Lelong intervient auprès de Darnand, de passage dans le département ce jour-là, pour faire cesser cet abus de pouvoir.
À Brantôme (Dordogne), le 13 mai 1944, des miliciens prennent en otage six personnes de la localité qu’ils suspectent d’appartenir à la Résistance. Parmi elles, l’adjudant Nanot, précédemment chef de la brigade, mis d’office à la retraite d’ancienneté, au début du mois, pour ne pas s’être opposé à l’attaque de sa caserne, le 25 mars 1944, à l’issue de laquelle des maquisards s’étaient emparés de titres d’alimentation. Après interrogatoire, ils l’acheminent sur le camp de Saint-Paul-d’Eyjeaux. L’adjudant Nanot ne recouvre la liberté que le 6 juillet 1944.
À Oraison (Basses-Alpes), le 16 juillet 1944, des miliciens, ulcérés de ne pas avoir obtenu le moindre renseignement sur une réunion de chefs de la Résistance qui devait se tenir dans les environs de la localité, se saisissent de l’adjudant Baffreau, commandant la brigade, et de cinq civils. Détenu à la prison des Beaumettes à Marseille, ce gradé n’est libéré qu’au départ des Allemands courant août 1944. Les hommes de Darnand martyrisent les autres otages retrouvés dans un charnier à Signes (Var).
À Annot (Basses-Alpes), les miliciens livrent aux Allemands, qui ne les maintiennent pas en détention, deux gendarmes et l’adjudant commandant de brigade jugés trop tièdes dans la répression.
Comme partout ailleurs, en Bretagne, les rapports de la Milice avec la Gendarmerie sont particulièrement mauvais. Le chef milicien Di Constanzo, qui n’obtient d’elle aucune information, accuse les gendarmes « de lâcheté, d’imbécillité et de trahison ». Le 27 juillet, 200 de ses hommes prennent d’assaut la caserne de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Fin juin 1944, la Milice interpelle deux gradés de la brigade de Châteauroux auxquels elle reproche leur passivité lors de l’attaque du maquis contre la caserne de la Garde. Le chef de la Milice, Costes, en vertu de ses pouvoirs exceptionnels, se prépare à les traduire devant une Cour martiale. Le capitaine Barbe, commandant la section, prend leur défense et parvient à les sortir de ce mauvais pas.
Dans le Gers, le 30 juin, la Milice se saisit des gendarmes Sartoni et Serres de la brigade de Riscle. Après plusieurs démarches du commandant de compagnie, auprès du chef départemental de la Milice, ils sont remis en liberté, le 5 juillet, mais sans leurs armes. Les miliciens exigent que le commandant de brigade, en personne, en demande la restitution.
Début juillet 1944, le chef de la Milice de l’Ariège reçoit une lettre anonyme mettant en cause le gendarme Gillet de la brigade motorisée de Foix. L’auteur du courrier reproche à ce sous-officier d’avoir tenu des propos désobligeants contre les miliciens et d’avoir pactisé avec des maquisards, quelques semaines auparavant, alors qu’il était déplacé en Dordogne avec un peloton chargé de la garde du camp de Mauzac.
En pleine nuit, le 8 juillet, trois individus arrivent en voiture, tous feux éteints, devant le domicile de ce gendarme logé hors de la caserne. Ils pénètrent chez lui et, sans explications, sous la contrainte, le conduisent dans les locaux de la Milice. Jusqu’au 11 juillet, il subit plusieurs interrogatoires. Mme Gillet alerte les chefs de son mari qui se rapprochent des autorités allemandes. Ni la police de sécurité, ni la Feldgendarmerie ne sont en mesure de fournir le moindre renseignement à son sujet. En dernier ressort, le commandement s’adresse au chef départemental de la Milice. Imbu de son autorité, ce dernier affirme que ses services, conformément à ses instructions, ont interpellé le gendarme Gillet. Si les investigations en cours ne permettent pas de l’incriminer, il pourra continuer son service. Les miliciens, finalement, abandonnent leur proie. Il ne doit son salut qu’au silence de ses chefs qui se portent garant de son loyalisme. Or le commandant de compagnie n’est pas sans savoir qu’avec ses camarades déplacés à Mauzac ce militaire s’est rallié, le 7 juin, aux maquisards qui ont attaqué le camp. Comme le signale dans son rapport le capitaine B…, commandant le détachement, il figure au nombre des gendarmes passés à la dissidence. De plus, avant son retour à Foix, début juillet, il a participé en Dordogne à plusieurs engagements contre les troupes allemandes au cours desquels trois de ses camarades du peloton 175, les gendarmes Labeur, Miconnet et Labasque ont trouvé la mort.
Les familles des gendarmes ne sont pas à l’abri du fanatisme des miliciens comme le montre l’incident qui se produit à Castelnau-de-Montmiral (Tarn), quelques jours après le débarquement. Le dimanche 11 juin, le jeune Jean Poussou, âgé de 17 ans, est sur le point d’entrer dans l’église pour assister à l’office dominical lorsque surgissent des miliciens transportés en car. Ils s’emparent de lui et le font monter dans leur véhicule. Alerté par la population, son père, qui commande la brigade, se rend immédiatement sur place accompagné de trois gendarmes. Le chef du détachement de la Milice lui signifie qu’il emmène son fils à Castres pour l’interroger. Le 8 juin, il aurait guidé une bande du maquis qui a désarmé la brigade. Le M.D.L.-chef Poussou proteste contre l’enlèvement de son fils et demande que son interrogatoire se déroule, sur place, en présence du commandant de section qu’il va informer des faits. Le chef milicien accède à sa demande. Dans l’attente de l’arrivée de l’officier, il termine l’opération d’évacuation des familles miliciennes domiciliées dans la commune. Dès qu’ils apprennent la présence à Castelnau du commandant de section de Gaillac, les miliciens quittent précipitamment l’agglomération après avoir libéré leur prisonnier.
Le 12 juin, dans la matinée, les mêmes miliciens reviennent à Castelnau. Pendant dix minutes, mitraillette au poing, ils cernent la caserne et invectivent les gendarmes. Puis ils se retirent. Le chef de dizaine des Francs-gardes, responsable de cette action, en rend compte à la fédération régionale de la Milice :
« Me trouvant, le 11 juin 1944, en mission à Castelnau avec une dizaine de Francs-gardes, j’ai appris que lors des incidents ayant succédé au désarmement des gendarmes de Montmiral par les maquisards, le nommé Poussou, âgé de 17 ans et fils du gendarme brigadier de Gendarmerie, avait servi d’indicateur et désigné aux maquisards la perception, le bureau de poste, la maison du maire et les habitations des miliciens de l’endroit. J’ai fait aussitôt arrêter le jeune homme avec l’intention de le conduire à Castres pour le faire interroger. »
L’intendant régional du Maintien de l’ordre demande une enquête sur les faits imputés au jeune Poussou. Elle est confiée au commandant de compagnie qui le met hors de cause. Finalement, les gendarmes se tirent à bon compte de cet incident.
Au moment où s’effondre le régime de Vichy, l’aveuglement et la haine conduisent des miliciens fanatiques à commettre des actes inqualifiables contre d’innocentes victimes. Dans la matinée du 7 juillet 1944, un détachement des troupes d’opérations accompagné de miliciens investit Saint-Sulpice-Laurière (Haute-Vienne). Un groupe occupe la Gendarmerie. Le gendarme Menaut assure seul la garde de la caserne. Une partie de ses camarades a rejoint le maquis, l’autre a obéi à l’ordre de regroupement des unités dans les chefs-lieux de compagnie. Les miliciens menacent de l’arrêter sous prétexte qu’il a des relations avec la Résistance. À la suite de l’intervention d’un officier allemand, ils renoncent à mettre leur projet à exécution. En se retirant de l’agglomération, ils emmènent plusieurs habitants en otages. Cependant, dans la soirée du 7, les miliciens reviennent à la Gendarmerie. Manu militari, ils embarquent dans leur véhicule le gendarme Menaut ainsi que les épouses des gendarmes Parisot et Martin, toutes deux mères de trois enfants en bas âge.
Le 8 juillet, les miliciens opèrent à Magnac-Laval. Nouvelles prises d’otages. À 17 heures, le convoi quitte le village et emprunte la nationale n° 151 en direction de Limoges. Il stoppe brusquement au lieu-dit « La croix du curé ». Sur ordre de Jean Chardonneau, chef de trentaine, les miliciens poussent hors des camions 19 otages sur 24 et les dirigent vers un champ en bordure de la route. Le massacre commence. Parmi les victimes, Mmes Parisot et Martin. Basse vengeance des miliciens qui font grief à leurs maris d’avoir rallié le maquis. Miraculeusement, le gendarme Menaut n’est pas exécuté. Les miliciens l’internent à Limoges au camp de séjour surveillé du petit séminaire de la ville. Il y restera jusqu’à la Libération.
De Vaugelas traduit Chardonneau, responsable de la tuerie, devant un tribunal du Maintien de l’ordre. Devant l’émotion légitime provoquée par ce crime odieux, les chefs miliciens se gardent de l’absoudre car le moment se rapproche où ils vont devoir rendre des comptes. Chardonneau, condamné à mort, est fusillé le 22 juillet, moins de 20 jours après son forfait.
Les miliciens, souvent arrogants, interfèrent dans les missions judiciaires qui incombent aux gendarmes. Leur comportement engendre conflits et tensions. En octobre 1943, Lécussan, chef régional de la Milice à Lyon, profère des menaces contre les gendarmes parce que, au cours d’une perquisition chez des membres de la Milice, au camp de Chambarand, ils ont découvert des armes et saisi l’autorité judiciaire. Au chef Trenes, de Grenoble, qui lui signale les faits, il répond :
« Dites au commandant de Gendarmerie que je l’emmerde et que je le ferai sauter. Quant au brigadier, on lui fera la peau. Depuis le temps, il faut bien qu’il y en ait un qui y passe. Ils y vont un peu fort de prendre les armes. Ce sont au moins de ces gendarmes gaullistes qui aident les maquis tant qu’ils peuvent comme le font neuf sur dix des gendarmes… »
Dans la Haute-Garonne, courant mai 1944, deux gendarmes de la brigade de Montgiscard apprennent, au cours d’un service, que 4 inconnus ont enlevé, en plein jour, l’arme au poing, un israélite en résidence dans leur circonscription. Quelques jours plus tard, ils repèrent le véhicule des auteurs présumés. Leurs occupants, interpellés, déclarent appartenir à la Milice. Ils sont conduits dans les bureaux de la brigade où celui qui paraît être le chef présente une carte de Franc-garde. Questionné sur la disparition de l’israélite, il affirme qu’il ne peut rien dire. La Gendarmerie recevra ultérieurement un rapport du moins le prétend-il. Pour impressionner ses interlocuteurs, il ajoute qu’il travaille en étroite collaboration avec l’intendant de Police. Puis, c’est une invitation aux gendarmes de signaler à la Milice les gens douteux. Les autorités, informées des faits, donnent pour instruction aux gendarmes de ne rien entreprendre.
Partout, la Milice, impunément, piétine la légalité. Ainsi, le 28 mai 1944, dans le Cher, deux individus armés de mitraillettes se font remettre par la force, dans un débit de tabac, une somme d’argent importante, du tabac et des cigarettes. Les gendarmes chargés de l’enquête portent leurs soupçons sur deux miliciens de la Franc-garde de Saint- Amand-Montrond. Le commandant de section, en possession d’éléments probants, informe le chef départemental de la Milice. La position des miliciens ne varie pas. Il n’est pas question que les gendarmes s’immiscent dans leurs affaires. La procédure, établie malgré tout, n’est suivie d’aucun effet.
À la suite de l’enlèvement, par des résistants, d’un collaborateur à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), la Milice arrête illégalement, fin mai 1944, huit personnes de la localité. La Gendarmerie alertée réussit à identifier l’un des auteurs. Dès son interpellation, il se déclare chef de groupe d’action de la Paix sociale. Il a agi en vertu d’un ordre de mission de la Milice avec une douzaine d’individus armés appartenant à son mouvement. Il refuse de remettre ses otages aux gendarmes car sa mission est de les conduire au siège de la police allemande à Agen. Son intention, il l’assure, est de se mettre en relation, dès le lendemain, avec le procureur de l’État français.
Les gendarmes impuissants s’inclinent, après avoir informé le sous-préfet de Nérac et l’autorité judiciaire, tous deux dans l’incapacité de se faire entendre.
Après le débarquement, la nomination des miliciens à la tête des forces du Maintien de l’ordre, dans plusieurs départements, contribue à la détérioration de la situation.
Dans les Basses-Pyrénées, le délégué départemental de la Milice, ancien militaire, désigné comme commandant des forces du Maintien de l’ordre, en remplacement du chef d’escadron commandant la compagnie, inspecte, fin juillet 1944, les gendarmes en résidence à Pau. Il les exhorte à prendre part aux opérations contre la Résistance. Sa demande ne reçoit aucun écho. Autre prétention, il exige que tous les mousquetons des gendarmes « bien graissés, avec le nom de chacun collé sur la crosse, soient entreposés au siège de la Milice. » Le commandant de compagnie refuse. Le milicien a recours à la séduction. À l’issue de sa visite à la Gendarmerie, il lui adresse un courrier ainsi libellé :
« Cher camarade,
Je tiens à vous dire sans retard que j’ai été particulièrement heureux de faire la connaissance de vos gendarmes. J’ai lu dans leur regard leur désir et je vais m’employer à leur donner satisfaction… Voulez-vous, sans attendre la réponse du préfet de région, faire apporter les mousquetons de vos gendarmes à la Milice… »
Moins d’un mois plus tard, le 26 août, les maquisards occupent Pau. L’éphémère commandant des forces du Maintien de l’ordre des Basses-Pyrénées n’aura ni le temps, ni le concours escompté des gendarmes pour imposer localement l’ordre milicien en sursis depuis le débarquement.
Depuis janvier 1943 où la Milice voit le jour, sous les auspices du pouvoir et de l’occupant, on ne décèle entre elle et la Gendarmerie aucune affinité. Les tentatives des hommes de Darnand pour gagner les gendarmes à leur cause échouent, même s’ils réussissent, ici et là, à entraîner dans leur sillage quelques égarés. Tous en payeront le prix. Les rares gendarmes condamnés à mort par une Cour de Justice à la Libération, sont en général des suppôts de la Milice. C’est le cas du gendarme T…, de la brigade de Béziers (Hérault). Fervent collaborateur, avec l’aide de sa femme, il fournit des renseignements aux miliciens et aux Allemands. À plusieurs reprises, heureusement, ses collègues préviennent les personnes dénoncées et limitent ainsi le préjudice qu’il pouvait leur causer.
En définitive les méthodes employées par la Milice, contre les gendarmes, avivent les antagonismes et suscitent à son égard une réprobation quasi générale, même si elle ne s’exprime pas ouvertement.
Une administration démocratique de la Justice repose, dans un État de droit, sur une stricte séparation des fonctions policières et juridictionnelles. Dès lors qu’un pouvoir a recours aux membres des forces de l’ordre pour juger des crimes ou délits et les astreint à mettre à exécution des sentences, on ne peut plus parler de Justice, mais plutôt de règlement de compte. L’État français a dévoyé ses policiers et ses gendarmes en leur confiant de telles missions.
Ainsi, entre 1941 et 1944, des militaires de la Gendarmerie siègent dans des tribunaux d’exception et constituent des pelotons d’exécution. Le rôle qu’on leur assigne passe à l’époque pratiquement inaperçu, aussi ne suscite-t-il aucune réaction.
V – LE DÉCHIREMENT
CHAPITRE 13 – DES PRÉTOIRES AUX EXÉCUTIONS CAPITALES
Pour les victimes, on imagine la violence du choc, lorsque leur destin tragique s’achève devant un peloton d’exécution composé de gendarmes ou encore lorsqu’elles découvrent, dans les prétoires, certains juges revêtus de l’uniforme de l’armée française.
Cet aspect de l’action de la force publique, très peu analysé par les historiens, a conduit néanmoins Henri Noguères à émettre les plus vives critiques à l’égard des gendarmes qui ont obéi aux ordres. À propos des exécutions capitales, il écrit :
« Certes, on l’a dit, et il ne faut pas craindre de le répéter, il y a eu des gendarmes pour constituer des pelotons d’exécution après les verdicts des « cours martiales ». Pour ceux-là, tout comme un secrétaire général de préfecture, l’obéissance aux ordres reçus, l’intégration dans un système hiérarchisé ne sauraient tout excuser… Ces gendarmes-là, nous sommes quelques-uns à penser qu’ils n’ont pas reçu – quoi qu’aient pu en dire les « historiens de l’épuration » – le châtiment qu’ils méritaient, mais ce n’était, au sein de la Gendarmerie, qu’une minorité. »
Laissant le soin à chacun d’apprécier les faits, il paraît plus opportun de déterminer dans quelles conditions les gendarmes ont été associés par Vichy à l’œuvre de justice et comment ils se sont comportés.
* *
*
Le 23 août 1941, le Journal officiel publie la loi créant les Sections spéciales hypocritement antidatée du 14 pour ne pas paraître liée aux circonstances qui la motivent. Le Gouvernement français va pouvoir satisfaire le diktat des autorités militaires allemandes à la suite de l’attentat perpétré le 21, à la station de métro Barbès-Rochechouart, contre l’auxiliaire de l’administration de la marine allemande Alfons Moser. En représailles à cette action, elles exigent l’exécution de six otages avant le 28. Le 27 août, la Section spéciale formée par la cour d’appel de Paris juge six communistes désignés à cet effet. Trois sont condamnés à mort et guillotinés dans la matinée du 28.
L’idée de constituer des Sections spéciales revient à Darlan alors vice-président du Conseil. Le 25 juin 1941, l’amiral charge le secrétaire général à la police Chauvin d’étudier d’urgence, en vue de son application immédiate, une série de mesures visant à renforcer la répression contre l’activité communiste. Le 20 août, Pierre Pucheu, nouveau ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, remet pour approbation, au général Stulpnagel, le projet élaboré.
La loi institue en zone libre, auprès de chaque tribunal militaire permanent, dans les 12e, 13e, 14e, 15e, 1er et 17e divisions, une ou plusieurs Sections spéciales composées de quatre officiers et d’un sous-officier. Ces juridictions jugent les auteurs de toutes infractions pénales, quelles qu’elles soient, commises dans une intention d’activité communiste ou anarchiste.
Les généraux commandant les circonscriptions territoriales auxquels sont dévolus les pouvoirs judiciaires dressent les listes des officiers désignés comme juges titulaires. Au nombre de ces juges figurent des officiers de Gendarmerie. Les intéressés exercent leurs fonctions durant des périodes de six mois.
En décembre 1942, après l’invasion de la zone libre, seuls subsistent trois tribunaux militaires permanents (Toulouse, Clermont-Ferrand et Lyon) qui relèvent du commissariat général à la Guerre.
Les charges de plus en plus lourdes imposées aux officiers dans leurs commandements conduisent la direction, dès la fin de l’année 1941, à demander au secrétaire d’État à la Guerre de les dispenser d’une mission aussi absorbante que celle de juge. Leur participation dans les Sections spéciales des tribunaux militaires sera, en fait, très limitée.
En zone nord, dépourvue de tribunaux militaires, la loi crée une Section spéciale au sein de chaque cour d’appel composée de cinq magistrats désignés par ordonnance du premier président.
Ces juridictions, qu’elles soient civiles ou militaires, jugent dans les délais les plus brefs. En cas de flagrant délit, l’instruction préalable est supprimée. Les peines prononcées ne peuvent être inférieures au minimum prévu par la loi qualifiant l’infraction. Si l’auteur de l’infraction est un militaire ou un agent de l’État, la peine prononcée doit correspondre au maximum. Les jugements, exécutoires immédiatement, ne sont susceptibles d’aucun recours ou pourvoi en cassation. À partir du 16 mars 1943, les prévenus n’ont même plus le libre choix de leurs avocats désignés d’office.
Le dispositif mis en place qui, pensait-on, devait renforcer la répression, s’avère d’une efficacité toute relative. Deux raisons inclinent les juges à la prudence. L’idée qu’aucun recours n’est possible en paralyse un grand nombre qui supporte mal d’endosser la responsabilité des jugements sans qu’il soit possible de la rejeter ou de la partager avec une autre juridiction (appel, cassation). Plus dissuasives encore sont les menaces qu’ils reçoivent, parfois mises à exécution. Elles les confortent dans une attitude frileuse.
Le 1er mai 1943, le lieutenant-colonel commandant la XVe légion, à Marseille, signale à la direction générale que les magistrats, près la cour d’appel de Nîmes « qui ont récemment condamné à la peine capitale des auteurs d’attentats ont reçu, ainsi que le capitaine de Gendarmerie, des menaces de mort par écrit. » Cet avertissement est consécutif à l’exécution, le 22 avril 1943, de Jean Robert et de Vincent Faïta, militants F.T.P. condamnés par cette juridiction et guillotinés.
Le 5 juin 1943, la loi n° 318 étend la compétence des Sections spéciales « à toutes infractions pénales si elles sont commises pour favoriser le terrorisme, le communisme, l’anarchie ou la subversion sociale et nationale ou pour provoquer ou soulever un état de rébellion contre l’ordre social légalement établi. »
La condamnation, trop indulgente au gré du pouvoir, prononcée par la Section spéciale près la cour d’appel de Riom, contre les auteurs de l’attaque perpétrée contre la Gendarmerie d’Arlanc (Puy-de-Dôme), sert de prétexte à un nouvel aménagement de la loi.
L’affaire débute le 9 juin 1943. Ce jour-là, une bande armée investit par surprise la brigade d’Arlanc. Un gendarme est tué. Deux autres sont grièvement blessés.
Le lieutenant-colonel R…, commandant la légion d’Auvergne, évoque l’événement dans une synthèse en date du 1er juillet 1943. Il insiste sur « l’attaque, en plein jour, le 9 juin 1943 de la caserne d’Arlanc par une bande de réfractaires du S.T.O. menée par des repris de justice et des communistes armés de mitraillettes et de revolvers… »
Trente ans après les faits, le témoignage de Paul Daigneau, un des protagonistes de l’attaque, permet d’en reconstituer le déroulement.
Le 8 juin 1943, les gendarmes d’Arlanc arrêtent, au moulin de La Roche, 6 réfractaires au S.T.O. Pierre Cerveau et Paul Daigneau, chefs d’un petit maquis, décident de les libérer en prenant d’assaut la Gendarmerie. Le premier, plus impulsif, propose une action directe en force. Le second penche pour une opération en douceur à la faveur de leur transport par voie ferrée. Finalement, l’option de Pierre Cerveau prévaut.
Le 9 au matin un groupe de 12 maquisards investit la petite bourgade. Avant d’arriver à la caserne il neutralise le gendarme Bourgeois et le laisse sous la surveillance de trois hommes. Pendant ce temps, le reste de la troupe pénètre dans la brigade où il surprend les gendarmes.
Tout espoir de négocier de libération des six réfractaires, ainsi que l’escomptaient les maquisards, s’évanouit, brutalement, à la suite de la réaction des gendarmes. L’adjudant Foulhoux et les gendarmes Martinet et Escudié se lèvent précipitamment. L’adjudant tente de faire front aux assaillants avec une chaise. Un des maquisards fait usage de son arme et le blesse à la cuisse. Une autre balle fracasse la mâchoire du gendarme Escudié. Néanmoins ce dernier réussit à sauter par la fenêtre. Il s’écroule sur la petite terrasse qui domine le jardin. Alors qu’il tente de se relever, Cerveau veut lui porter un coup de crosses sur la tête. Ce faisant, il actionne malencontreusement la détente de son arme. Une détonation retentit. Cerveau touché accidentellement d’une balle au foie s’effondre, grièvement blessé. La panique s’empare des jeunes maquisards qui tirent au hasard. Le gendarme Martinet, assis à une table de travail, près de la porte d’entrée, profite de la confusion pour essayer de quitter la pièce. Il n’y parvient pas. Touché à la cheville par un projectile, il s’affaisse sur le sol. Un des maquisards, Combaneyre, tire à nouveau sur lui et le touche dans la région abdominale. Malgré une intervention chirurgicale, il décède le 10 juin à l’hôpital d’Ambert. Pierre Cerveau ne survit pas non plus à ses blessures.
Daigneau, non sans difficulté, ramène le calme et reprend ses hommes en main. Il alerte un médecin pour donner des soins aux blessés et laisse Cerveau, intransportable, aux mains des gendarmes avant de se replier en direction de la montagne.
À partir du 10 les autorités déclenchent des battues avec d’importantes forces de police : Garde, Gendarmerie, G.M.R. Elles aboutissent dans la journée du 11 à l’arrestation du groupe de Daigneau dissimulé dans les caveaux d’un cimetière. Daigneau pourtant échappe aux recherches.
Le 14 juillet la Section spéciale près la cour d’appel de Riom juge les intéressés et rend son arrêt. Elle condamne à mort par contumace Paul Daigneau, en fuite, recherché par toutes les polices. Aux autres maquisards, dont Combaneyre, auteur du coup de feu mortel sur le gendarme Martinet, elle inflige des peines de travaux forcés.
Le 3 août, en gare de Pontmort, le corps franc du maquis d’Auvergne attaque par surprise l’escorte de Gendarmerie qui transfère les détenus à la centrale d’Eysses. Il libère les dix hommes. Quelques jours plus tard, la B.B.C. annonce la nouvelle sur les ondes : « Les dix éléphants sont bien arrivés. »
Trois jours après l’arrêt de la cour de Riom, le 17 juillet, la loi n° 458, promulguée au Journal officiel du 10 août, ajoute un article 2 bis, à celle du 16 juin réprimant les activités communistes, anarchistes et terroristes. Comme les fameuses commissions mixtes du second Empire qui associaient magistrats, policiers et gendarmes pour juger les insurgés, elle introduit la mixité dans la composition des Sections spéciales, mais uniquement dans le cas où elles sont appelées à juger un crime « dirigé contre un agent du maintien de l’ordre, la section de la force publique ou un fonctionnaire chargé du maintien de l’ordre ». Dans cette hypothèse, la Section spéciale comprend 2 magistrats, dont l’un remplit les fonctions de président, et trois juges, désignés par arrêté du chef du Gouvernement et du garde des Sceaux, choisis parmi des officiers de Gendarmerie, de la Garde ou des fonctionnaires de police ayant qualité d’officier de police judiciaire. C’est à partir de listes secrètes, établies par les directions générales des services concernés, que sont sélectionnés ces juges non professionnels.
D’après Maurice Gabolde, ce sont les chefs de la Police et de la Gendarmerie qui ont réclamé « des juridictions composées non plus de magistrats mais d’hommes courageux et impitoyables, faisant consciemment ou non le jeu de la Milice… ». Il s’en explique dans un document déposé à la Hoover Library après la Libération et rédigé en Espagne où il s’est réfugié.
À la suite de l’arrêt de la cour de Riom, Bousquet fait part à Laval du profond mécontentement qu’il provoque au sein des forces de l’ordre. Celles-ci ne comprennent pas la mansuétude dont trop de juges font preuve à l’égard des auteurs d’attentats, alors que la liste des victimes, parmi les policiers et les gendarmes, s’allonge tous les jours.
Le chef du Gouvernement réagit immédiatement. Il organise une conférence à Matignon. Y assistent tous les commandants de légion de Gendarmerie, les hauts fonctionnaires de la Police nationale et les chefs de la cour de Paris. L’affaire d’Arlanc est au cœur de la discussion. Gabolde subit de dures attaques car entre-temps les condamnés de Riom s’étaient évadés au cours de leur transfèrement.
« Comme j’étais décidé, écrit Gabolde, à me soustraire à cette éventualité, abandonner la répression à des juges occasionnels qui risquait d’aggraver la guerre civile et, soutenu par le chef du Gouvernement, je proposai la réunion, soit à Vichy, soit à Paris du procureur général et du premier président de cette cour pour envisager avec eux des modifications à la loi… »
Une réunion des chefs de cour se tiendra effectivement à Paris le 17 octobre 1943.
Si l’on s’en tient à la chronologie des faits, la réunion de Matignon est postérieure à l’élaboration de la loi du 17 juillet 1943. Gabolde y évoque en effet l’évasion de Pontmort qui s’est produite le 3 août. C’est dire qu’il a pris la décision de modifier la loi avant même d’écouter les chefs de la Police et de la Gendarmerie.
Après la réunion du 17 octobre, la loi subit un dernier aménagement. Une nouvelle disposition, en date du 22 octobre, permet aux membres non-magistrats des Sections spéciales de siéger pour juger pratiquement toutes les infractions graves, même si elles ne concernent pas un membre des forces de l’ordre. Il suffit qu’elles soient qualifiées par la loi « assassinat, tentative d’assassinat, meurtre, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires suivis de mutilations, amputations ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes. » Avec cette réforme, la responsabilité des arrêts passe aux juges non-magistrats, majoritaires, choisis parmi les corps particulièrement exposés. Le régime attend d’eux qu’ils se montrent plus répressifs que ne l’étaient auparavant les cours composées exclusivement de magistrats professionnels.
L’application du dispositif mis au point par Gabolde n’entraîne pas les effets recherchés. Le secret concernant la désignation des juges, pris parmi les gardes, les policiers et les gendarmes, n’est pas observé. Des indiscrétions fortuites ou volontaires se produisent si bien que les magistrats occasionnels craignent à leur tour pour leur vie.
L’attentat perpétré le 10 octobre 1943, à Toulouse, contre l’avocat général Lespinasse, membre de la Section spéciale, qui a requis et obtenu le 11 mars la peine de mort contre l’israélite polonais Marcel Langer, sonne comme un avertissement pour tous.
Le 12 novembre 1943, Laval réunit à Vichy les premiers présidents des Cours d’appel. Il leur brosse un tableau noir de la situation et leur reproche leur faiblesse. Et de citer le verdict de la Section spéciale de Riom qui ne prononce, dans une affaire grave, que des peines privatives de liberté parce qu’elle était menacée et craignait pour la vie de ses membres :
« À Arlanc, dans le Puy-de-Dôme, un jour, la brigade de Gendarmerie est assaillie par des terroristes. Les gendarmes sont blessés, l’un d’eux est à terre et un des terroristes l’achève. Ils ne respectent même pas les lois de la guerre où les blessés sont secourus sur le champ de bataille. On arrête ces terroristes. Ils sont déférés devant la section spéciale de la cour d’appel de Riom. Je croyais, je pensais qu’au moins l’un des terroristes, celui qui avait achevé le gendarme, serait condamné à mort : il est condamné aux travaux forcés. Et, quelques jours plus tard, comme il fallait transporter les condamnés de la maison centrale de Riom à une autre maison, ils s’évadent… »
C’est dans ce contexte, qu’à partir du mois d’août 1943, des officiers de Gendarmerie siègent dans les Sections spéciales à côté de leurs homologues de la Garde et de la Police nationale.
La Section spéciale près la cour d’appel de Lyon se compose du lieutenant-colonel de Gendarmerie C…, du lieutenant C… de la Garde et du commissaire divisionnaire D… On trouve dans celle de Riom le lieutenant-colonel R… À la Section spéciale de la cour d’appel de Limoges siège le lieutenant-colonel B…, commandant de légion du Berry à Châteauroux.
Les officiers désignés prêtent serment. Le 9 novembre 1943, le procureur général, près la cour d’appel de Limoges, convoque à cet effet, pour le lundi 15 novembre à 14 heures, devant la 1re chambre, en qualité de membre non-magistrat de la Section spéciale de ce tribunal, le lieutenant-colonel B… Devant le président, deux conseillers et l’avocat général, il prononce la formule :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l’État. Je jure et promets de bien et honnêtement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
Le mardi 16 novembre, l’officier répond cette fois à la convocation qui émane du président de la Section spéciale pour tenir audience à partir de 11 heures.
Dans leur majorité, les officiers accueillent mal les dispositions prises par le pouvoir. Un commandant de légion écrit :
« Une mesure d’exception prise récemment à l’égard des officiers de Gendarmerie, par le Gouvernement, a désagréablement surpris les intéressés. C’est celle d’en faire des justiciers au lieu et place des juges… Les officiers de Gendarmerie ne demandent à personne de faire leur métier qui surtout dans les circonstances actuelles présente des dangers quotidiens, et ils estiment que c’est abusif de leur imposer la charge et les dangers de juges rétribués. Ils espèrent que cette innovation, imposée par les lois n° 318 du 5 juin 1943, 458 du 17 juillet et 595 du 22 octobre, sera abrogée purement et simplement à bref délai. » Ce souhait ne sera pas exaucé. À moins de démissionner ou de refuser d’obéir aux ordres, les officiers retenus en qualité de juges se résignent, par devoir professionnel, à siéger dans les Sections spéciales. Leur nombre est infime par rapport à l’ensemble du corps des officiers. Le secret des délibérations n’a jamais été violé, aussi ignore-t-on quelle influence ils ont exercé dans les arrêts rendus par les sections spéciales.
Le comité national judiciaire, organisation clandestine de magistrats du palais de justice de Paris, qui pendant trois ans a mené la lutte pour la Libération, considère que les magistrats des Sections spéciales ont orienté les délibérations dans le sens le plus favorable aux prévenus, ceci d’une manière générale :
« Si parmi les magistrats quelques-uns avaient outrageusement méconnu leur devoir d’hommes et de juges, ils étaient heureusement l’exception, et si d’autres avaient insuffisamment réagi contre les courants venus d’en-haut auxquels ils cédaient avec une docilité qui les rend indignes de leur fonction, un très grand nombre, au contraire, s’est appliqué non seulement à éviter qu’aucune peine irréparable ne fût prononcée mais à atténuer la portée nocive d’une loi qu’ils s’efforçaient de tourner dans toute la mesure du possible… »
Cette appréciation concerne aussi les juges occasionnels des Sections spéciales guidés et conseillés dans leur fonction, à la manière des jurés de cour d’assises, par les magistrats professionnels.
Au moment de l’épuration, les commissions d’enquête instituées dans les légions font preuve d’une relative mansuétude à l’égard des officiers ayant siégé dans les Sections spéciales. Pourtant, il n’est pas question de les exonérer. La directive diffusée le 20 novembre 1944 par le général Tamisier, directeur des personnels de l’armée de Terre, ne laisse aucun doute à ce sujet. Ayant constaté qu’un dossier d’enquête d’un officier de Gendarmerie établi dans le cadre de l’épuration administrative ne faisait pas état de ses fonctions de juge dans une Section spéciale, il invite le commandement à signaler impérativement de telles situations :
« Le cas concret suivant est soumis à la réflexion des chefs responsables : X…, un officier de Gendarmerie, a occupé des fonctions dans les tribunaux d’exception institués par le Gouvernement de Vichy. Ce fait n’est pas signalé dans l’enquête présentée par le commandant de légion. Il ne fait apparemment l’objet d’aucune recherche de sa part… La sincérité des enquêtes faites par la Gendarmerie sur son propre personnel engage tout son avenir et sa bonne réputation. »
Des fonctionnaires du Maintien de l’ordre ont aussi siégé dans les Cours martiales instaurées par la loi n° 38 du 20 janvier 1944. Cette participation se limite à quelques cas connus : Cours martiales d’Annecy et de Montpellier. Hormis ces exceptions, en règle générale, les membres de ces juridictions, au nombre de trois, sont choisis parmi les miliciens.
Aucun élément probant ne permet d’accréditer l’affirmation de François Musard, dans son ouvrage « Les Glières » et celle de Michel Germain, dans son triptyque sur la Résistance en Haute-Savoie, selon laquelle deux officiers appartenant aux forces de Gendarmerie détachées en Haute-Savoie, le capitaine Lombard et le sous-lieutenant Got, auraient fait partie de la Cour martiale constituée à Annecy, villa Mary, le 4 mai 1944, pour juger 11 maquisards arrêtés au cours des opérations de nettoyage consécutives à l’investissement des Glières.
Julien Helfgott, sergent-chef aux Glières, un des six rescapés jugé par ce tribunal le 4 mai, signale la présence des deux officiers, à proximité de la salle d’audience, ce jour-là, sans indiquer toutefois que le capitaine Lombard, chef des forces de Gendarmerie du secteur d’Annecy, présidait la cour :
« À l’intérieur de la seconde enceinte, rapporte-t-il, des hommes armés s’affairaient ; on reconnaissait l’inévitable uniforme kaki des G.M.R. et quelques gendarmes ramassaient des pelles et des pioches. Le capitaine Lombard, fringant, plein d’aise, donnait des instructions à son sous-ordre très empressé, le sous-lieutenant Got pour des exécutions rapides qui allaient suivre… Les formalités d’écrou, pour le paquet de condamnés furent vite remplies. Les prisonniers sont projetés dans une salle étriquée devant cinq hommes paraissant mal à l’aise, vêtus avec recherche, le revolver à la ceinture. Nous étions devant nos assassins de la Cour martiale. »
Le procès du colonel Lelong, directeur des opérations et du Maintien de l’ordre en Haute-Savoie, en novembre 1944, devant le tribunal des Armées de Lyon siégeant à Annecy, infirme la version des faits rapportée par François Musard et Michel Germain. Pendant les débats, Lelong reconnaît qu’il a désigné deux juges en la personne des commissaires M… et B… En incorporant des gens qui de par leur métier étaient particulièrement qualifiés il avait pensé renforcer les garanties de justice devant la Cour martiale.
Les explications fournies par les deux fonctionnaires de police au président du tribunal militaire prouvent que le 4 mai la Cour martiale comprenait un commissaire du Gouvernement, deux envoyés de Vichy et les deux commissaires de police. À la barre du tribunal, le premier policier relate ainsi sa désignation :
« En ce qui concerne la Cour martiale je suis tombé dans un guet-apens. On m’a nommé rapporteur d’autorité. J’ai essayé de sauver tous ceux que j’ai pu. Le commissaire du Gouvernement, lorsque j’ai demandé que les accusés soient entendus, de même que les témoins, et que leur défense soit assurée, m’a répondu avec un air sévère : « La Cour martiale juge sur pièce ». »
Le second juge précise son rôle de la manière suivante :
« On m’a appelé d’urgence à l’intendance de police. Quand j’ai su ce qu’on voulait de moi, j’ai protesté. J’ai obtenu la permission d’aller manger chez moi. Les deux envoyés de Vichy ne m’ont pas laissé discuter, d’autorité on m’a désigné comme président. Ceux de Vichy ont prononcé la condamnation. »
* *
*
L’État français a encore recours à la force publique pour procéder à l’exécution d’individus condamnés à la peine capitale. Des gendarmes sont naturellement concernés par cette mission.
Le 2 novembre 1943, l’exécuteur en chef des arrêts criminels et l’un de ses aides démissionnent de leur fonction compromettant la mise en œuvre des bois de justice qui leur incombe à travers le pays. En cette fin d’année 1943, l’insécurité s’aggrave sur l’ensemble du territoire au point que l’administration redoute que la guillotine ne soit enlevée par « les terroristes ». Dans le même temps, le nombre des condamnations à la peine de mort augmente considérablement.
Courant novembre, un communiqué du ministère de la Justice annonce une modification de la procédure des exécutions capitales. Le 30, la loi n° 616 fixe pour le temps de guerre le mode d’exécution de certaines condamnations à la peine capitale. Désormais, lorsque le tribunal d’État, le tribunal Spécial, la Section spéciale d’une cour d’appel prononcent une condamnation à mort, le condamné peut être passé par les armes. Ces dispositions, au mois de mai 1944, s’étendent aux condamnations prononcées par les Cours d’assises.
Les militaires, normalement, constituent les pelotons d’exécution. Or, en 1943, l’armée d’armistice a été démobilisée. Il ne subsiste qu’un régiment, celui de la force armée gouvernementale, à effectif modeste, employé dans le cadre du maintien de l’ordre. Le recours aux forces de police, G.M.R., Garde devient inéluctable.
En février 1944, Darnand décide de faire participer la Gendarmerie aux exécutions capitales. Son arrêté du 14 février 1944, complété par des instructions du S.G.M.O. datées du 15 et adressées aux préfets régionaux, fixe les mesures à prendre en vue de l’exécution des arrêts de condamnation à la peine capitale. Le texte dispose que « la Gendarmerie participera aux exécutions capitales mais elle n’assurera ce service qu’à défaut de garde ou de police. »
Lorsque Darnand prend son arrêté, la loi et le décret qui règlent la participation de la Gendarmerie aux exécutions capitales sont toujours en vigueur. La loi du 28 germinal an VI pose le principe « que la Gendarmerie ne peut être requise que pour le maintien de l’ordre et doit rester étrangère à tous les détails de l’exécution. » De même le décret du 20 mai 1903, dans son article 86, stipule que « les militaires de la Gendarmerie peuvent éventuellement être requis par le procureur général ou le procureur de la République, lors des exécutions capitales, auquel cas ils sont uniquement préposés au maintien de l’ordre. »
Darnand foule aux pieds les principes qui régissent l’action de la Gendarmerie sans même prendre le soin d’abroger les textes en usage. Tel est le processus qui conduit les gendarmes à participer à des exécutions capitales pendant l’Occupation.
Le commandement de la Gendarmerie et de la Garde, au lendemain de la Libération, en octobre 1944, a prescrit une enquête approfondie pour déterminer dans quelles conditions ses personnels avaient agi. Les résultats n’en ont jamais été divulgués. On ne connaît donc pas le chiffre officiel de condamnés à mort tombés sous les balles de pelotons d’exécution composés de gendarmes. En tout état de cause, il est peu élevé. À titre indicatif, entre le 22 février et le 22 juin 1944, la Cour martiale de Toulouse prononce six condamnations à mort. Les gendarmes passent par les armes un seul des condamnés. Les G.M.R. sont chargés des autres exécutions. On relève des proportions sensiblement identiques dans les autres régions de France.
Comment les autorités mettent-elles la Gendarmerie en œuvre pour remplir ce genre de mission ? La référence à un cas observé dans la région de Toulouse nous éclaire sur ce point.
Le journal La Dépêche du 16 mars 1944 titre un de ses articles : « Des terroristes passés par les armes à Toulouse et Montpellier ». Suit un texte très laconique :
« Toulouse le 16 mars. Le 7 février, dans la localité de Grenade, un individu était appréhendé par un gendarme. Au moment où il pénétrait dans la cour de la Gendarmerie, il tenta de s’enfuir en lançant une grenade de type anglais. Au cours de l’interrogatoire l’homme reconnut qu’il agissait pour le compte d’une organisation terroriste. Il comparaissait hier devant la Cour martiale de Toulouse. Reconnu coupable de tentative de meurtre dans un but terroriste, il a été condamné à mort et passé par les armes. »
L’affaire, jugée par la Cour martiale, débute en fait le 8 février 1944. Ce jour-là, le gendarme S…, de la brigade de Grenade, qui n’est pas en service, vaque à ses affaires dans la petite cité de la Haute-Garonne. Soudain, il aperçoit trois jeunes gens étrangers à la localité qui, à sa vue, s’éloignent précipitamment. Il se lance alors à leur poursuite et parvient à interpeller deux d’entre eux. Au moment où le petit groupe pénètre dans la cour de la caserne, un des individus lance une grenade et tente de s’enfuir. L’engin, mal dégoupillé, n’explose pas. Les gendarmes rattrapent rapidement le fuyard.
Suit la procédure habituelle : interrogatoire, établissement d’un procès-verbal, conduite des intéressés à la maison d’arrêt de Toulouse selon les instructions données par le procureur de l’État français. Le parquet retient à l’encontre des deux hommes plusieurs chefs d’inculpation : vol, port d’explosif, acte de terrorisme, présentation de fausses pièces d’identité.
Comme il est d’usage en pareil cas, le gendarme S…, qui a fait preuve d’initiative et de sang-froid, est félicité par ses chefs et reçoit une gratification.
Informé des faits par l’autorité judiciaire, l’intendant de police Hornus engage les formalités pour traduire les deux prévenus devant la Cour martiale.
Le 10 mars, le préfet régional reproche à la Gendarmerie de ne pas avoir prévenu immédiatement et directement, par message téléphoné, le commissaire divisionnaire chef du service régional de police de sûreté s’agissant, souligne-t-il, « de faits importants ayant trait à des menées communistes, terroristes et antinationales ». Son intervention révèle l’influence extrêmement forte qu’exercent sur la Gendarmerie les autorités administratives.
Le 14 mars, à 9 heures, l’intendant de police convoque à son bureau l’officier adjoint au commandant de la légion de Gendarmerie de Gascogne pour lui signifier que la Gendarmerie devra fournir, à 16 heures, un peloton pour passer par les armes un individu condamné à la peine capitale par la Cour martiale.
L’officier rétorque que ce service n’incombe pas à la Gendarmerie. Il appelle l’attention de l’intendant de police sur les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 février qui prévoit expressément qu’elle n’assurera ce service que s’il n’y a pas de Garde ou de police dans la ville où la sentence doit être exécutée. Or un groupe de G.M.R. et un régiment de la Garde sont implantés à Toulouse. Hornus, intransigeant, réplique fermement en disant qu’il a pour principe de charger de l’exécution de l’auteur d’un attentat le corps ou le service contre lequel celui-ci a été dirigé.
Entre 10 heures et 16 heures, le commandement de la Gendarmerie déploie tous ses efforts, auprès du préfet régional, afin de faire rapporter l’ordre d’Hornus, mais en vain.
Quelques minutes avant 16 heures, la Cour martiale siège à la prison Saint-Michel. Déjà arrêté, le verdict tombe impitoyable : c’est la peine de mort. À 16 h 05, André Roussin, de son vrai nom Jacques Grignoux, âgé de 19 ans, membre de la 35e brigade F.T.P.F. Marcel Langer, capturé au retour d’une mission par le gendarme S…, tombe sous les balles du peloton de gendarmes désigné en début d’après-midi pour remplir cette besogne. Un témoin de la mort du supplicié, commis greffier à la prison Saint-Michel, écrira plus tard :
« Le 14 mars, c’est au tour d’un titi parisien qui meurt en brave sous son nom de guerre. J’ai assisté à ses derniers moments. Il m’a dit de dire adieu à ses copains Albert et Boujeux. »
L’infortuné compagnon de Jacques Grignoux, Roger François Lafforgue, arrêté à Grenade en même temps que lui, trouvé porteur d’une grenade, d’un revolver et de cartouches évitera la Cour martiale mais mourra en déportation le 9 septembre 1944.
Le 15 mars, soit le lendemain de l’exécution, trois des gendarmes désignés pour exécuter la sentence déposent une demande de mise à la retraite tant ils sont choqués par la mission dont on les a chargés.
La seule issue, pour les gendarmes confrontés à de telles situations, était de désobéir ou de déserter. C’est cette voie que choisissent d’autres gendarmes dont on n’a jamais évoqué le refus. Comme le garde mobile Jules Pol de l’escadron d’Aire-sur-Adour désigné en avril 1944 pour fusiller un patriote à la prison de Limoges et qui déserte en emportant son armement, douze sous-officiers de la Garde de Paris appelés à remplir une mission similaire, à la prison de la Santé, en 1944, préfèrent abandonner leur poste et rejoindre le maquis Delouvrier.
À Nîmes, le 3 juillet 1944, une Cour martiale présidée par le chef départemental de la Milice, Passemard, condamne à mort 3 jeunes maquisards. Celui-ci requiert un peloton de 30 gendarmes pour exécuter la sentence. Stationné à la caserne sise rue Bernard-Atton, le peloton rejoint vers 17 heures la maison d’arrêt. À peine arrivé le commandant d’unité doit désigner 8 hommes pour rendre les honneurs au président de la Cour martiale qui, dans un local de la prison, donne lecture du verdict aux 3 accusés.
L’exécution est prévue dans les arènes proches de la maison d’arrêt. Au dernier moment les autorités se ravisent car elles craignent une manifestation d’hostilité des Nîmois. Les condamnés seront passés par les armes dans une des cours de la prison.
Dix gendarmes sont désignés par maquisard à exécuter. À la stupéfaction de Passemard, après conciliabule, les gendarmes refusent de remplir la besogne qu’on leur assigne. Le capitaine Orsatelli, leur chef, fait valoir tous les arguments possibles pour ne pas exécuter l’ordre de Passemard. À 20 heures, l’exécution n’a toujours pas eu lieu malgré la pression et les menaces des autorités. Le peloton quitte alors la maison d’arrêt.
Transférés à la prison des Beaumettes, à Marseille, dans les heures qui suivent, les 3 condamnés tombent sous les balles d’un peloton d’exécution composé de G.M.R.
Le 5 juillet, la Milice exécute l’ordre d’écrou délivré contre les gendarmes cernés dans leur cantonnement. Huit d’entre eux qui habitent en ville, car ils appartiennent à la brigade de Nîmes, échappent à l’arrestation et rejoignent le maquis. Incarcérés à la maison d’arrêt de Nîmes, les autres gendarmes au nombre de 22 sont transférés ensuite à la prison Saint-Pierre à Marseille. Le débarquement des Alliés en Provence leur sauve probablement la vie. Ils recouvrent la liberté le 17 août, quelques jours avant la libération de Marseille.
Passemard avait demandé contre eux un châtiment sévère. Quant au général N…, commandant la région d’inspection de Marseille, dans une note adressée le 5 juillet à la direction de la Gendarmerie, il écrivait :
« L’insubordination des gradés et gendarmes est patente et doit faire l’objet de poursuites légales… Les autorités administratives ne s’opposent pas à ce que les gendarmes soient traduits devant le tribunal militaire plutôt que devant un tribunal de Maintien de l’ordre… Je donne l’ordre au chef de corps, en attendant votre décision, d’établir les responsabilités, et de transmettre d’urgence les dossiers prescrits. En particulier le rôle joué par l’officier sera élucidé… »
Le refus d’obéissance des gendarmes Blanc, Modéna, Chauvy, Gibert, Boissin, Vieilledent, Chiffe, Henri, Suze, Dezeuze, Maetz, Azaïs, Constant, Ravida, Deduit, Maurin, Combo, Knavie, Tissot, Damade, Brigot est tout à leur honneur.
Le général N…, camarade de promotion du général de Gaulle, qui a toujours appliqué à la lettre les instructions gouvernementales, est révoqué, sans pension, quelques semaines plus tard.
Au mois d’août 1944, à Paris, d’autres gendarmes préfèrent abandonner leur poste plutôt que de participer à une exécution capitale. Le 14 août 1944, le capitaine Chalvidan, commandant la section de Paris-Exelmans, apprend qu’un groupe de ses gendarmes, en service à la prison de la Santé et placé sous les ordres de l’adjudant Schlegel et du chef Dieudonné, va recevoir incessamment l’ordre de fusiller des résistants. Immédiatement l’officier met dans la confidence un de ses subordonnés, le gendarme Omnès, dans lequel il a une totale confiance. Il sait que son fils commande un maquis en Haute-Saône, aussi lui demande-t-il d’aller prévenir les intéressés. Le gendarme Omnès se rend à la prison de la Santé en civil et parvient à joindre ses camarades. Non sans difficultés, car ils sont incrédules, il réussit à les convaincre de disparaître avant d’être requis. Deux par deux, ils abandonnent leur poste.
Le 15 août, à la demande de son commandant de section, le gendarme Omnès revient à la prison de la Santé pour se renseigner. Il apprend qu’effectivement plusieurs résistants viennent d’être passés par les armes. Les efforts du capitaine Chalvidan et du gendarme Omnès, malheureusement, ne suffisent pas pour empêcher les exécutions.
Dans le mémoire qu’il rédige en 1952, pour expliquer son action à la tête de la Gendarmerie, d’août 1943 à août 1944, le général Martin passe sous silence cet emploi abusif de la Gendarmerie par le régime de Vichy. Confrontés au même problème, à la Libération, ses successeurs se montrent plus clairvoyants.
L’ordonnance du 29 novembre 1944, relative à l’exécution des condamnés à mort, prise par le G.P.R.F., dispose dans son article 2 que « des arrêtés préfectoraux détermineront, dans chaque cas, la composition des pelotons d’exécution. L’exécution sera réalisée comme il est prévu par les règlements militaires en vigueur. »
Le commandement de la Gendarmerie, à juste titre, craint que les préfets ne s’appuient sur ce texte pour confier à des gendarmes des exécutions capitales. Aussi saisit-il le ministre de la Guerre afin qu’il intervienne auprès de celui de l’Intérieur pour soustraire l’Arme à de telles missions. En réponse au courrier du ministre de la Guerre daté du 13 janvier 1945, le ministre de l’Intérieur répond dès le 25 :
« Vous estimez qu’il est indispensable de soustraire la Gendarmerie à des services qui, pour des raisons psychologiques qui n’ont rien perdu de leur valeur, lui ont été traditionnellement épargnés. J’ai l’honneur de vous faire connaître que je partage sur ce point votre manière de voir. J’ai donné toutes instructions utiles aux commissaires régionaux de la République et aux préfets pour qu’en aucun cas la Gendarmerie et la Garde républicaine ne soient requises pour participer à des exécutions capitales autrement que pour y maintenir l’ordre. »
Même si les situations décrites à propos des juridictions d’exception et des exécutions capitales n’affectent que quelques officiers et sous-officiers, en nombre négligeable par rapport à celui de la population de l’institution (39 983 hommes), on pressent, à travers le comportement de ceux qui ont refusé d’obéir ou qui ont exprimé leur désapprobation en quittant la Gendarmerie, le déchirement des consciences.
Plus massivement, dans des circonstances différentes, le pouvoir engage des gendarmes dans des actions aussi tragiques que celles qui viennent d’être relatées.
L’État français, entre 1940 et 1944, a employé la force publique pour exécuter les mesures coercitives dirigées contre les Juifs, mis au ban de la société, puis voués à l’extermination par les nazis auxquels il les a livrés. Le régime a ainsi impliqué la Gendarmerie dans le processus tragique de la déportation. En ordonnant aux gendarmes d’arrêter des enfants, des femmes et des hommes dont le seul crime était d’être de race juive, le pouvoir les a associés à une persécution d’une ampleur sans précédent dans notre histoire. On n’en découvrira toute l’horreur qu’à la libération des camps de concentration en 1945.
Pour appréhender le rôle peu enviable joué en la circonstance par l’institution, on ne peut l’abstraire, d’une part, du climat de xénophobie qui se donne libre cours dans le pays depuis l’armistice, d’autre part, de la législation élaborée par le régime.
CHAPITRE 14 – L’IMPOSSIBLE OUBLI
La propagande antisémite fleurit dans les villes. Des inscriptions injurieuses apparaissent sur les vitrines des magasins tenus par des Juifs. Les discours prononcés par les chantres du racisme sont pleins de haine. Par touches successives, dès l’automne 1940, le Gouvernement organise la répression. Il met en place, conjointement avec l’occupant, les éléments de l’engrenage qui vont lui permettre de contrôler constamment la population juive. Le 3 octobre 1940, Pétain officialise un statut des Juifs de nationalité française. Pour la communauté juive, c’est le début de l’exclusion. Interdits et obligations prolifèrent.
Dans le recueil des textes officiels édictés par les Français et les Allemands, entre 1940 et 1943, publié après la guerre par le Centre de documentation juive contemporaine, on ne dénombre pas moins de 250 pages de mesures dirigées contre les Juifs qui les rendent incontestablement vulnérables. S’ils transgressent la législation, ils s’exposent à des sanctions judiciaires (amendes, peines de prison) et administratives (internement).
Notons quelques exemples de dispositions discriminatoires. La loi du 3 octobre écarte les Juifs de diverses fonctions publiques, armée, police, magistrature, enseignement, etc. Non seulement elle les exclut de la vie publique et professionnelle, mais elle leur enlève leurs droits civiques et les rend « apatrides » en les « dénaturalisant ».
Provisoirement, la loi leur laisse libre accès aux professions libérales. Néanmoins, les médecins, sauf dérogations exceptionnelles, ne peuvent plus pratiquer l’exercice de leur art. Les Juifs sont encore exclus des fonctions de responsabilité au sein de la presse et dans les milieux cinématographiques.
Un additif à la loi, pris le 4 octobre, stipule que « les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par décision du préfet du département de leur résidence. »
Une loi du 9 novembre 1942 réglemente la circulation des Juifs étrangers. Ils ne peuvent sortir du lieu de résidence qui leur est assigné que s’ils sont porteurs d’un titre de circulation régulier (sauf-conduit ou carte de circulation temporaire) délivré par les autorités de police.
Une peine d’emprisonnement d’un an à six mois et une amende de 200 à 10 000 francs ou l’une de ces peines seulement réprime les infractions constatées.
Autre disposition, celle prise un mois plus tard, le 11 décembre. Les Juifs sont tenus de se présenter, dans un délai d’un mois, au commissariat de police de leur résidence ou à défaut à la brigade de Gendarmerie, pour faire apposer la mention « Juif » sur leur carte d’identité ou sur le titre en tenant lieu ainsi que sur leur carte individuelle d’alimentation. Tout Juif qui se dérobe à cette obligation est passible d’une peine d’un mois à un an de prison et d’une amende de 200 francs. Sur ordre de Bousquet, diffusé le 20 août 1942 « tout israélite qui commet une infraction à l’égard de la réglementation concernant le ravitaillement doit faire immédiatement l’objet d’une mesure d’internement. »
À la législation s’ajoutent les instructions émanant des services du général Oberg. Par note du 19 octobre 1942, le chef de la sûreté et du service de sécurité ordonne au préfet de police, à Paris, de faire interner au camp de Drancy, à l’expiration de leur peine, tous les Juifs condamnés par des tribunaux français.
Les autorités allemandes ne manquent pas de rappeler à la Gendarmerie les charges qui lui incombent en matière de surveillance des Juifs. Le 5 mars 1943, le Kommandeur du Sipo/SD de Rennes, le capitaine SS Pueme, invite le préfet de région à opérer les redressements qu’exige la situation :
« Il m’a été signalé, écrit-il, que la Gendarmerie française s’est refusée à assurer la surveillance des Juifs en déclarant qu’elle n’avait pas reçu d’instructions à cet effet de la part des services proposés, et qu’en outre, elle n’était pas désignée nommément en vue des missions de surveillance dans les ordonnances 8 et 9 du Militarbefehlshaber relatives aux mesures contre les Juifs. D’après la loi fondamentale concernant la police française, la Gendarmerie française se charge de toutes les missions policières en rase campagne, elle doit effectuer également la surveillance concernant les Juifs.
Je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour que la Gendarmerie française satisfasse immédiatement aux missions de surveillance concernant les Juifs. »
L’étau se resserre inexorablement sur les Juifs. Le 27 novembre 1940, dans les territoires occupés, une ordonnance allemande leur prescrit de se faire recenser. En cas de défaut de déclaration, les contrevenants sont passibles de peines d’emprisonnement ou d’amende, voire même de la confiscation de leurs biens.
L’administration note les déclarations sur un registre spécial après exploitation des formulaires individuels renseignés par ceux qui y souscrivent. Dans la région parisienne, la préfecture de police centralise toutes les informations recueillies par les commissariats (Seine) et les sous-préfectures. Le préfet Langeron confie à André Tulard, chef de bureau au service des étrangers, le soin d’élaborer un fichier. Ce fonctionnaire mène rapidement à bien la mission qui lui est confiée.
En zone nord, les autorités françaises disposent, début 1941, d’un outil efficace pour suivre la situation des Juifs. Rien de plus facile, lorsque l’ordre en sera donné, pour les sélectionner et les localiser.
Le second statut des Juifs, en date du 2 juin 1941, accroît la sévérité du précédent. Il étend l’obligation de recensement à la zone non occupée. Dans tous les départements, les préfets prennent des arrêtés ordonnant aux Juifs de faire, dans le délai d’un mois à compter de la publication de la loi, leur déclaration, sur imprimés spéciaux et de la déposer ou l’adresser par la poste aux commissariats, mairies ou gendarmeries. La mention de leur état civil, de leur situation de famille, de leur profession et de l’état de leurs biens figure sur les documents établis.
Sur la base de ces renseignements, les préfectures dressent les listes des Juifs en résidence ou domiciliés dans leurs circonscriptions. Elles ne serviront pas uniquement à un banal recensement, pudiquement intitulé par l’administration « déclaration des israélites », car les commissariats et brigades de Gendarmerie sont destinataires d’un exemplaire.
Pour être en règle vis-à-vis de la loi, dans leur majorité, les Juifs se plient aux formalités qui leurs sont imposées. Comment pourraient-ils imaginer qu’ils sont désormais à la merci des autorités ?
Le 2 juillet 1942, le piège qui leur est destiné est fin prêt à fonctionner. Bousquet, au cours des discussions avec le général Oberg sur la coopération des polices françaises et allemandes, propose à son interlocuteur de faire rafler par la police française 20 000 Juifs étrangers de la zone occupée. Il consent même à remettre aux nazis 10 000 Juifs de la zone libre. Conséquence de cet accord : les rafles du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet et celles du 26 août en zone libre.
Pour accroître, par la suite, l’efficacité de la répression, le Gouvernement ne relâche pas la pression. Il prend de nouvelles dispositions. Le Commissariat général aux Questions juives, véritable ministère des affaires juives, créé en mars 1941 par l’amiral Darlan, vice-président du conseil, demande le concours de la Gendarmerie au profit de la Section d’enquête et de contrôle (SEC) précédemment appelée police aux Questions juives chargée de l’exécution des lois raciales.
En contrepartie des informations que la S.E.C. propose de fournir aux commandants de légion qui feraient appel à elle « sur les questions juives, parfois délicates à résoudre », la Gendarmerie, à titre exceptionnel, autorise les gendarmes à remplir et à remettre aux inspecteurs de la S.E.C. un « questionnaire racial » sur les personnes de race juive faisant l’objet d’investigation ou en résidence dans la circonscription des brigades. D’autre part, elle donne la faculté à ces mêmes inspecteurs de consulter sur place, dans les unités, les procès-verbaux dressés contre les Juifs sous réserve d’avoir l’accord préalable des commandants de compagnie.
Par note interne, le Commissariat général aux Questions juives recommande à ses agents d’essayer d’obtenir des commandants de section qu’ils appliquent strictement et sévèrement, en matière de carte de circulation temporaire, les dispositions de la loi 979 du 2 novembre 1942. De même, il les invite à se rapprocher des commandants de brigade pour recueillir les noms de Juifs qui, après avoir résidé dans leurs circonscriptions, sont repartis. Avec ces informations, la S.E.C. possède les éléments nécessaires pour contrôler les mouvements des Juifs et leur situation numérique. Il leur suggère également de s’adresser à la Gendarmerie pour trouver l’adresse des Juifs recherchés.
Aucun élément tangible ne permet d’évaluer la portée de la coopération S.E.C./Gendarmerie qui n’a pas laissé, tant elle a été limitée, le moindre souvenir dans la mémoire des exécutants interrogés.
Enfin, pour incliner policiers et gendarmes à l’obéissance et, en toute hypothèse, pour les stimuler, les autorités utilisent l’intimidation ou l’encouragement. Le 22 août 1942, Bousquet brandit la menace. Dans une note adressée aux préfets, il leur recommande d’être vigilants :
« Vous n’hésiterez pas à signaler les fonctionnaires dont les indiscrétions, la passivité ou la mauvaise volonté auraient compliqué votre tâche… »
Quelques jours après, le 29, une sanction frappe le général de Saint-Vincent, gouverneur militaire de Lyon, commandant la 14e région militaire. Il a refusé le concours de la troupe, à l’intendant de police Marchais, pour maintenir l’ordre, en gare de Lyon, pendant l’embarquement de 650 Juifs transférés en zone occupée. Le général Bridoux, secrétaire d’État à la Guerre, le démet immédiatement de ses fonctions. Pour ceux qui seraient tentés d’entraver l’action des pouvoirs publics, le message est clair.
De même, la police allemande met en garde les membres des forces de l’ordre qui se rendraient coupables de défaillances. Le 19 février 1941, le SS Sturmbanführer Hulf, du Sipo/SD de Lyon, ordonne l’arrestation et le transfert à Drancy de plusieurs dizaines de Juifs. Dans la correspondance qu’il adresse au préfet régional, il souligne que « la Police et la Gendarmerie française seront responsables de l’évasion éventuelle de ces Juifs ».
Après les arrestations massives de Juifs, dans la capitale, en juillet 1942, le chef de la police aux Questions juives Schewblin, à la demande des Allemands désireux de consolider le climat de coopération avec la Police française et surtout d’inciter les exécutants à ne pas relâcher leur effort, fait parvenir de substantielles gratifications aux directions des différents corps de l’État « mis à contribution de façon exceptionnelle » depuis le mois de juillet en zone occupée.
Le préfet du Loiret reçoit, le 25 août, un mandat de 26 000 francs destiné au personnel civil des cadres d’organisation et de surveillance des camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. La direction de la Police nationale bénéficie à la même époque d’une somme de 26 000 francs « pour répartition dans le personnel de la direction. » Le 25 août, le chef de la police aux Questions juives signale au préfet du Loiret qu’il « est actuellement en pourparlers avec la direction générale de la Gendarmerie pour faire remettre une certaine somme aux brigades de gendarmes affectés aux camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. » Les tractations aboutissent. Le 28 août, Schewblin remet un mandat de 200 000 francs à la direction de la Gendarmerie « pour sa participation à l’action de police juive dans les territoires occupés. »
Si les personnels civils chargés de la surveillance des camps reçoivent, en fonction de leurs mérites, une somme d’argent, les gendarmes, en revanche, ne touchent aucune prime à titre personnel. La direction de la Gendarmerie verse l’argent reçu à la masse de secours destinée à ses œuvres sociales.
* *
*
En matière de répression antijuive, la Gendarmerie intervient de deux manières, soit d’initiative, soit sur ordre. Les actions d’initiatives s’inscrivent dans le cadre du service ordinaire au cours duquel les gendarmes recherchent et constatent les infractions à la loi. Ils ont le sentiment d’être dans leur rôle, lorsqu’ils sévissent à l’encontre des Juifs qui ne sont pas en règle avec la législation ou les règlements. Les motifs d’interpellation sont nombreux : défaut de pièces d’identité, présentation de faux papiers, tentative de franchissement des frontières, passage clandestin de la ligne de démarcation, etc.
Les arrestations sont lourdes de conséquences car, en fin de compte, elles conduisent les victimes dans les griffes des nazis. L’excès de zèle, plus que l’antisémitisme, paraît être à l’origine des initiatives prises par certains.
Quel état d’esprit anime les gendarmes B… et D… de la brigade de Podensac (Gironde) lorsqu’en service de nuit, le 28 mars 1942, près d’Illats, au hameau de Barrouilh, ils arrêtent le jeune René Jacob, âgé de 15 ans, qui se trouve dehors 30 minutes après l’heure du couvre-feu imposé aux Juifs par une ordonnance allemande ? Le procès-verbal d’arrestation mentionne :
« Nous avons déclaré à Jacob René que, pour infraction, nous le mettons en état d’arrestation pour être conduit au camp de Mérignac pour y être interné. René Jacob mesure 1 m 60. Il est vêtu d’un complet bleu foncé, coiffé d’un béret basque, chaussé de sabots et possède un cache-col multicolore… ».
Le père de René Jacob, considéré comme responsable des actes de son fils, est à son tour interné. Il fait partie du convoi du 26 août, en provenance de Bordeaux comprenant quatre cent vingt-sept internés dirigés sur Drancy. Ce sera ensuite la déportation.
Les interventions qu’effectue la Gendarmerie sur ordre exprès des préfets ou des autorités d’occupation, de loin les plus nombreuses, mobilisent des effectifs importants qu’il s’agisse d’actions d’envergure, de la garde des camps de transit ou de l’escorte des convois de déportés d’une zone à l’autre puis aux frontières du Reich.
Les arrestations ordonnées par le ministère de l’Intérieur, désignées sous le terme de « rafle » ou de « ramassage » visent à priver de liberté, simultanément, dans une aire géographique donnée, l’intégralité d’un groupe social, hommes, femmes, enfants, vieillards, sans qu’aucune infraction ou jugement ne le justifie.
L’examen, à travers trois opérations, des conditions de mise en œuvre de la Gendarmerie met en lumière le rôle joué en amont par les autorités préfectorales et, en aval, par la chaîne du commandement et les exécutants.
La première action évoquée inaugure l’engagement massif de la Police française. Les 16 et 17 en juillet 1942, le secrétaire général à la Police associe la Gendarmerie à l’opération « Vent Printanier » en vue d’arrêter et de rassembler un certain nombre de Juifs étrangers domiciliés à Paris et en banlieue. La Gendarmerie, subordonnée directement aux autorités de Police, n’y joue en fait qu’un rôle d’appoint avec environ 500 hommes pour un effectif d’au moins 4 000 policiers.
Hennequin, directeur de la police municipale, envoie le 13 juillet ses instructions au commandement de la Gendarmerie et de la Garde de Paris. Pour assurer la surveillance des centres primaires de rassemblement, dans chaque arrondissement, les commissaires de police reçoivent en renfort 255 gardes tandis que dans les circonscriptions de banlieue, Saint-Ouen, Les Lilas, Montreuil et Vincennes, 60 gendarmes sont mis à la disposition des équipes d’arrestation. En outre, la gendarmerie départementale de la région parisienne se voit confier la garde interne et externe du Vélodrome d’Hiver.
La seconde action se déroule en zone sud que l’ennemi n’occupe pas encore. Le 26 août 1942, les brigades de Gendarmerie, opérant cette fois de façon autonome, contribuent à l’évacuation des Juifs étrangers rentrés en France après le 1er janvier 1936.
Entre le 5 et le 24 août, le secrétariat général à la Police transmet une série de directives (dépêches, circulaires, télégrammes) au sujet du regroupement des Juifs de la zone libre. Un climat de fébrilité entoure la préparation de l’opération, dans les sphères administratives. À l’échelon régional, les préfets arrêtent le dispositif d’exécution et la mise en place des moyens en personnel et en matériel : modalités de ramassage, de regroupement initial, mesures conservatoires, séjour dans les camps, cas d’exemptions, criblage, etc. Ces hauts fonctionnaires répercutent ensuite simultanément leurs instructions aux préfets départementaux et aux autorités de Gendarmerie situées à leur niveau (arrondissements d’inspection, légions) qui informent les commandants de compagnies des opérations projetées.
Par note de service n° 144/4 du 21 août 1942, le colonel commandant la 14e légion à Lyon précise aux commandants de compagnie que « la Gendarmerie doit participer le 26 août à la recherche et à la réunion des Juifs étrangers qui doivent être dirigés en zone occupée et qui ne sont pas encore rassemblés dans les points de concentration fixés… »
Les préfets départementaux, dans un premier temps, déterminent le nombre de Juifs qui sera soumis au regroupement, à partir des déclarations établies par les intéressés courant juillet 1941 et en février 1942. Dans la journée du 25 août, ils convoquent les chefs de service départementaux de la Police et de la Gendarmerie.
Observons le déroulement de l’opération à l’échelle d’un département comme celui de la Lozère. À l’exception de l’agglomération de Mende où la Police prend l’action à son compte, la Gendarmerie opère partout ailleurs. Le total des Juifs à interpeller s’élève à cinquante-quatre. Le plus grand nombre se trouve dans la zone de compétence de la Gendarmerie, réparti dans des villages et hameaux isolés. Le déclenchement de l’intervention est fixé au 26 août, à partir de 4 heures.
En possession des listes depuis la veille, le chef d’escadron commandant la compagnie répartit les missions entre ses commandants de section de Mende, Florac et Marvejols.
Les ordres sont acheminés par estafettes à Florac et Marvejols dans la soirée du 25. Le 26 août, à 4 heures, les gendarmes, dans les trois arrondissements, entrent simultanément en action.
Dans la circonscription de la section de Florac, ceux de la brigade du Collet-de-Dèze, équipés momentanément d’un car à gazogène, se rendent dans la commune de Saint-Michel-de-Dèze, près de Saint-Privat-de-Vallongue, au flanc du col de Pendédis où résident des Juifs polonais, les Fogiel. Ces derniers exploitent un domaine abandonné depuis une trentaine d’années, mis à leur disposition par un hôtelier de Florac. Outre le père Aron (quarante-neuf ans), la mère Rywka (quarante-deux ans), la famille comprend quatre enfants : Lyser (vingt-deux ans), Abraham (dix-neuf ans) Dereck (dix-huit ans) et la petite Sarah (douze ans). Disposant de dix minutes pour préparer quelques menus bagages, les Fogiel se plient aux injonctions des gendarmes. Puis, c’est le départ vers la Gendarmerie de Florac, première étape d’un voyage angoissant vers l’inconnu.
Même heure, même arrondissement, les gendarmes de la brigade de Pompidou interpellent Rodolphe Fridman, hôte d’une famille du Mazel, près de Saint-Etienne-Vallée-Française. À la Gendarmerie de Florac, il retrouve les Fogiel et d’autres Juifs arrêtés au chef-lieu. Le même scénario se répète dans d’autres villages et hameaux.
Dans la soirée du 26 août, sous escorte des gendarmes, les victimes de la rafle sont transférées au camp d’internement de Chirac près de Mende. Le préfet, sur place, veille au bon déroulement des opérations : identification, criblage, etc.
On note un écart sensible entre le nombre des Juifs recensés et arrêtés, trente-six arrestations au lieu des cinquante-quatre prévues. Des Juifs, avertis du danger, ne se trouvent pas à leur domicile au moment du « ramassage ». Quelques autres bénéficient de dérogations, lors du triage, sur présentation de certificats médicaux, etc. Pour compléter le nombre des manquants, les autorités administratives désignent, au hasard, des Juifs affectés dans la compagnie de travailleurs étrangers de Chirac.
Le 29 août, les gendarmes conduisent au camp de Rivesaltes tous les Juifs regroupés à Chirac. Des Pyrénées-Orientales, entre le 2 et le 4 septembre, par trains spéciaux, les Juifs arrêtés en zone libre sont dirigés sur Drancy. Le 1er septembre 1942, le préfet de la Lozère dresse le bilan de l’action conduite dans son département. S’adressant au ministère de l’Intérieur, il écrit :
« Les mesures récentes prises à l’égard de certaines catégories d’israélites étrangers n’ont pas provoqué de réactions spéciales dans l’opinion. Une satisfaction à peu près générale, nuancée parfois d’un peu de compassion, pour des situations de famille particulièrement dignes d’intérêt, a cependant été enregistrée chez ceux qui ne méconnaissent pas la gravité du problème Juif. Certains mêmes souhaitent que l’épuration commencée soit poursuivie mais à la suite de judicieuses discriminations. Dans mon département, la réalisation du plan de regroupement a été assurée sans trop de difficultés et dans des conditions très satisfaisantes… »
D’après le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, les Fogiel ont fait partie du convoi n° 30 qui a quitté le 9 septembre 1942, à huit heures quarante-cinq, la gare du Bourget-Drancy a destination d’Auschwitz. Le convoi formé de Polonais, d’Allemands et d’Autrichiens comprenait 1 000 Juifs dont une centaine d’enfants de moins de 17 ans. Après la descente à Kosel d’environ 200 hommes valides, sélectionnés pour le travail, le convoi arrive à Auschwitz. Nouvelle sélection de 68 femmes et 23 hommes parmi lesquels Aron Fogiel et ses trois fils. Le reste du convoi, soit environ 700 personnes, est immédiatement gazé. Nous sommes le 11 septembre. Épilogue tragique de la participation de la Gendarmerie à la rafle du 26 août : moins d’un mois après leur arrestation, la petite Sarah et sa mère disparaissent dans l’enfer concentrationnaire. En 1945, parmi les 43 survivants du convoi n° 30, on trouve Aron Fogiel et ses trois fils.
Les rafles qui visent les Juifs incorporés dans les groupements de travailleurs étrangers, constitués en décembre 1941, incombent en règle générale à la Gendarmerie car ces formations sont réparties en milieu rural. Outre les travailleurs juifs immigrés, elles comprennent les ressortissants étrangers en surnombre dans l’économie nationale.
La Gendarmerie intervient dans les mêmes conditions qu’au mois d’août 1942, comme le montre le déroulement de l’opération prescrite dans l’Ariège, début septembre 1943, par la préfecture régionale de Toulouse. Vers 19 heures, le 7 septembre 1943, le chef de la 1re division de la préfecture à Foix avise téléphoniquement le chef d’escadron commandant la compagnie pour l’informer que la Gendarmerie est chargée de procéder à 8 heures, le lendemain, à l’arrestation de 52 étrangers israélites incorporés ou rattachés aux groupements de travailleurs étrangers stationnés dans le département, pour les mettre à la disposition de l’organisation Todt. Ce complexe d’équipement et de travaux publics, placé sous les ordres du général Fritz Todt, construit depuis le début de l’Occupation, dans les territoires occupés, des ouvrages défensifs, blockhaus, casemates, obstacles antichars, dont le plus connu est le mur de l’Atlantique. Il a besoin d’une main-d’œuvre considérable prélevée fréquemment dans les camps d’internement.
Le préfet ne délivre aucune réquisition. Il n’y a pas davantage d’instructions écrites. La préfecture se contente de remettre à l’officier la liste des individus à interpeller. Les uns sont placés chez des employeurs privés, les autres sont regroupés au camp d’internement du Vernet d’où ils sortent, chaque jour, sous la conduite de leurs cadres, pour effectuer différents travaux agricoles.
Le chef d’escadron B… donne ses ordres de vive voix au commandant de section de Foix tandis que dans la soirée des estafettes motocyclistes acheminent les instructions aux commandants des sections externes de Pamiers et Saint-Girons. À leur tour, ces derniers les répercutent sur leurs brigades respectives. Dès l’aube, les détachements de gendarmes se mettent en route sur les itinéraires désignés : Bastide-de-Sérou, Castelnau-Durban, Maz-d’Azil, etc. À huit heures, les interpellations commencent. À la mi-journée, tout est terminé. Dans le rapport qu’il adresse au préfet, le commandant de compagnie note :
« Malgré les dispositions prises pour assurer le secret, par suite des absences ou de départs anticipés, 29 arrestations seulement furent opérées. Procès-verbal constatant ces opérations furent transmis à la préfecture à titre de renseignements… »
Ce document nous apprend, par ailleurs, qu’au cours du « ramassage », deux Juifs ont réussi à prendre la fuite. Le préfet demande au commandant de compagnie d’entendre les gendarmes et d’envisager, le cas échéant, la prise de sanctions. Parallèlement, le parquet de Saint-Girons ouvre une information contre X pour complicité d’évasion. L’enquête confiée à la 8e brigade de police de sûreté de Toulouse n’apporte aucun éclaircissement.
L’accélération des événements, au cours du deuxième trimestre 1944, évite aux gendarmes comme aux policiers de participer probablement à l’ultime rafle de grande ampleur, organisée par le secrétaire général au Maintien de l’ordre, qui devait s’appliquer sur une quinzaine de départements de la zone sud.
À peine un mois avant le débarquement, Darnand, par circulaire n° 701/P du 9 mai 1944 prise sous le timbre du secrétariat général au Maintien de l’ordre, planifie une opération d’envergure en vue d’arrêter et de regrouper dans les régions de Limoges, Toulouse et Montpellier les réfugiés espagnols, les israélites français et étrangers du sexe masculin âgés de 18 à 45 ans. Motifs de cette décision : d’une part, la soi-disant activité subversive exercée par les premiers, d’autre part, les sentiments d’hostilité à la politique du Gouvernement manifestés par les seconds.
L’action, prévue initialement à la mi-mai, est différée une première fois. Darnand désigne alors le préfet S… de Toulouse pour la coordonner. Après une entente avec ses collègues, celui-ci fixe au 10 juin la date du « ramassage ». Le 2, il diffuse par télégramme « très secret » ses instructions aux préfets départementaux :
« 1° En raison difficultés d’exécution date de ramassage est fixée au 10 juin.
2° Liste Espagnols à arrêter vous sera remise le 6 juin au plus tard par délégués départementaux service de la main-d’œuvre.
3° Listes israélites devront être remises à l’Intendant de Police pour le 6 juin au plus tard.
Dans le cas où vous ne pourriez respecter ce délai vous prie remettre ces documents à l’autorité chargée d’effectuer cette partie des opérations. Cette autorité est prévenue par soins intendant Maintien de l’ordre.
4° Tous individus ramassés devront être dirigés sur camp Vernet pour Tarn, Haute-Garonne et Ariège, sur Gurs pour autres départements… »
Le général commandant la Gendarmerie de la région de Toulouse, destinataire des instructions du préfet, les répercute pour exécution, dès le 8 juin, aux commandants de légion en précisant que :
« Le ramassage sera effectué dans chaque département, suivant les modalités d’exécution à déterminer par les préfets après entente avec les commandants de compagnies. »
Avec l’ouverture du front de Normandie, le 6 juin à l’aube, d’autres priorités hypothèquent les autorités et les forces du maintien de l’ordre. Les rafles envisagées sont momentanément supprimées qui devaient, selon les estimations, entraîner au minimum deux mille arrestations.
Les Allemands actionnent parfois directement les gendarmes pour exécuter des rafles. Tel est le cas à Rouen, en mai 1942, dans les conditions déjà relatées ou encore dans la région parisienne. Le 5 novembre 1942, le chef du Sipo/SD de Maisons-Laffitte remet au colonel commandant la Gendarmerie de Versailles une liste de 31 Juifs à interpeller dans le département de Seine-et-Oise.
En marge des rafles, toujours sur ordre, les gendarmes se saisissent de Juifs en vertu d’arrêtés d’internement pris par les préfets. Ce type d’arrestations s’applique à des Juifs auteurs d’infractions ou recherchés pour d’autres motifs. Le préfet de la Gironde délivre le 25 juin 1942, à la brigade de Pessac, un arrêté d’internement à l’encontre de Jolles Charles « qui n’a pas souscrit la déclaration imposée par la loi du 2 juin 1941 ».
De même, l’occupant ordonne aux gendarmes des arrestations ponctuelles. Après sa démobilisation, le 13 juillet 1940, Lancu Vexler, médecin juif, reprend son activité à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) où il a son cabinet. Bien qu’interdit par Vichy d’exercer la médecine, il poursuit son activité grâce à l’appui d’un médecin du conseil départemental de l’ordre. Le 20 octobre 1940, probablement à la suite d’une dénonciation, la Kommandantur de Melun enjoint aux gendarmes de Coulommiers de l’arrêter. Le médecin, interné à Drancy, est déporté ensuite à Birkenau d’où il sera libéré en janvier 1945.
* *
*
Créés en 1939-1940 pour recevoir les prisonniers de guerre allemands, par une ironie du sort, les camps de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Royal-Lieu à Compiègne deviennent des lieux provisoires de détention pour les soldats français capturés par l’ennemi au cours des hostilités. À partir de 1941, les autorités françaises les utilisent à une autre fin : elles y parquent les Juifs avant qu’ils ne soient transférés vers les camps d’extermination.
L’ouverture de ces antichambres de la déportation s’échelonne de mai à décembre 1941 : Pithiviers et Beaune-la-Rolande le 4 mai, Drancy le 22 août, Royal-Lieu le 5 décembre.
Par dizaines, des centres analogues, mais affectés à d’autres catégories d’internés, se remplissent dès le mois d’août 1940. 26 fonctionnent en zone sud et 16 en zone nord. On y regroupe les « indésirables » : travailleurs étrangers, ressortissants du Reich, républicains espagnols, tziganes, communistes, gaullistes, trafiquants de marché noir, proxénètes.
Du point de vue de leur statut, les camps sont placés dans les attributions du ministère de l’Intérieur, aussi relèvent-ils de l’autorité des préfets : préfet de police (Drancy) ou préfets régionaux et départementaux (Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Royal-Lieu).
En novembre 1940, les pouvoirs publics constituent un corps de surveillants pour en assurer le fonctionnement et la garde qui comprend des chefs de camp, des secrétaires gestionnaires, des secrétaires, des inspecteurs chefs, des inspecteurs, des brigadiers-chefs, des brigadiers, des gardiens, des agents spéciaux et des médecins. Un crédit de 32 millions, pour l’exercice 1940, est ouvert à cet effet par le Gouvernement sous la rubrique « Frais de surveillance des camps d’indésirables. »
Par suite des difficultés de recrutement, le ministère de l’Intérieur a recours à la Gendarmerie pour renforcer le nouveau corps de fonctionnaires civils déficitaire, sans pour cela lui octroyer des moyens supplémentaires. Il est donc faux de dire que l’ouverture des camps d’internement, selon l’idée avancée par certains auteurs, a été créatrice d’emplois dans la Gendarmerie. Du reste, le plafonnement des effectifs limité à 20 000 hommes en zone nord, imposé par les Allemands, interdisait au Gouvernement de renforcer son potentiel.
La répartition des responsabilités est nette. Les préfets (de police ou départementaux) doivent veiller à la bonne organisation : ravitaillement, état des matériels, service de gardiennage, action des chefs de camps. Ces derniers ont l’entière responsabilité des centres qu’ils dirigent. Ils exercent leur autorité sur tous les fonctionnaires qui y sont employés y compris les personnels de la Gendarmerie appelés à concourir à la garde.
La Gendarmerie a pour mission principale de réprimer et de prévenir toute évasion, d’empêcher les détenus de communiquer avec l’extérieur, d’appréhender les personnes qui chercheraient à entrer en contact avec eux. À l’intérieur des camps, elle se charge de faire respecter la réglementation en l’absence de gardiens civils.
À Drancy, des fonctionnaires ont la haute main sur la direction du camp. Les chefs qui s’y succèdent appartiennent ou ont appartenu à la préfecture de police. Au commissaire S… succède L…, ancien chef de bureau dans les services administratifs, relayé à la fin de printemps 1942 par un commissaire à la retraite, G… En juillet 1943, le SS Aloïs Brunner prend personnellement à son compte la direction du camp.
Les chefs de camp, à Beaune-la-Rolande et Pithiviers, sont au contraire issus de la Gendarmerie. Au moment des rafles de juillet 1942, le chef d’escadron de Gendarmerie en retraite R… dirige celui de Pithiviers. Le 25, il demande à être relevé sur-le-champ de ses responsabilités. D’autres, avant lui, ont interrompu leur mission, toujours sous couvert de raisons de santé. Le motif invoqué officiellement dissimule, en réalité, une répulsion à l’égard du travail qui leur est demandé.
Dans les camps de transit, à l’exception de celui de Royal-Lieu surveillé par les Allemands, la Gendarmerie fournit en totalité comme à Drancy, ou en partie comme à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, les effectifs nécessaires. Les moyens mis en œuvre oscillent entre 125 et 200 gendarmes suivant les camps et les moments. À Beaune-la-Rolande, fin juillet 1942, au dispositif initial constitué de 50 gendarmes s’ajoute un renfort de 75 hommes, soit au total 4 pelotons de provenance diverse (un de la 9e légion, un de Montargis, un de Sologne, un du Loiret), 43 douaniers et 22 gardiens auxiliaires complètent les effectifs. Le personnel de garde à Pithiviers comprend 4 pelotons dont un de la 4e légion plus 57 douaniers et 53 gardes auxiliaires.
Le premier détachement de Gendarmerie mis en place à Drancy, fort de 4 officiers et de 120 gendarmes, atteindra l’effectif de 200 hommes. Il est placé sous le commandement du capitaine Lombard. Le 1er juillet 1942, le capitaine Vieux lui succède avant d’être remplacé, fin septembre, par le capitaine Richard. Lorsque le lieutenant Cannac assure la relève en juin 1943, Brunner relègue la totalité des gendarmes à la surveillance externe du camp.
Le 26 août 1941, l’amiral Bard, préfet de police et le général Guilbert, commandant la Gendarmerie de la région de Paris, signent le document établi conjointement intitulé « Consignes » qui instaure un véritable régime de discipline militaire. Le règlement impose aux internés l’observation des marques extérieures de respect, salut en particulier envers les personnels de surveillance et les autorités allemandes militaires ou de police. Le lendemain 27, sous la présidence du conseiller Lippert de l’administration militaire allemande, une réunion se tient au camp à laquelle assistent le SS Dannecker, les représentants de la préfecture de police (M. François, directeur de l’administration générale, les commissaires Lefèbre, Oudart, David), de la préfecture de la Seine et de la Gendarmerie (chef d’escadron Bézanger, capitaines Chenu et Lombard) en vue d’approuver le règlement intérieur édicté la veille et de définir les responsabilités des partenaires ayant en charge le camp. Très soucieux de la sécurité, les Allemands décident exceptionnellement de compléter l’armement des gendarmes par 35 mousquetons et 10 cartouches par hommes.
Si dans leurs rapports quotidiens avec les internés juifs le comportement des militaires de la Gendarmerie, dans l’ensemble, ne donne lieu à aucun reproche, il n’en est pas de même, malheureusement, d’un certain nombre qui appliquent les consignes de façon inhumaine en se montrant d’une brutalité inadmissible et odieuse. Quelques autres encore se livrent à un marché noir éhonté ou à des pratiques non moins déshonorantes au point qu’ils font l’objet de poursuites et de condamnations devant les tribunaux.
Plusieurs rescapés de Drancy, à la Libération, déposent plainte devant la Cour de Justice de la Seine contre quinze officiers et gendarmes ayant appartenu aux détachements affectés à la garde du camp. Au terme de l’instruction ouverte sous le chef d’inculpation « d’intelligence avec l’ennemi », dix sont renvoyés devant la Cour de Justice « pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État ». Le 22 mars 1947, la Cour rend son arrêt et prononce sept condamnations assorties d’attendus sévères.
* *
*
Début juillet 1942, Bousquet accorde le concours de la Gendarmerie à la police allemande pour escorter, jusqu’à la frontière du Reich à Novéant (Moselle), les Juifs rassemblés dans les camps de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Compiègne.
Le 7 juillet, l’adjoint d’Oberg informe le M.B.F. des dispositions prises et lui demande de fournir pour chaque convoi un élément d’accompagnement de la Feldgendarmerie.
Dès le lendemain, au cours d’une conférence à laquelle participe Darquier de Pellepoix, Dennecker confirme aux autorités françaises que « la surveillance des trains sera assurée par la Gendarmerie française, sous le contrôle d’un commando allemand constitué d’un lieutenant et de huit hommes de la Feldgendarmerie. » Il subordonne le détachement de gendarmes français à l’officier allemand responsable de bout en bout de la direction des opérations de surveillance. Le 18 juillet, le préfet de police reçoit des précisions sur l’effectif de l’escorte : 1 homme pour 40 « voyageurs ».
Avant l’embarquement, des inspecteurs de police fouillent les Juifs pour rechercher éventuellement armes et outils dont ils pourraient être en possession.
Pendant le trajet, les gendarmes surveillent le train, répartis en trois groupes, généralement de 10 hommes, disposés dans les wagons de voyageurs. À la suite de tentatives d’évasions, les Allemands exigent la présence d’au moins trois gendarmes dans les wagons d’hommes, placés respectivement près des deux portes, l’une plombée, l’autre entrouverte, et de l’ouverture d’aération. À chaque arrêt, l’escorte se range en cordon tout le long du train. Les militaires allemands occupent les postes de freinage (vigie, serre-frein). Tout incident qui se produit au cours du déplacement donne lieu, de la part du chef du commando allemand, à un rapport.
Pendant 9 mois, de juillet 1942 à mars 1943, date à laquelle Oberg décide que les transports des Juifs vers l’Est seraient effectués exclusivement par les forces de police allemande, les gendarmes assurent l’escorte de 44 convois (convoi n° 7 à convoi n° 51 inclus). 1 400 hommes participent à ces missions émaillées d’incidents.
Le 13 février 1943, entre les stations de Nançois-Tronville et Ernecourt-Loxeville, 8 Juifs s’évadent du convoi n° 48, parti de Drancy, qui regroupe 998 personnes dont 80 enfants. L’escorte comprend 1 officier et 30 gendarmes français. Côté allemand, 15 policiers de la Schupo aux ordres du lieutenant Nowak. D’après le rapport daté du 15 février 1943, établi par l’officier allemand, l’évasion est imputable « à une défaillance complète de la Gendarmerie française, par négligence ou volontairement, éventuellement par corruption… » Les Juifs ont pris la fuite à travers un grand trou scié dans le garde-boue d’un wagon, sous les yeux des gendarmes. Le lieutenant Nowak a relevé le nom des sous-officiers mis en cause. Le 10 mars, la Sipo/SD, service IV B de Paris réclame à Leguay, délégué du secrétaire général pour la police en zone nord, un rapport sur le comportement de l’escorte.
« Je désire, écrit-il, que ce rapport me soit présenté au plus vite, en mentionnant nommément les fonctionnaires de la Gendarmerie concernés. »
Les services de Leguay demandent le 26 mars un rapport au commandement de la Gendarmerie sur cette évasion. La réponse parvient le 20 avril qui dégage la responsabilité des personnels de l’escorte.
Dans le convoi n° 47, parti du Bourget à 10 h 15 le 9 février, composé d’un contingent de 1 000 Juifs, en très grande majorité étrangers, dont 123 enfants âgés de moins de 12 ans, tout se passe normalement jusqu’à Châlons-sur-Marne. Il est environ 16 heures, selon le rapport du lieutenant Nowak de la police de protection, chef du commando d’escorte, lorsque 11 détenus s’échappent d’une voiture au moment où le train entre lentement en gare :
« Je ne pus autoriser de coups de feu en pleine gare, le trafic des civils étant très grand. Cependant, en dehors de la gare, 4 coups furent tirés par un fonctionnaire de la Gendarmerie française. Nous parvînmes à rattraper 7 hommes et une femme. 3 détenus étaient en fuite. La Gendarmerie française de Châlons-sur-Marne a aussitôt été informée. Une nouvelle évasion se produit en pleine voie après Châlons. Le chef de la Gendarmerie française qui se trouvait dans le dernier wagon tira aussitôt le frein de secours. Le fuyard juge inutile de continuer, plusieurs coups de feu ayant été tirés pour le stopper. »
L’officier conclut :
« La collaboration avec la Gendarmerie française était bonne. Les fonctionnaires français s’employèrent à fond à rattraper les fuyards. »
Dans la soirée, les gendarmes de Châlons-sur-Marne arrêtaient 2 Juifs évadés du convoi.
En liaison avec Leguay, Rothke arrête, dès le 28 juillet, les modalités de transport dans les camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande, des Juifs devant être arrêtés en zone libre. À ce sujet, il écrit :
« Les trains seront accompagnés jusqu’à la ligne de démarcation par la Gendarmerie française de zone non occupée et seront ensuite remis à des commandos de Gendarmerie de zone occupée (effectif de chaque commando : 1 officier et 40 gendarmes). »
La relève d’escorte des détachements de Gendarmerie s’effectue, la plupart du temps, à Chalon-sur-Saône, plus rarement à Vierzon. Au passage de la ligne, le chef d’escorte des trains de zone libre remet à son correspondant de la zone occupée 5 listes des personnes convoyées destinées, dès l’arrivée à Drancy, aux autorités allemandes.
En zone nord comme en zone sud, la Gendarmerie agit sur réquisition des préfets. La forme des réquisitions ne varie pas, qu’elles s’adressent aux commandants de légion ou de compagnie. Ainsi, le 29 juillet 1942, le préfet régional d’Orléans saisit en ces termes le commandant de la 5e légion :
« Au nom du peuple français,
Nous, J. Morane, préfet régional d’Orléans, requérons en vertu de la loi même, le commandant de la 5e légion de Gendarmerie de prêter le concours des troupes nécessaires pour escorter un convoi d’israélites du camp de Pithiviers (Loiret) jusqu’à la frontière allemande. »
De même, le 2 février 1943, le préfet de la Gironde requiert « Monsieur le chef d’escadron de Gendarmerie de provoquer la réunion du nombre de gendarmes nécessaires pour escorter un convoi d’israélites transférés du camp de Mérignac à Drancy le 2 février 1943 ».
La Gendarmerie n’est pas à l’aise dans le rôle que le régime et l’occupant lui assignent pour mener à bien leur politique raciste. Le commandement ne le dissimule pas. Courant 1943, un chef de corps évoquant le « ramassage des israélites » note qu’il s’agit « de missions pénibles ». Un autre parle de « missions inhabituelles et délicates ». Un troisième souligne « le trouble créé dans les esprits par ces opérations ». On lit sous la plume d’un quatrième « que la mission a été exécutée par devoir et sans entrain ». Ces appréciations ne sont que le reflet de l’état d’esprit des personnels désorientés par les tâches qu’on leur demande d’accomplir.
Que penser de la circulaire du 9 février 1944, émanant du secrétaire général à la Main-d’œuvre, prévoyant la mise à la disposition des autorités d’occupation du plus grand nombre d’étrangers possible ainsi que des oisifs à dépister à tout prix, imposant à la Gendarmerie l’établissement, dans chaque commune, des listes des individus à arrêter ?
Malgré tout, la notion de devoir, fortement enracinée dans les esprits, incline des gendarmes à ne pas se détourner de leur mission. Deux cas révélateurs en témoignent.
Courant janvier 1944, un détachement de Gendarmerie transfère, par voie ferrée, du camp de Septfonds (Tarn-et-Garonne) sur Lorient (Morbihan), 280 travailleurs étrangers, Juifs et réfugiés républicains espagnols, pour les remettre à l’organisation Todt. Le capitaine commandant l’escorte, forte de 108 hommes, en conclusion de son rapport de fin de mission, traduit son sentiment :
« Malgré une certaine répugnance à remplir semblable mission, cadres et exécutants ont eu constamment à cœur d’obéir aux ordres et de faire en soldats, c’est-à-dire sans hésitation ni murmure, leur devoir dans des circonstances exceptionnelles… »
Autre exemple, celui de ces deux gendarmes qui viennent d’arrêter, dans un petit village, un Juif et sa famille. Au cours de leur transfèrement les deux sous-officiers leur tiennent ce propos :
« Que voulez-vous, ce sont les ordres, il nous faut obéir, nous, on est des soldats, on exécute. Les responsables, ce sont ceux qui décident, les hommes politiques. »
D’autres réactions confirment le malaise qui habite les exécutants. Le contrôle postal de la Lozère intercepte en 1943 la lettre d’un gendarme de ce département déplacé au camp de Rivesaltes où l’administration de Vichy regroupe les Juifs arrêtés en zone sud avant de les transférer sur Drancy. À l’ami auquel il s’adresse, il confie :
« Nous assistons à des scènes qui n’ont rien d’agréable pour nous. »
Au camp des Milles, un an plus tôt, un pasteur présent au milieu des Juifs internés rapporte que « les gendarmes sont blessés par le spectacle de la séparation des parents et des enfants ».
Selon un article publié dans le Times du 24 septembre 1942, « les gendarmes n’obéissent qu’avec la plus grande répugnance aux ordres d’arrestations des Juifs. »
* *
*
Pour justifiées que soient les critiques légitimes adressées à la Gendarmerie, pour sa participation à l’exécution des mesures antisémites et aussi regrettable que soit la conduite méprisable de quelques égarés, on ne saurait confondre tous les gendarmes dans l’opprobre.
Le pasteur de l’Église Réformée, Idebert Exbrayat, nommé à Rodez en 1938, a apporté aux Juifs persécutés, pendant l’Occupation, un soutien inlassable pour les sauver de la déportation. Placé dans ces circonstances en relation avec quelques gendarmes, il témoigne de leur compréhension :
« Ils sont naturellement disciplinés. Mais, je sens qu’au-delà de la prudence et de la discrétion, l’amour de la France meurtrie et humiliée, passe avant un service servile. Je pourrai compter sur eux. »
Des gendarmes, en plus grand nombre qu’on ne le suppose, ne se satisfont pas seulement de compassion à l’égard des Juifs. Tout en se gardant à couvert, ce qui n’exclut pas des risques graves, ils leur manifestent une solidarité agissante.
L’exigence de vérité commande de signaler avec force leur attitude malheureusement ignorée. Leur effort est dans la ligne de celui accompli par les Français qui a permis, selon les estimations, de sauver près de 274 000 Juifs sur les 350 000 qui vivaient en France en 1939.
L’État d’Israël a non seulement tenu à rendre un solennel hommage à ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant la période de l’Holocauste en Europe, mais encore à perpétuer leur souvenir. Ainsi a-t-il créé en 1953, par voie législative, le titre de Justes des Nations qui confère aux personnes qui sont distinguées la médaille des Justes parmi les Nations et les autorise à planter un arbre en leur nom au Mémorial national Yad Vashem à Jérusalem, dans l’avenue des Justes, au centre de ce Mont du Souvenir où six millions de grands caroubiers – un pour chaque martyr – attestent l’étendue du crime hitlérien mais aussi l’espérance. Une commission présidée par un juge de la Cour suprême désigne les Justes sur la foi des témoignages délivrés par les rescapés.
Parmi les quelque 8 000 personnes honorées en Europe, dont un millier de Français, figure un très petit nombre de sous-officiers de Gendarmerie, tous inconnus, dont les noms sur le tableau du souvenir, dans le vaste mausolée de Yad Vashem côtoient ceux d’éminentes personnalités comme celles du cardinal Saliège, du pasteur Boegner et du père Chaillet.
Il s’agit des gendarmes Camille Mathieu, Raymond Rigaud, Alain Bonneau (brigade de Chauvigny) et des chefs Étienne Roch, Marcellin Cazals et Camille Thibault (brigade de Pleumartin)… Les listes ne sont pas closes et sont susceptibles de s’enrichir, pour peu que se manifestent des rescapés de l’holocauste.
Gendarme en 1941, au détachement de garde du camp de Drancy, Camille Mathieu aide clandestinement les internés : acheminement de courrier, fourniture de ravitaillement. À l’insu des autorités, il en inscrit plusieurs sur la liste des détenus souffrant d’œdème grave et de dysenterie réussissant ainsi à les faire libérer. Par la suite, il leur procure de faux papiers et leur fait franchir la ligne de démarcation. Avec son épouse, il multiplie les opérations de ce type. Cela lui vaut d’être repéré et sanctionné. Révoqué, il ne revêtira jamais plus l’uniforme.
Raymond Rigaud, retraité à Gaillac en 1942, assure le secrétariat du commissariat de police. Avant toutes les rafles, il prévient les familles juives réfugiées dans le secteur.
Pour sa part, Étienne Roch sauve deux étudiants promis aux camps de la mort. Le 3 novembre 1942, en poste à la brigade de Mont-Saint-Martin, près de la frontière de la Belgique et du Luxembourg, il interpelle en plein jour, dans une rue de l’agglomération, deux jeunes gens étrangers à la localité semblables à des vagabonds et dépourvus de pièces d’identité. Ils sont juifs et viennent de sauter d’un train en partance de Drancy à destination d’Auschwitz. Le gradé les conduit à la brigade comme s’ils étaient en état d’arrestation. Il les dépose même à la chambre de sûreté. Là il les réconforte : « Ils mourraient de faim, écrit-il, ma femme leur a donné tout ce que l’on avait ». Puis, il leur annonce qu’à la tombée de la nuit il leur ouvrira les portes pour qu’ils puissent s’enfuir. Dans la soirée, comme convenu, Théo et Hans Catz recouvrent la liberté. Étienne Roch les attend à l’extérieur de la caserne où il leur donne toutes les explications nécessaires pour franchir sans risques la frontière belge et gagner Liège comme ils en avaient l’intention. Les deux rescapés réussissent à rejoindre respectivement l’Angleterre et l’Italie.
Par centaines, des gendarmes ont contribué au sauvetage des Juifs. Il est bon de le rappeler pour que leur conduite exemplaire ne tombe pas dans l’oubli.
Parfois c’est grâce à leur inertie que des Juifs échappent à la déportation. En Gironde, en octobre 1942, les gendarmes de Lacanau, en service à la gare, aperçoivent sur le quai Joseph Schaffer, jeune médecin recherché en vertu d’un arrêté d’internement pris par le préfet. Ils feignent de ne pas le voir et le laissent filer. Le fuyard rejoint l’Afrique du Nord. Il évite l’internement au camp de Mérignac, prélude au transfert sur Drancy, dernière étape avant les camps d’extermination.
Le comportement des gendarmes de Tence (Haute-Loire) procède du même état d’esprit. En 1942, la C.I.M.A.D.E. (comité Inter-Mouvement auprès des Évacués) ouvre un centre d’accueil « Le Coteau fleuri », près de Chambon-sur-Lignon, accrédité pour recevoir des Juifs (vieillards, femmes ayant de jeunes enfants, malades) internés dans différents camps : Gurs, Le Vernet, etc. Les intéressés pris en charge par le centre restent néanmoins sous la surveillance de la police. Lorsqu’en août 1942 les Juifs de la zone libre commencent à être déportés, les gendarmes, au début peu compréhensifs, voire même intransigeants, se convertissent sous l’influence de la population favorable aux proscrits et font preuve de complaisance, comme le rapporte un témoin :
« Quand les gendarmes de Tence recevaient un ordre d’arrestation, ils prirent l’habitude de traîner bien visiblement sur la route, de faire halte au café avant d’aborder le raidillon du coteau en disant très fort qu’ils allaient arrêter quelques-uns de ces « sales Juifs ». Un poste de guet aménagé dans un monceau de fagots, devant la maison, donnait l’alarme. À l’arrivée des gendarmes, les internés avaient disparu. »
D’autres gendarmes apportent aux Juifs un soutien actif en les alertant des dangers qui les menacent. Une secrétaire à la préfecture de la Creuse, agent de renseignement de la Résistance, évoquant l’attitude des gendarmes de Guéret note :
« Les gendarmes prirent l’habitude de me prévenir quand un ordre de rafle arrivait jusqu’à eux. Un jour, ils allèrent chercher un Juif polonais qui travaillait dans une ferme. Cet homme s’obstinait à rester sur place. Les gendarmes, dans le chemin, le rencontrèrent. Ils s’écartèrent pour le laisser passer. À la ferme, ils posèrent la question rituelle :
« Où est X qui travaille chez vous ? La fermière, embarrassée et fort rougissante, répondit : « Il est parti depuis longtemps. » Les gendarmes : « Ne vous en faites pas ma bonne dame, on vient de le voir passer ». Reprenant un air officiel et sortant son carnet, le brigadier écrivit : « Monsieur X parti le… ». Il referma son carnet et salua. Ils s’en allèrent comme ils étaient venus ». »
À Paris, le capitaine Quivaux, commandant la section d’Exelmans, quelques jours avant la rafle du 16 juillet 1942, informe une bonne dizaine de gendarmes, les plus sûrs, que les Juifs déjà recensés vont recevoir une convocation pour se rendre au commissariat le 16 au matin. D’autres seront arrêtés à leur domicile pour éviter les fuites :
« Si vous en connaissez, leur dit-il, allez les prévenir discrètement de se soustraire à la rafle. Ils doivent être internés administrativement, des camps seront aménagés pour les recevoir. Surtout, soyez discrets. »
Les gendarmes Lefourn (1er), Omnès (14e), Darolles (15e) ainsi que des militaires du 1er et du 18e divulguent l’information à plusieurs familles (commerçant, médecins, etc.).
Le 23 février 1943, la préfecture de la Lozère donne l’ordre à la Police et à la Gendarmerie d’arrêter les israélites étrangers et de les conduire au camp de Gurs. Le chef Cazals, au Malzieu, relate les conditions de son intervention :
« Le 23 février, la brigade est, pour quelques jours, à l’effectif de trois unités. À 9 heures, seul au bureau, je reçois un message chiffré. Je le décode. L’ordre est donné d’arrêter les israélites du sexe mâle de 18 à 50 ans et de rendre compte dès la fin des opérations. En résidence dans la localité, une trentaine de personnes sont touchées par cette mesure. À proximité de la brigade, réside Mme Janoveski. Je me rends auprès d’elle et lui fais connaître le but de ma visite. Je l’invite à prévenir immédiatement ses amis susceptibles d’être concernés par les arrestations. Je lui recommande la discrétion. »
Pas un Juif n’est arrêté ce jour-là. Le commandant de section reçoit un compte rendu néant. Tout paraît se terminer pour le mieux. Pourtant, le 10 mars, une lettre anonyme adressée au préfet de la Lozère lui signale que le commandant de brigade du Malzieu n’a arrêté aucun Juif alors qu’un grand nombre réside dans le canton. Le capitaine Caubarrus chargé de l’enquête émet en conclusion l’hypothèse d’une indiscrétion des services de la préfecture, avant le déclenchement de l’opération, qui expliquerait la carence de la Gendarmerie. Toujours le 23 février, à la brigade de Vialas (Lozère), le chef Salager et le gendarme Pellet alertent la famille Juilliard et celle du docteur Klinghifer en résidence à la Planche.
À la même époque, le gendarme L…, de la brigade du Collet-de-Dèze (Lozère), sachant que le docteur Weill Spire figure sur les listes des Juifs à interpeller, se rend la veille à son domicile pour l’avertir et lui conseiller de se réfugier chez des amis sûrs jusqu’à ce que le danger soit passé. Rien ne lui laisse présager la scène qui va suivre. Le médecin ouvre la porte. À la vue du gendarme, qui pense-t-il vient l’arrêter, il sort de sa poche une petite boîte et, d’un geste rapide, en avale le contenu. Quelques instants après, il sombre dans un coma profond. À ses amis, quelque temps auparavant, il avait confié que, si « des commis de la Gestapo venaient le chercher, ils ne le prendraient pas vivant ». Grâce aux soins qui lui sont prodigués, il sortira indemne de cette méprise tout en échappant à la déportation.
À Lodève (Aude), le chef Gillid, secrétaire du commandant de section, prévient le 25 août 1942 plusieurs familles juives de la rafle qui doit avoir lieu le lendemain. Son initiative sauve une quarantaine de personnes.
Le 4 novembre 1943, les Allemands organisent une rafle dans la Creuse. L’adjudant Maxime, de Felletin, a connaissance de l’opération. Il en fait part à 32 Juifs domiciliés dans le canton.
L’adjudant Lanusse, commandant la brigade de Pons (Charente-Maritime), reçoit l’ordre le 31 janvier 1944 d’arrêter, entre 3 heures et minuit le lendemain, les huit membres de la famille Israël. Il envoie un messager pour les alerter.
Dans le Puy-de-Dôme, les gendarmes de Champeix, commis par les Allemands pour arrêter les Juifs en résidence forcée à Saint-Nectaire, s’arrangent pour les alerter avant de se rendre sur place. Lorsqu’ils y arrivent, ils sont introuvables.
À Bourg-de-Visa, en mai 1943, le gendarme Lasgleyses confie le soin à son épouse de se rendre, à 4 heures du matin, chez la famille juive Leserlot pour lui annoncer qu’elle doit être arrêtée dans la matinée.
Parfois, les gendarmes, comme à Issoudun (Indre), sont en liaison étroite avec des responsables de la communauté juive. Ainsi renseignent-ils M. Fredemberg avant toute opération de police. C’est également le cas à Graulhet (Tarn) où en octobre 1942, l’adjudant Farsac, commandant la brigade, signale à M. Gamson, dirigeant de l’U.J.I.F. l’arrestation imminente par la Gestapo de 24 Juifs. Tous échappent à la rafle.
Madame Sylvie Landau-Schaub, alors âgée de 11 ans, réfugiée à Saint-Germain-de-Calberte (Lozère) rapporte de quelle façon ses parents ont été alertés par les gendarmes.
« Au printemps 1943, un gendarme est venu alerter ma mère et lui a confié : « Nous avons ordre de rafler les personnes qui sont réfugiées à Saint-Germain, il faut prévenir votre mari qui est dans la coupe de bois… » Les gendarmes savaient tout à Saint-Germain. Ma mère leur a dit alors la vérité : « Mon mari et moi, nous rejoignons le Vercors comme il était prévu, mais la petite reste là et on vous la confie. » »
Des gendarmes non seulement renseignent en temps utile les Juifs recherchés, mais ils leur donnent asile ou leur trouvent un refuge. En 1943, une famille pourchassée par la Gestapo arrive à La Salvetat-Peyralès (Aveyron). Le chef Planeilles, au lieu de rendre compte aux autorités, la prend en charge et la confie à une famille sûre de Lunac. Elle y reste en sécurité jusqu’à la Libération.
À Faverges (Haute-Savoie), le gendarme Marius Bachet reçoit l’ordre de mettre à exécution un arrêté d’internement applicable à M. Weingarter, israélite astreint à résidence forcée dans la commune. Il l’avertit. Le malheureux, les larmes aux yeux, demande ce qu’il va devenir. Marius Bachet l’accompagne le soir même, chez un de ses amis, à Giez, qui accepte de le cacher le temps qu’il faudra.
Courant mai 1944, en Dordogne, la Gestapo offre une prime de 100 000 francs à toute personne qui dénoncera la famille juive P… activement recherchée. Or celle-ci réside à Thiviers. Dès qu’il a connaissance de cette information, le chef Foucher l’accueille dans son logement où elle bénéficie d’une meilleure sûreté avant de lui trouver une cachette définitive.
À partir du 15 janvier 1944, le chef Cazals, au Malzieu (Lozère) héberge à la caserne, dans des conditions similaires, pendant quinze jours, Mme Moletk et sa fille traquées par la Gestapo.
Pour soustraire aux recherches de la police allemande deux familles juives de Paris, réfugiées dans les Basses-Pyrénées, l’adjudant Bourda, de la brigade de Lançon, les cache dans une maison qui lui appartient, du mois de juin 1943 à la Libération.
L’adjudant Savignat, commandant la brigade de La Souterraine, fin 1943, donne asile à des Juifs dans son logement. Dénoncé par le chef départemental de la Milice, il réussit à se disculper.
Informé, fin juin 1942, de l’arrestation imminente d’un Juif polonais, le gendarme Bousquet, de la brigade de Saint-Martin-de-Londres (Hérault), se met en rapport avec une infirmière qu’il connaît et le fait hospitaliser.
Au mois de mars 1943, avec la complicité de la directrice de la maison de retraite de la Tour-Blanche (Dordogne), le chef Escure, commandant la brigade de la localité, met à l’abri, dans cet établissement, deux Juifs, dont l’ancien bâtonnier des avocats de Vienne (Autriche), poursuivis par la Gestapo de Périgueux.
Le capitaine Guiochon, commandant la section d’Agen, dissimule chez lui, pendant dix jours, un israélite recherché par la police allemande.
On relève une autre forme de sabotage des ordres qui profite aux Juifs, sans qu’ils en aient connaissance. Dans plusieurs départements, en novembre 1943, les préfets prescrivent aux commandants de compagnies de leur adresser la liste des étrangers en résidence dans leurs circonscriptions, mesure qui équivaut à effectuer un nouveau recensement. Les brigades ne se comptent pas qui répondent par la négative alors que des réfugiés juifs, de nationalité étrangère, y séjournent depuis des mois.
Comme son homologue du Malzieu le chef Cazals, le commandant de la brigade de Saint-Germain-de-Calberte établit un compte rendu néant. Pourtant, dans ce canton retiré des Cévennes, cinquante Juifs français et étrangers ont trouvé asile après les rafles de l’été 1942. Au chef-lieu, à l’hôtel Martin, près de la Gendarmerie, ils sont une trentaine de tous âges, hommes, femmes, enfants et vieillards. Les gendarmes les ignorent et conservent un mutisme absolu lors des raids de la Gestapo et de la Milice. Le chef Salager, dans le canton limitrophe de Vialas, est au courant de la présence d’au moins soixante Juifs dans son secteur. Jamais il ne les signale à la préfecture.
En réalité, plus de mille Juifs se cachent en Lozère depuis le début des persécutions raciales. Avec la complicité de la population, et grâce à la passivité de nombreux gendarmes, ils ne sont pas inquiétés. Lorsqu’on rapproche ce chiffre de celui des Juifs arrêtés par la Gendarmerie qui s’élève à une soixantaine, il faut se rendre à l’évidence et admettre que tous les personnels n’ont pas obéi aveuglément aux ordres. En Dordogne, en Corrèze, dans le Cantal, la Haute-Vienne, l’Indre, l’Aveyron, etc. pour ne citer que quelques départements refuges, la population juive bénéficie d’un soutien comparable à celui que lui offre la Lozère.
Des gendarmes, volontairement, ne réagissent pas à l’évasion de Juifs qu’ils sont chargés de transférer lorsqu’ils ne provoquent pas eux-mêmes leur fuite. En 1943, le chef d’escadron commandant la compagnie de l’Ain punit de 15 jours d’arrêts le gendarme Birgy pour le motif suivant :
« A laissé s’évader une vingtaine de Juifs ». L’officier le réprimande sévèrement et lui tient ce propos : « Si les Allemands vous amènent des Juifs, ce n’est pas pour que vous les laissiez foutre le camp. D’ailleurs, je suis sûr que vous les avez aidés. Votre brigade bat tous les records d’évasions. »
Une punition, sanctionne, le 1er septembre 1942, les gendarmes Lermite et Petit de la brigade d’Eygurande (Corrèze) « pour avoir facilité l’évasion d’un israélite qu’ils étaient chargés de transférer. »
Dans la matinée du 25 février 1943, des éléments policiers étrangers à la localité arrêtent à l’hôtel Atger, à Saint-Chély-d’Apcher (Lozère), le docteur Bromberg. Ce dernier profite d’un moment d’inattention de ses gardiens pour leur fausser compagnie. Il quitte l’agglomération en empruntant un transport public pour se rendre au Malzieu où il pense pouvoir se dissimuler. À peine est-il arrivé à destination qu’une patrouille de Gendarmerie, avisée de son évasion, l’intercepte. On le dépose à la chambre de sûreté. Sur ces entre-faits, le commandant de brigade, le chef Cazals, momentanément absent, est de retour à la caserne. Il apprend les circonstances de l’évasion de M. Bromberg, puis celles de son arrestation par ses subordonnés. Avant que ne se produise l’irréparable, il rend immédiatement sa liberté au médecin juif.
Les gendarmes, d’ordinaire si méthodiques, égarent des documents administratifs qui permettent de sauver des enfants en péril. À la veille de la rafle du 26 août, en zone libre, les dirigeants des éclaireurs israélites juifs (E.I.F.) ont envoyé leurs 200 pupilles camper dans la Creuse. Comme par hasard, les gendarmes ne retrouvent pas les sauf-conduits indiquant leur lieu de séjour.
Quatorze adolescents recherchés, appartenant à ce groupe, sont dirigés sur l’évêché de Tulle qui les cache.
Pour faciliter le déplacement et la vie des Juifs soumis à des contrôles incessants, des gendarmes leur procurent des documents administratifs. En cas de danger, le lieutenant commandant la section du Vigan (Gard) leur distribue de fausses cartes d’identité confectionnées par le pasteur Gillier avec la complicité d’un secrétaire de mairie.
À la section de Castelnaudary (Aude), le lieutenant Chabert établit, en mai 1943, une carte de circulation pour M. Jackobson, menacé par la Gestapo. Il s’éloigne du département sans difficulté.
Le chef Cazals transgresse la réglementation en fournissant à plusieurs dizaines de Juifs des sauf-conduits d’une validité de trois mois pour gagner les Alpes-Maritimes, zone occupée par les Italiens opposés aux persécutions. À partir du 8 septembre 1943, les huit départements placés sous leur contrôle passent aux mains des Allemands. La région devient alors une souricière pour les milliers de Juifs qui s’y trouvent. Brunner quitte Drancy pour ratisser la région niçoise où les rafles se multiplient.
Le commandant de section de Perpignan, le capitaine Barbe, délivre, en 1942 et 1943, plus d’une centaine de laissez-passer et de sauf-conduits à des Juifs à destination de la frontière pyrénéenne.
Comme le gendarme Bachet à la brigade de Faverges (Haute-Savoie), dans d’autres formations, nombreux sont ceux qui remettent régulièrement des cartes de rationnement à des Juifs en difficulté. Dans le Lot un commandant de brigade fournit, à un Juif recherché, un livret militaire en dépôt à la Gendarmerie. Cette pièce permet par la suite à son détenteur d’échapper à l’internement.
Aux frontières, des gendarmes prennent des risques personnels en fermant complaisamment les yeux sur ceux qui tentent leur chance pour rejoindre l’Espagne ou la Suisse. En décembre 1942, le docteur Lévy et son épouse décident de gagner clandestinement l’Espagne par les Pyrénées. En provenance de la Creuse, ils arrivent à Arreau (Hautes-Pyrénées). Contrôle de Gendarmerie. On les laisse passer. Une patrouille allemande les intercepte au sud de l’agglomération. Ils tentent de se justifier en indiquant que les gendarmes viennent de les contrôler. Les Allemands demandent des comptes au chef de poste, fort embarrassé pour répondre. Finalement, celui-ci explique qu’au moment du passage des Lévy au poste de contrôle l’affluence était telle que les gendarmes ne les avaient pas aperçus. Sans doute les avaient-ils confondus avec des gens de la ville.
Pour égarer les recherches visant les Juifs, les gendarmes n’hésitent pas à adresser aux autorités des procès-verbaux fictifs. En décembre 1941, à Nexon (Charente), le gendarme Glomot fait franchir la ligne de démarcation à deux israélites en provenance des territoires occupés. Il établit ensuite une procédure de refoulement, alors qu’en réalité il les a dirigés vers la zone libre. Des procès-verbaux de recherches infructueuses clôturent maintes investigations bien que les gendarmes connaissent le refuge des proscrits.
Combien de Juifs, sans le savoir et qui ne le sauront jamais, doivent la vie à ces gendarmes anonymes qui ont su fermer les yeux sur leur présence ou se taire en ne les signalant pas aux autorités ou encore les alerter par personnes interposées des dangers qui les menaçaient. Pourtant, ils n’ont vu souvent dans ces exécutants que des fonctionnaires soumis au régime.
L’image réconfortante de ces hommes qui, dans ces temps de ténèbres, ne sont pas restés inactifs face au malheur des Juifs ne peut cependant faire oublier les souffrances que d’autres leur ont occasionnées en appliquant aveuglément les ordres. Le comportement des premiers, même s’il n’a pas modifié le cours des événements, n’en a pas moins été salutaire. Il a valeur d’exemple.
Dans le département de la Corrèze, à partir de novembre 1942, la Gendarmerie est soumise à rude épreuve. Ce fief de la Résistance, où la répression allemande se manifeste sauvagement, constitue un champ d’observation qui reflète la situation de la Gendarmerie dans son ensemble. On y constate les pressions extrêmement fortes qu’elle subit, tant de la part de la Résistance, que de l’occupant et de l’administration de Vichy.
La structure de la Gendarmerie, en Corrèze, ne se différencie pas de celle des autres départements. À Tulle, siège l’organe de commandement de la compagnie rattachée à la légion du Limousin. L’unité, placée sous l’autorité d’un chef d’escadron, se compose de trois sections (Tulle, Brive, Ussel) comprenant respectivement quatorze, onze et huit brigades. En 1943, l’effectif s’élève à deux cent quatre-vingts hommes (cinq officiers et deux cent soixante-quinze gradés et gendarmes).
CHAPITRE 15 – EN ZONE TROUBLÉE
Courant juillet 1943, la direction crée, à Brive, une école préparatoire, installée à la caserne Brune. En quelques mois, elle passe de trois à six compagnies d’élèves-gendarmes de cent vingt hommes chacune. Cette formation ne joue aucun rôle en matière de sécurité publique. Elle se consacre exclusivement à l’instruction jusqu’au 17 juin 1944. À partir de cette date, le secrétaire général au Maintien de l’ordre dirige les compagnies sur Nancy (deux), Châlons-sur-Marne (une), Versailles (deux) et Dijon (une), afin d’y relever les forces chargées de la protection de points sensibles.
Pour faire régner l’ordre, le préfet de la Corrèze s’appuie principalement sur la Gendarmerie qui quadrille le département avec ses unités territoriales. La Police nationale, avec des effectifs plus modestes, n’est présente qu’à Tulle, Brive et Ussel.
À la fin du premier trimestre de l’année 1943, les autorités engagent massivement la Gendarmerie dans la recherche des réfractaires au S.T.O. Ces derniers se regroupent dans des camps et sous l’impulsion des organisations de résistance commencent à s’organiser.
Pour les désigner, les autorités utilisent initialement le terme de « défaillants ». La terminologie évolue très rapidement. Il est question de « hors-la-loi », de « terroristes », de « bandes d’obédience communiste ». En novembre 1943, le lieutenant-colonel, commandant la légion du Limousin, écrit :
« Si les groupes de réfractaires composés de jeunes gens du pays se sont dispersés par suite de la température et de la suspension de l’envoi de nouveaux contingents de main-d’œuvre en Allemagne, les terroristes ou les francs-tireurs partisans encadrés et dirigés par des étrangers et des réfractaires au S.T.O. du nord ou du midi, le plus souvent condamnés de droit commun, demeurent dans le maquis. »
René Bousquet, plus dubitatif, note à la même époque :
« Les attentats, constitués surtout par des vols de tickets d’alimentation ou de tabac sont peut-être imputables, pour une large part, à des isolés venus des villes en vue d’alimenter le marché noir. »
Début mai, un rapport du préfet signale l’existence d’un maquis important qui se serait constitué dans la région boisée comprise entre Argentat-Tulle-Ussel où la situation est troublée. Trois faits marquants se produisent, imputables aux réfractaires.
Le 15 décembre 1945, à Meymac, dans l’arrondissement d’Ussel, ils détruisent une botteleuse pour empêcher la livraison de fourrage à l’ennemi.
Le 17 avril, à quelques kilomètres de Barsange, ils attaquent un camion transportant des veaux destinés au ravitaillement général. Sous la menace de pistolets et de mitraillettes, les assaillants s’emparent du véhicule avec son chargement puis s’enfuient en direction de Felletin. Près de Vinzant, sur la commune de Peyrelevade, ils abandonnent le camion après avoir lâché le bétail. Sur la ridelle, les gendarmes découvrent une inscription qui ne laisse aucun doute sur les auteurs de l’enlèvement : « Ces veaux étaient destinés aux boches, les francs-tireurs les rendent aux Français ». Les gendarmes, en liaison avec la Police de sûreté et un détachement de G.M.R. stationné à Tulle, effectuent des recherches pendant quarante-huit heures mais en vain. Seul résultat de leurs investigations, la découverte, le 18 avril, de caches récemment utilisées par un petit groupe de clandestins.
Nouveau coup de force le 8 mai 1943. Trois détenus arrêtés le 20 avril et incarcérés à la maison d’arrêt de Tulle, à la suite de leur inculpation pour « activité communiste » doivent être présentés devant le juge d’instruction à Ussel. Deux gendarmes effectuent leur transfèrement. Ils prennent place dans le train reliant Tulle à Ussel. Après la halte de Alleyrac-Chaveroche, huit individus installés dans le même wagon que l’escorte font irruption, revolver au poing, dans le compartiment où elle se trouve. Le signal d’alarme déclenché, le train s’immobilise. Sous la menace, les inconnus désarment les gendarmes avant de libérer les trois prisonniers : Germain Constanty, Léonard et Julien Beynel. Pendant ce temps, une vingtaine d’individus surgissent des environs et cernent le wagon. En arrivant à Égletons, trois quarts d’heure plus tard, les gendarmes donnent l’alerte. La battue organisée par les forces de l’ordre ne donne aucun résultat.
À la suite de cette action retentissante, suivie et précédée de plusieurs sabotages par explosifs perpétrés en Haute-Corrèze comme dans les cantons du sud-est de la Haute-Vienne, le secrétaire général à la Police décide de soumettre le département de la Corrèze « à un contrôle spécial ». Il met à la disposition du préfet des forces supplétives de Gendarmerie pour renforcer les brigades ainsi que des unités de la Garde et des G.M.R.
* *
*
Le 8 mai, la direction de la Gendarmerie déplace en Corrèze sept pelotons de réserve motorisés. Au lieu d’être employés en unités constituées, les gendarmes sont répartis, par groupes de dix, dans les brigades les plus touchées par l’insécurité. À partir du 12 mai, sept autres pelotons viennent s’ajouter aux précédents.
Les unités de Gendarmerie rassemblées dans le département constituent un groupement placé sous les ordres du lieutenant-colonel D…, commandant la légion du Limousin. Ce dernier installe son P.C. à Meymac où le rejoignent le commandant de compagnie de la Corrèze et quatre officiers détachés par la Direction.
Entre le 8 et le 15, six escadrons de la Garde, un G.M.R. et cent inspecteurs de Police arrivent en Corrèze.
Le secrétaire général de la Police, par note secrète n° 149 S.G./POL du 12 mai, donne délégation à l’intendant de Police de la région de Limoges pour coiffer l’ensemble des forces.
Afin de faciliter le contrôle des populations, le 16 mai, le préfet de la Corrèze prend un arrêté qui fait obligation à chaque homme, âgé de 18 à 55 ans, habitant dans les arrondissements de Tulle et d’Ussel, de posséder un certificat d’identité.
La Gendarmerie reçoit une triple mission. D’une part, arrêter les défaillants de la relève du S.T.O. De l’autre, identifier toutes les personnes susceptibles de leur venir en aide. Enfin, rechercher les renseignements permettant de situer, sur le terrain, le refuge de toute bande armée.
Pour renforcer l’efficacité de la surveillance, le commandant de légion prescrit l’exécution, en permanence, de patrouilles et l’installation de postes fixes d’observation. L’intendant de Police organise des ratissages dans les zones d’accès difficile, gorges et forêts.
Du 12 mai au 23 juin, les forces du Maintien de l’ordre déployées dans le département recherchent, sans l’obtenir, le contact avec les bandes. Le 12 mai, elles explorent la forêt de la Cubesse, à l’ouest de Meymac. La Gendarmerie tient quatre postes de bouclage. Six escadrons de la garde, un G.M.R. et cent inspecteurs de Police fouillent le terrain. Le 13 mai, nouvelle opération d’envergure. Elle se déroule au nord de la forêt de la Cubesse. La Garde découvre quelques sapes susceptibles d’abriter une dizaine d’hommes. Dans la nuit du 14 au 15 mai plusieurs escadrons et des détachements de Police agissent entre Chaveroche et Alleyrat. Les réfractaires restent insaisissables.
Du 24 au 26 mai, un officier de la direction générale, le chef d’escadron A…, se rend en mission en Corrèze afin d’y faire le point sur l’action de la Gendarmerie. Il assiste à Meymac à une réunion des chefs de corps et des services du Maintien de l’ordre présidée par l’intendant de Police de Limoges.
Le 27 mai, le chef d’escadron C…, commandant la compagnie de la Corrèze, prend la tête du groupement des forces de Gendarmerie. Le lieutenant-colonel D… rejoint Limoges.
Les opérations prennent fin le 23 juin. À la dissolution du groupement, chaque commandant de section reprend ses brigades sous son autorité directe. Les pelotons déplacés regagnent leurs résidences.
Les résultats obtenus déçoivent les autorités. Les arrestations n’excèdent pas la douzaine : étrangers, déserteurs des Chantiers de jeunesse, réfractaires du S.T.O. La découverte de quelques armes, d’explosifs, de vivres et de matériels divers confirme la présence dans la région d’éléments, en voie d’organisation, très mobiles. Cet échec relatif s’explique. Les réfractaires, encore peu aguerris, ne disposent que d’un armement réduit. Ils n’ont pas d’autre choix que celui de refuser un combat inégal dans l’attente de circonstances plus favorables. Renseignés par la population, au moindre danger ils changent d’emplacement. Lorsque la pression des forces de l’ordre commence à décroître, après la levée du dispositif policier, on enregistre un regain d’activité de leur part : sabotages, vols de tickets d’alimentation, etc.
Le 8 juillet, les gendarmes éventent, in extremis, une attaque contre la brigade de Lapleau. Une bande d’une quarantaine d’hommes s’apprête à investir la caserne pour libérer un individu, détenu à la chambre de sûreté, arrêté la veille en possession d’une arme et soupçonné de ravitailler les réfractaires. Informé par un habitant de la localité que des inconnus viennent de sectionner les fils téléphoniques, le commandant de brigade met la caserne en état de défense et envoie une estafette à Tulle pour demander du secours. Sur ces entre-faits, un peloton de G.M.R. arrive fortuitement à Lapleau alors que la bande est sur le point de passer à l’attaque. Alertés par des guetteurs, les assaillants se replient hors de l’agglomération et abandonnent leur projet.
Pure coïncidence, ce même 8 juillet, le secrétaire général à la Police décide, pour lutter contre « l’action terroriste », de mettre à la disposition des préfets de la Corrèze et du Cantal où la situation est également préoccupante des groupements mixtes de forces de Gendarmerie, de Garde et de Police en vue du renforcement de la gendarmerie départementale. Chaque groupement, précise la note secrète de Bousquet, « aura pour seule mission la recherche et la capture des groupes armés. » D’autre part il « agira respectivement sur le territoire normalement attribué à chacune des sections de Tulle, Ussel, Mauriac, Aurillac. »
Le lieutenant-colonel B…, adjoint au commandant de la légion d’Auvergne, coordonne l’ensemble du dispositif assisté par un officier supérieur de la Garde, le lieutenant-colonel C…, du 6e régiment, et du commandant G…, commandant régional des G.M.R. de Limoges, chargé des liaisons avec le préfet régional. Un officier de Gendarmerie, du grade de capitaine ou de chef d’escadron, commande chaque groupement. Le chef d’escadron H…, nouvellement affecté au commandement de la compagnie de la Corrèze, maintient un contact permanent avec le commandant des forces lui-même en relation étroite avec le préfet Musso.
Le groupement des forces de Police, ainsi encadré, totalise 8 pelotons de réserve motorisés (240 hommes), 5 escadrons de la garde des 2e, 4e et e régiments, 2 G.M.R. (Navarre et Périgord), 34 commissaires et inspecteurs de Police coiffés par le commissaire principal A… de Limoges.
Dès le 9 juillet, le préfet fixe le plan d’action et donne ses instructions au lieutenant-colonel B… qui installe son P.C. à l’école normale d’instituteurs.
Les fonctionnaires de Police, constitués en équipes réparties dans les villages de Lapleau, Meymac, Marcillac-la-Croisille, Turenne, Noailles, reçoivent une double mission : recherche du renseignement et exécution d’enquêtes spéciales au profit du préfet.
La gendarmerie départementale (brigades) continue de remplir sa fonction première de service courant. Le préfet lui demande, en outre, de se consacrer à un travail d’information « en s’attachant à persuader les réfractaires que leur attitude est vaine et dangereuse, qu’ils s’exposent à être repris et à subir des préjudices plus graves par la suite. » Il l’invite encore à « conseiller aux agriculteurs d’agir sur les terroristes et les réfractaires […]. »
Dans le domaine du renseignement, la Légion des combattants et la Milice apportent leur concours jugé peu efficace par le colonel inspecteur de la 7e région de Gendarmerie.
L’autorité administrative, soucieuse de rétablir l’ordre à tout prix, donne des consignes au plan opérationnel. Le préfet, s’adressant au lieutenant-colonel B…, écrit :
« Procéder par encerclement, aux heures les plus propices, en allant très vite, dès la réception des informations ; monter d’autre part les manœuvres en grand secret, en ne perdant pas de vue que la très grande partie de la population, complice des réfractaires, signalera les mouvements des forces de Police […]. »
Dans le domaine répressif, il invite le lieutenant-colonel B… à lui proposer toute mesure d’internement concernant les personnes susceptibles d’aider les « défaillants ». Sa détermination est telle qu’il l’autorise même à ordonner des arrestations préventives. Destination à donner aux suspects : le camp de Saint-Paul d’Eyjaux. Enfin, le préfet prévoit, chaque matin, une réunion à son bureau avec les principaux responsables des forces du Maintien de l’ordre.
Les opérations débutent le 10 juillet. Vers le 15, le lieutenant-colonel B… modifie le dispositif car le préfet du Cantal ne juge pas utile de mettre en place des groupements à Mauriac et à Aurillac. Il répartit l’ensemble de ses moyens dans la zone d’opération dite « Corrèze » qu’il divise en secteurs correspondant aux circonscriptions des brigades de Tulle, Ussel, Lapleau, Saint-Privat. Le commandant de secteur agit en liaison avec les brigades et les équipes de la Police de sûreté. En dehors des opérations d’envergure, le responsable a toute latitude pour organiser coups de main et embuscades.
Le bilan des forces de l’ordre, fin juillet, n’est guère plus important que celui des mois de mai et de juin. Il se solde par l’arrestation de 7 réfractaires, 9 complices, 2 « gaullistes » et une dizaine de « terroristes ».
Pour le commandant du dispositif « les 99/100 de la population des villes et des campagnes sont pour les défaillants et leur apportent aide matérielle et morale […]. » Ainsi s’explique l’inefficacité des opérations.
L’état d’esprit des gendarmes déplacés n’appelle, selon le commandement, aucune remarque. Un officier supérieur, au terme d’une inspection, note « que les interceptions postales ont révélé certains bavardages épistolaires, mais ceux-ci, n’ont, en aucune façon, décelé un mauvais esprit quelconque, bien au contraire […]. »
Début août, le préfet Lecornu, précédemment en poste à Saint-Nazaire, succède au préfet Musso nommé dans le Jura. Dans les jours qui suivent son arrivée, les forces de l’ordre obtiennent un succès inattendu, lourd de conséquences pour les « réfractaires » trahis par l’un des leurs. En effet, le 14, le transfuge d’une bande d’une cinquantaine d’hommes signale son lieu de refuge au capitaine P… commandant le sous-groupement de Lapleau. Les réfractaires stationnent dans la région de Chamalot. Le commandant du sous-groupement décide d’effectuer un coup de main le 15 août.
L’effet de surprise, un jour de fête, est susceptible, pense-t-il, de favoriser son entreprise. Le 15, en fin d’après-midi, son détachement, fort de 90 gendarmes, gardes et G.M.R., investit le camp. Après avoir désarmé plusieurs guetteurs ses hommes se heurtent à un centre de résistance qui pendant une quinzaine de minutes protège la retraite d’une partie des réfractaires. Les forces de l’ordre capturent néanmoins 23 dissidents et récupèrent un important butin : 1 fusil-mitrailleur, 11 mitraillettes, 5 fusils, 1 caisse de grenades, des munitions et explosifs. Du côté des assaillants on dénombre seulement un blessé léger. Pour leur part, les réfractaires en totalisent 4 plus gravement touchés. Pour les 23 prisonniers ce sera la déportation quelques semaines plus tard.
Début septembre, la direction générale de la Gendarmerie relève les unités déplacées. Le secrétaire général à la Police remplace le lieutenant-colonel B… par un officier supérieur de la Garde.
Par la suite, que ce soit en Corrèze ou dans les autres régions sensibles, on ne trouvera que très exceptionnellement des officiers de Gendarmerie à la tête de dispositifs mixtes regroupant des effectifs importants.
Le libellé de la citation à l’ordre de la Gendarmerie décernée au lieutenant-colonel B… reflète son action à la tête des forces déplacées en Corrèze :
« Chargé de la direction d’importantes opérations du Maintien de l’ordre qui se sont déroulées pendant plus de deux mois, dans une région particulièrement troublée, a réussi, en dépit d’innombrables difficultés, à mener à bien la mission qui lui était confiée et à mettre, entre les mains de la justice, un nombre important de malfaiteurs. A fait preuve de remarquables qualités d’organisateur et a su, par son exemple et son action personnelle maintenir le moral de sa troupe à un niveau très élevé et obtenir de tous l’effort maximum. »
Le capitaine P… et plusieurs officiers et sous-officiers sous ses ordres reçoivent une lettre de félicitations du chef du Gouvernement, avec inscription au Livre d’or de la Gendarmerie, à la suite de l’opération de Chamalot.
Dès son retour à Figeac, où il commande la section, le capitaine P… tire les enseignements de son séjour en Corrèze, dans le secteur de Lapleau, pendant les mois de juin et de juillet. Il souligne l’activité de son détachement : 300 embuscades, 19 coups de sonde sur des points jugés suspects, 17 opérations de vérification de renseignements reçus, 35 explorations systématiques de zone.
De l’avis de l’officier, la principale difficulté rencontrée résulte, pour les forces de l’ordre, de l’impossibilité de se procurer des renseignements car la quasi-totalité de la population leur est hostile. Les témoignages concordent et confirment qu’à cette époque la Gendarmerie s’aliène en Corrèze bien des esprits par suite de l’action menée contre les réfractaires.
Autre obstacle à l’efficacité des opérations : la pénurie de carburant pour les véhicules organiques. Afin d’y remédier, le préfet réquisitionne des voitures à gazogène. Des indiscrétions se produisent. Les préparatifs opérationnels ne passent pas inaperçus. Les réfractaires, alertés, prennent toutes mesures de sûreté utiles.
Une logistique inadaptée aggrave les conditions de vie, déjà précaires, des unités déplacées. Les restaurants invoquent le rationnement alimentaire pour ne pas servir de repas aux gendarmes dépourvus de cuisines roulantes. La Garde, les G.M.R. et parfois les Chantiers de jeunesse les prennent en subsistance.
Le capitaine P… tire principalement de l’expérience corrézienne des enseignements dans le domaine opérationnel. La direction générale de la Gendarmerie les reprend dans une directive qu’elle diffuse le 1er octobre 1943. Dans ce document apparaît, pour la première fois depuis le début de l’Occupation, la notion de « zone troublée » où la situation « doit être considérée comme une situation de guerre ». La direction laisse le soin aux commandants de légion ou de compagnie, en fonction des circonstances, de déterminer les circonscriptions à classer comme telles. Dans ces zones, les conditions d’exécution du service réglementées par le service intérieur et le décret du 20 mai 1903, notamment en ce qui concerne l’effectif, l’alternance, la périodicité des tournées, les limites de circonscription, cessent provisoirement d’être applicables. Cela signifie que de jour, 3 hommes au moins, dans les brigades non renforcées, et 4 dans celles qui le sont, effectuent les services indispensables au lieu de deux en période normale. De nuit, les sorties à l’initiative des commandants de brigades sont supprimées, sauf en cas d’appel de l’extérieur. Toutefois, si la provenance de l’appel paraît douteuse ou suspecte, la note recommande aux gendarmes une extrême prudence pour leur éviter de tomber dans des traquenards. À plusieurs reprises, sur l’ensemble du territoire, des maquisards enlèvent ou désarment des gendarmes attirés à l’extérieur de leurs casernes. L’excès de précautions ne saurait entraîner la passivité aussi la direction maintient les sorties chaque fois qu’il y a possibilité d’exploiter immédiatement un renseignement important, sûr et précis. Dans cette hypothèse, le commandant de brigade, s’il le peut, alerte le commandant de section et les brigades voisines de manière à intervenir de concert et massivement.
Le port du mousqueton, en service, devient obligatoire en zone troublée. Autre impératif : l’observation des règles tactiques simples qui sont à la base de l’action militaire (distance entre les hommes, abordage en sûreté des points suspects, etc.).
Courant septembre, le secrétaire général à la Police met les forces supplétives de Gendarmerie à la disposition exclusive des brigades qui, dans les secteurs les plus sensibles, reçoivent un renfort d’une dizaine de gendarmes. Des G.M.R. participent également au renforcement des unités territoriales durant tout le mois d’octobre. À partir de ce moment-là, et jusqu’en mars 1994, l’activité des gendarmes déplacés se confond avec celle des gendarmes départementaux.
Le 10 mars 1944, Darnand ordonne de reconstituer les pelotons des forces supplétives de Gendarmerie dispersés dans les brigades. Ils passent alors sous l’autorité directe du commandant des forces du Maintien de l’ordre de la région de Limoges, le colonel Mahuet de la Garde puis du milicien de Vaugelas.
* *
*
Les unités territoriales, bien plus que les forces supplétives relevées tous les quarante-cinq jours, en moyenne, subissent en permanence les effets de la montée en puissance de la Résistance dans le département.
Le 24 juillet 1943, en fin d’après-midi, 3 gendarmes de la Roche-Canillac exécutent un service externe pour rechercher un réfractaire du S.T.O. Alors qu’ils sont juchés sur leur bicyclette, 5 individus armés surgissent devant eux et sous la menace de leurs armes s’emparent de leurs pistolets et mousquetons. La battue entreprise par un escadron du 6e régiment de la Garde ne permet pas de retrouver les agresseurs. Cependant, après une enquête minutieuse, le commandant de brigade identifie et localise les auteurs de l’attaque. Une opération montée avec le concours d’éléments de la Garde et des G.M.R. aboutit le 8 août à l’arrestation des réfractaires impliqués dans cette affaire.
Dans les jours qui suivent, le préfet Lecornu reçoit la visite du chef d’escadron H…, commandant la compagnie. Ce dernier demande contre les gendarmes qui se sont laissés désarmer une mesure d’internement :
« Mes subordonnés, indique-t-il au préfet, n’ont pas le moral. La population est solidaire des réfractaires. Les gendarmes de La Roche-Canillac se sont laissés désarmer sans résistance par des maquisards il y a quelques jours. J’ai l’honneur de vous demander contre eux une mesure d’internement. »
Le préfet, proche de la Résistance, lui demande de se contenter d’une sanction disciplinaire. Le commandement prend des mesures sévères contre les gendarmes qui n’ont esquissé aucun geste de défense lorsqu’ils ont été attaqués. D’abord relevés de leurs fonctions, ils sont ensuite révoqués. Quant au commandant de brigade, le chef D… dont les investigations ont permis l’interpellation des agresseurs, il obtient une citation à l’ordre de la légion pour « l’arrestation de 6 terroristes auteurs de plusieurs attentats à main armée. »
Début août, nouvelle action contre les gendarmes. Une douzaine d’individus armés immobilisent le petit train reliant Argentat à Tulle, puis libèrent un « défaillant » de la relève après avoir désarmé l’escorte constituée par trois gendarmes de la brigade d’Argentat et deux sous-officiers du 1er régiment de la Garde. Le chef d’escorte laisse opérer impunément les assaillants. Au cours des recherches consécutives à cet attentat, les forces mixtes de Police de Tulle découvrent un camp de réfractaires armés dans la région de Pandrignes et réussissent à capturer leur chef porteur d’un pistolet et de divers documents compromettants. Une fouille du terrain permet, par la suite, de découvrir un dépôt d’armes, de munitions et d’explosifs. Tous les gendarmes d’escorte sont relevés de leurs fonctions puis révoqués.
La situation ne cesse de se dégrader. Gendarmes et réfractaires échangent des coups de feu. Le 27 août, quatre individus s’emparent, sous la menace de leurs armes, d’un millier de feuilles de rationnement stockées à la mairie de Varetz. Le commandant de section de Brive organise la poursuite avec plusieurs gendarmes et des gardes du 1er régiment. Le détachement établit le contact avec les fuyards dans la région de Noailles. Les gendarmes tirent plusieurs coups de mousqueton et arrêtent un des maquisards gravement blessé. Tandis que le capitaine V… demande des renforts par téléphone, le blessé réussit à s’enfuir.
Incendies volontaires de céréales, attentats contre les voies ferrées, destructions de pylônes électriques et de matériel de battage, vols de titres d’alimentation, actions contre les miliciens s’intensifient qui mobilisent constamment les gendarmes.
Au mois de septembre, les forces de l’ordre comptent leurs premières victimes. Le 14, en fin d’après-midi, les gendarmes F…, M… et G…, de la brigade de Tulle, partent en tournée dans la commune de Gimel, du côté de la ferme de l’Espérut où ils doivent vérifier s’il n’y a pas d’indices de passage de réfractaires armés. Leur retour à la caserne est prévu, au plus tard, vers minuit. Le 15, à 3 heures, ils ne sont toujours pas rentrés. Leurs familles inquiètes préviennent le commandant de brigade, qui à son tour alerte le commandant de section. L’officier rassemble tous les moyens disponibles pour ratisser le terrain. Au petit matin, plusieurs habitants de la région signalent aux gendarmes qu’ils ont entendu, dans la soirée, des coups de feu provenant du hameau de la Bitarelle. Pensant qu’il s’agissait de tirs effectués par des troupes allemandes en manœuvre, ils n’y ont pas prêté davantage attention. Les recherches s’orientent dans ce secteur. Elles amènent la découverte, sur le bord d’un chemin, du cadavre du gendarme M… tué d’une balle dans le front. Son armement et son sac de correspondance ont disparu. À quelques mètres de là gît sur sa bicyclette le gendarme G… Son mousqueton est criblé de balles. Un peu plus loin se trouve la troisième victime, le gendarme E…, lui aussi dépouillé de son arme.
Le chef d’escadron H…, commandant la compagnie, organise avec plusieurs escadrons de la Garde une battue dans la forêt de Mirambel susceptible d’abriter les auteurs de l’agression. L’opération s’avère infructueuse. Cependant, quelques semaines plus tard, le 21 octobre, à l’occasion d’un ratissage dans la région de Tulle, un groupement de la Garde capture, après une fusillade, quatre jeunes F.T.P. dont la participation à l’attaque contre les gendarmes est rapidement établie. Parmi eux, le fils d’un gendarme de Bourges.
L’annonce de la mort des trois gendarmes de Tulle provoque une grande émotion en Corrèze. Le préfet Lecornu, pourtant en prise directe avec la Résistance, désapprouve les maquisards et parle « d’assassinat » en évoquant leur action. Les gendarmes effectuaient une simple patrouille de routine.
Le libellé de la médaille militaire conférée à titre posthume aux trois sous-officiers mentionne :
« Le 14 septembre 1943, en service commandé dans une région troublée est tombé avec ses camarades de patrouille dans une embuscade tendue par des terroristes. A été lâchement assassiné sans avoir pu faire usage de ses armes. »
En 1971, un témoin, membre du groupe F.T.P. Lucien Sampaix constitué en juillet 1943 dans la forêt de Chadon entre Gimel et Tulle, rapporte ainsi le drame :
« Le 15 septembre, écrit-il, quatre des nôtres en mission de ravitaillement tombent nez à nez avec trois gendarmes en service. Ces derniers ouvrent le feu. Nos gars réagissent violemment : les trois gendarmes sont tués. Après cette affaire les gendarmes circulant dans la région attacheront leurs fusils au cadre du vélo pour bien montrer qu’ils n’ont pas l’intention de tirer […]. »
D’autres témoignages permettent d’établir que les gendarmes ont simplement manifesté l’intention d’arrêter les maquisards rencontrés fortuitement sur leur itinéraire. Se laisser emmener signifie pour les intéressés la prison et peut-être la déportation. Ils sortent alors leurs armes et abattent les trois gendarmes.
Le 17 septembre, le chef R…, accompagné du gendarme D…, de la brigade de Treignac, rentre par le train à sa résidence après avoir assisté le matin même aux obsèques des trois gendarmes de Tulle. À la station de Lonzac les gendarmes B… et C…, de retour d’un service à la foire, se joignent à eux. Tous se trouvent dans le wagon de queue. Au moment où le train bondé de voyageurs s’ébranle en direction de Treignac, plusieurs claquements se font entendre. Le gendarme D… atteint d’une balle au ventre perd conscience immédiatement. Son camarade C…, touché également, s’effondre. Le chef R… est blessé à la poitrine. Seul le gendarme B… sort indemne de l’attentat. Évacué sur Limoges le gendarme D… ne survit pas à ses blessures.
Pour le préfet Lecornu « les F.T.P. de la région de Chamboulive-Lonzac-Beaumont se manifestaient d’une façon inacceptable en arrêtant un train et en tuant froidement deux gendarmes (en réalité 1 tué et 2 blessés) qui revenaient des obsèques de leurs trois camarades […]. »
Par l’intermédiaire de Bugeac, chef départemental du C.O.P.A. (centre des opérations de parachutage et d’atterrissage), en contact direct avec tous les groupes F.T.P. qu’il ravitaille en armes, il tente d’obtenir « qu’ils cessent de s’en prendre systématiquement aux gendarmes et policiers français ». Son initiative ne suffira pas pour mettre un terme à ces affrontements fratricides.
Le lendemain de Noël 1943, dans la soirée, un appel parvient à la Gendarmerie d’Argentat. Des individus armés de mitraillettes viennent de dévaliser un débit de tabac dans l’agglomération et se sont fait remettre ensuite des effets d’habillement et du matériel de couchage au cantonnement des Compagnons de France. Le MDL-chef D…, commandant la brigade, se rend sur les lieux. Il apprend que des suspects, juste avant son arrivée, sont partis en direction de Saint-Martin-La-Méanne. Pendant que des gendarmes du peloton motorisé en renfort à la brigade bouclent les sorties du bourg, le chef D… recherche des témoignages et des indices. Alors qu’il se trouve en face de la poste il aperçoit trois silhouettes qui longent la route en file indienne. Brusquement, les inconnus se dévoilent et intiment l’ordre aux gendarmes de lever les mains en l’air. Les gendarmes parviennent à en désarmer un. Les autres se dégagent en tirant une rafale d’arme automatique. Elle blesse mortellement le chef D… et fauche en même temps l’homme au main des gendarmes.
Dans l’allocution qu’il prononce le 29 décembre, aux obsèques du chef D…, le commandant de légion en appelle à la fraternité :
« Devant cette veuve et ce fils, devant les parents inconnus de la seconde victime de ce drame, devant tous ces Français confondus dans leur peine, devant ces larmes brûlantes, devant la désolation de ces foyers français, nous tous, Français, inclinons-nous et méditons. Et puis redressons-nous, serrons nos rangs, chassons la haine de nos regards et adoptons, les uns et les autres, des regards de lumière et d’amour pour poursuivre notre tâche nationale commune dans l’honneur, la dignité et le respect du sang français. »
En 1944 la liste des gendarmes tués dans le département s’allonge. Le 29 janvier, des tireurs isolés abattent le gendarme D…, de la légion du Languedoc, déplacé avec un peloton motorisé en Corrèze, alors qu’il tient un poste en avant d’un dispositif de barrage mis en place à la sortie de Meymac. Son camarade G…, blessé aux jambes, est évacué sur l’hôpital d’Ussel.
Trois mois après, en gare de Masseret, un groupe armé attaque par surprise l’escorte de quatre gendarmes chargée de convoyer un wagon de couvertures et de ballots de drap destinés au centre d’administration de la Gendarmerie de Chasseneuil. Le gendarme R…, de la brigade de Castres, esquisse un geste de défense au moment de l’arrivée des assaillants. Ceux-ci tirent immédiatement. Le gendarme R… est tué sur le coup. Les maquisards désarment ses trois compagnons puis embarquent leur butin à bord de camions avant de disparaître en direction de Meilhards.
Les forces mobiles du Maintien de l’ordre subissent, de leur côté, des pertes sévères. Le 15 octobre 1943 trois sous-officiers du 3e régiment de la Garde sont victimes d’une embuscade, près de Lafage, au cours du transfèrement à l’hôpital de Tulle de « rebelles pris les armes à la main » précise la citation décernée aux victimes.
De même, le 29 janvier 1944, trois gardiens du G.M.R. Bourbonnais trouvent la mort dans la région de Treignac au retour d’une opération de police.
Ce bilan serait incomplet si l’on ne mentionnait pas les blessés, au nombre d’une vingtaine en 1943 et 1944, souvent victimes innocentes d’un destin implacable à l’image de celui du gendarme D…, de la brigade de Neuvic.
Courant mars 1944, ce sous-officier découvre une charge explosive placée sur un pylône d’une ligne électrique à haute tension. Il tente de la désamorcer. Au moment où il s’en saisi une violente déflagration se produit qui le mutile à vie. Son geste lui coûte la perte d’un œil et des deux mains.
Le danger guette les cadres, officiers et gradés. Au mois d’octobre 1943, plusieurs menaces de mort motivent la mutation, dans une école préparatoire de Gendarmerie, du chef D… particulièrement visé en raison « de son activité dans la répression des menées terroristes ».
Les responsables de l’A.S., au cours du dernier trimestre de l’année 1943, décident d’éliminer le lieutenant L… P… commandant la section d’Ussel, jugé lui aussi trop répressif. Un commando s’apprête à le capturer. Il ne doit son salut qu’à un résistant, le docteur Siriex, qui par le truchement du préfet alerte le commandement. Une mutation d’urgence à la section de La Réole lui sauve probablement la vie.
La capitaine V…, commandant la section de Brive, n’échappe pas aux dangers de l’heure. Le 1er mai 1944, lors d’une opération qu’il dirige personnellement pour dégager la brigade de Vigeois, encerclée par une centaine d’hommes armés, il est blessé à la jambe par un projectile. Son état nécessite des soins pendant deux mois.
Le commandant de compagnie de la Corrèze sort lui-même indemne d’un accrochage avec les maquisards. À la suite de l’attaque de la caserne de Lapleau, investie par une bande armée le 20 février 1944, le personnel présent est désarmé. Le lendemain le chef d’escadron H… se rend sur place, avec un détachement de huit hommes, pour enquêter sur les circonstances de l’attaque. En arrivant dans la région de Saint-Hilaire-de-Foissac, les deux véhicules de la Gendarmerie tombent sur un barrage tenu par une vingtaine d’hommes. Une fusillade se déclenche qui dure plus d’un quart d’heure. Puis les maquisards s’esquivent. L’escadron de la Garde d’Égletons, dépêché en renfort, évacue deux gendarmes sérieusement blessés.
Les gendarmes du département connaissent d’autres avatars. L’attaque de la caserne de Seilhac, le 1er décembre 1943, constitue le début d’une série d’opérations de la Résistance. Toutes répondent à des buts précis : délivrance de prisonniers, récupération d’armes ou de matériel, avertissement pour tempérer les personnels trop zélés, etc.
La vulnérabilité des objectifs, accrue par la présence des familles dans les casernes, empêche toute opposition efficace même si quelquefois les assiégés restent maîtres des lieux. Incontestablement, de part et d’autre, prévaut le souci d’éviter au maximum toute effusion de sang. Quelques exemples illustrent le scénario de ces attaques et les conséquences qui en résultent.
Dans la nuit du 1er décembre 1943 les gendarmes de Seilhac arrêtent quatre individus armés. Dès l’aube, un détachement de G.M.R. transfère trois d’entre eux à Tulle. Le quatrième est détenu à la chambre de sûreté de la brigade. Dans l’éventualité d’une tentative d’enlèvement du prisonnier le commandant de compagnie renforce la brigade qui passe de 6 à 22 sous-officiers.
En milieu de matinée, deux guetteurs postés à l’entrée de Seilhac signalent l’arrivée d’une bande armée. Les gendarmes occupent leurs postes de combat. À peine sont-ils en place que retentissent les premiers coups de feu. Les maquisards ont pris la précaution de couper la ligne téléphonique de la brigade ce qui empêche les défenseurs de donner l’alerte et de recevoir des secours. Les assaillants cessent momentanément les tirs. Les épouses des gendarmes essayent de parlementer avec eux depuis une fenêtre. Ils autorisent l’évacuation des familles à l’extérieur du bâtiment. Suit un ultimatum. Ou bien les gradés acceptent la reddition, ou bien ce sera l’assaut. Les gendarmes s’inclinent et abandonnent aux mains des maquisards non seulement leur prisonnier, mais encore leurs armes et divers équipements.
Indice de la fracture qui, au sein d’une même formation, divise les personnels, un gendarme qui a refusé de faire usage de ses armes, au début de l’attaque, est ultérieurement révoqué de même que les gradés chefs du dispositif. En revanche, une citation à l’ordre de la légion récompense un autre sous-officier qui « a fait preuve d’initiative, de cran et de courage en essayant d’enrayer la progression des assaillants. Repéré à son poste d’observation, a riposté au feu d’une arme automatique à coups de mousqueton obligeant ainsi le premier élément à se replier […]. »
La brigade de Corrèze, quelques jours plus tard, malgré un effectif réduit, résiste de nuit à l’assaut d’une forte bande qui avait déjà à son actif la neutralisation par surprise de deux gendarmes en service dans l’agglomération. Prévenues, les forces du Maintien de l’ordre arrivent à la rescousse. Elles libèrent les gendarmes prisonniers, capturent un membre de la bande et contraignent les autres au repli.
Pour le commandement « l’échec de l’attaque de la brigade de Corrèze, par des terroristes nombreux et bien armés, est particulièrement réconfortant dans les circonstances actuelles. » Le rédacteur du rapport poursuit : « Tout le personnel sous le commandement du MDL-chef P… a fait preuve de courage. Il a donné l’exemple d’une conception élevée de l’honneur militaire tout en évitant de faire couler le sang français par un usage irréfléchi des armes. »
Les récompenses affluent. La brigade obtient une citation collective à l’ordre de la Gendarmerie. Le gradé est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Tous les gendarmes reçoivent la médaille militaire.
Sans coup férir, le 15 décembre, les maquisards désarment la brigade de Treignac pourtant renforcée par deux brigades motorisées (18 militaires). Le scénario des affaires antérieures se répète. Des fusils-mitrailleurs barrent les issues de la localité. Après avoir occupé la poste pour contrôler le central téléphonique, les maquisards à partir de 8 heures opèrent simultanément au cantonnement de la brigade motorisée et à la caserne de Treignac. Surpris, les gendarmes ne réagissent pas, mais en ont-ils le désir ? C’est peu probable. Ils perdent toutes leurs armes mais évitent l’enlèvement du matériel automobile. Se conformant à une directive émanant de la direction générale, diffusée au début novembre, ils ont déposé en lieu sûr divers organes du moteur pour prévenir précisément les vols de plus en plus fréquents.
Au début de l’année 1944, le général Martin réagit vigoureusement pour inciter les gendarmes à plus de mordant face aux attaques de casernes qui se multiplient sur l’ensemble du territoire :
« Je fais accorder, écrit-il, la croix de la Légion d’honneur à un maréchal des logis-chef qui, avec quelques gendarmes, a énergiquement et victorieusement défendu son casernement contre l’agression d’une cinquantaine de terroristes puissamment armés. Je fais en outre attribuer la médaille militaire à tous les gendarmes qui ont vaillamment soutenu l’action de leur chef en participant à cette défense. Par contre j’élimine de l’Arme deux gendarmes qui se sont laissés désarmer sans esquisser le moindre geste de défense. »
Son intervention ne modifie pas ou très peu le comportement des gendarmes. Entre janvier et juillet 1944, les résistants attaquent avec succès la quasi-totalité des casernes de Gendarmerie du département. Quelques-unes tombent même dans leurs mains à plusieurs reprises, comme celles de Larches les 31 janvier et 3 février 1944 ou de Bugeat les 25 avril et 1er juin.
Certes, les rapports établis par la hiérarchie concluent tous à des actions de force contre les casernes. Mais les exemples sont nombreux où il ne s’agit, en fait, que de simulacres organisés d’un commun accord entre maquisards et gendarmes, à l’insu du commandement, pour sauvegarder les apparences. À Lubersac, dans l’arrondissement de Brive, la brigade remet volontairement aux maquisards la totalité de son armement. La version officielle fait état d’une attaque en règle, comme le souligne le commandant de section de Brive :
« Le 6 juin 1944, à 21 h 30, quatre-vingts individus ont attaqué la caserne de Gendarmerie de Lubersac. Après échange de coups de feu et sous la menace, par ces individus, de faire sauter la caserne les gendarmes se sont rendus et ont été désarmés. Les terroristes sont repartis en camion et voitures légères en direction d’Uzerches. Pas de blessés. »
Outre les casernes, les patrouilles, escortes, postes de garde constituent une cible permanente pour les maquisards. Dans ce climat d’insécurité générale et de confusion, qui loin de s’atténuer s’aggrave inexorablement depuis la fin de l’année 1942, comment les gendarmes réagissent-ils ?
Il n’est pas de brigades où l’on ne trouve au moins un gendarme qui apporte son aide aux patriotes. Les autres, dans l’ensemble, adoptent une attitude passive. Comme en service ils agissent toujours par deux au minimum et très souvent en unités constituées, il est difficile pour eux, sans se trahir, d’afficher ouvertement leurs convictions et partant d’aider les « illégaux » dans le feu de l’action.
Lorsqu’ils emploient la force contre des inconnus, ils ne sont pas toujours en mesure de déterminer s’ils sont en présence de malfaiteurs de droit commun ou de résistants. La délinquance, depuis la signature de l’armistice, ne cesse d’augmenter de manière inquiétante. Dans le ressort de la cour d’appel de Riom, qui s’étend dans quatre départements, les tribunaux correctionnels en 1943 prononcent en moyenne 4.300 condamnations à des peines d’emprisonnements alors qu’avant la guerre on en comptait moins de 1.200.
En Corrèze, des individus isolés ou en groupe, sous couvert de la Résistance, rançonnent les commerçants, volent des tickets d’alimentation, cambriolent des débits de tabac, etc. Ils entretiennent la confusion. Les maquisards en sont conscients qui les punissent sans ménagement. À la mi-janvier 1944, près de Combressol, ils exécutent ainsi un « pillard ». Près du corps de ce dernier, criblé de balles, les gendarmes découvrent un papier portant l’inscription ci-après :
« Les francs-tireurs n’ont pas besoin de la Police pour supprimer les voleurs, les assassins et les pillards. Avis, 1er exemple, le quartier va être épuré. Le comité central de Résistance. Signé F.T.P. »
Sur la place publique de Salon-la-Tour, dans le canton d’Uzerches, le 4 mars 1944, dix maquisards jugent un individu auteur de plusieurs vols commis soi-disant pour la Résistance alors qu’en réalité il en tirait un profit personnel. Séance tenante, l’homme est condamné à mort et fusillé.
Une minorité de gendarmes, il est vrai stimulée par certains chefs, se montre répressive à l’égard des maquisards. Le souci des intéressés est avant tout de ne pas transgresser le devoir d’obéissance. Entraînés par le lieutenant commandant la section d’Ussel, le 20 septembre 1943, au cours d’une embuscade près du village de Bussejoux des gendarmes arrêtent trois « illégaux » et saisissent un fusil-mitrailleur, deux mitraillettes avec les munitions correspondantes. Quelques heures après, renforcés par un escadron de la Garde, au lieu-dit Confolens, ils capturent trois autres maquisards.
De même, le 4 décembre 1943, le lieutenant H… exploite un renseignement fourni par la section d’Ussel. À la tête d’un peloton motorisé il cerne une maison isolée où sont retranchés 12 F.T.P. armés. Avec l’aide de la Garde il obtient leur reddition.
Le général B…, commandant la deuxième brigade de la Garde et les forces du Maintien de l’ordre de la région de Limoges, au terme de sa mission en Limousin, exprime le 7 décembre 1943 sa satisfaction au commandant de légion pour l’excellent travail accompli sous son autorité par les gendarmes de la Corrèze :
« Je dois faire, souligne-t-il, particulièrement mention du lieutenant L… P… commandant la section d’Ussel qui a apporté, au colonel commandant le groupement des forces mobiles d’Ussel, une collaboration de tous les instants qui s’est traduite par la réussite de plusieurs opérations en particulier celle de Mallaret du 4-12-1943 (arrestation de 12 terroristes) […]. »
Comme le laisse entrevoir la situation des gendarmes en Corrèze, leur tâche en zone troublée est singulièrement ingrate au point que les événements les entraînent dans des affrontements meurtriers facteurs d’incompréhension et de déchirements.
* *
*
Confrontés à la Résistance, les gendarmes le sont aussi aux troupes allemandes stationnées dans le département ou de passage sous forme de colonnes répressives. Les prétentions de l’occupant les placent constamment dans des situations difficiles souvent compromettantes. Le 4 septembre 1943, le chef d’un détachement de Police allemande d’une dizaine d’hommes se présente à la brigade d’Uzerches. il exige qu’on mette à sa disposition un renfort de gendarmes pour se rendre à Montagnac, canton de Lubersac, car sa troupe vient d’arrêter « trois réfractaires ». Par surcroît elle a mis à jour un dépôt d’armes. Les gendarmes, bien que réticents, accompagnent le détachement à l’endroit indiqué.
Quelques mois plus tard, en 1944, sur les injonctions du capitaine commandant la compagnie de parachutistes allemands stationnée au camp de la Courtine, spécialement chargée de donner la chasse aux maquisards de la région d’Ussel, le lieutenant P…, commandant la section, est invité à prendre à son compte la garde, pendant toute une nuit, d’un wagon chargé de matière dangereuse à quai en gare d’Ussel.
Estimant inefficace l’action de la Gendarmerie contre le terrorisme, à la suite notamment du sabotage perpétré contre l’usine de Montupet-de-Tourette, site de production d’énergie utile à l’économie de guerre du Reich, les autorités allemandes de la région avertissent le commandant de brigade d’Ussel qu’elles ne s’accommoderont plus, à l’avenir, de l’absence de résultats.
Des traîtres à la solde des Allemands s’infiltrent dans le maquis. Une fois leur besogne de repérage terminée, ils renseignent la Gendarmerie placée une fois encore devant des responsabilités redoutables. Ne pas intervenir, alerter les autorités ou bien jouer le double jeu, toutes les options comportent des risques. Il n’y a pas d’exemples connus en Corrèze de trahisons de la part des gendarmes. Beaucoup ont agi, au contraire, dans un sens favorable à la Résistance.
Le 3 septembre 1944, aux alentours de minuit, Georges A…, porteur d’une mitraillette, se rend à la brigade d’Ussel où il se présente comme agent de la Gestapo. Il déclare aux gendarmes qu’il arrive de la commune de Saint-Exupéry et plus précisément du hameau de Bourdouleix où il a vécu pendant huit jours avec 12 « terroristes », dans une maison abandonnée. Avec ce groupe il affirme avoir participé, dans la nuit du 29 au 30 janvier, au déraillement du train Eygurande-Ussel.
On imagine à l’annonce de ces révélations la surprise mais aussi la prudence des gendarmes. Ces derniers, pour être fixés sur le rôle que joue effectivement A…, se renseignent auprès de la Police allemande à Vichy. À… travaille effectivement pour la Gestapo. En quelques heures les gendarmes établissent qu’il a reçu pour mission de « rentrer en contact » avec les gens du maquis. Pour ce faire, le traître, dans les derniers jours de janvier 1944, se présente chez un habitant de Saint-Bonnet-près-Bord et lui demande s’il connaît un camp de réfractaires. Son interlocuteur le met en relation avec une personne qui lui indique par quels relais, en utilisant les mots de passe appropriés, il peut gagner un maquis. Par ce canal A… arrive, le 25 janvier, au camp de triage des F.T.P. de la Tourette. Il y reste deux jours puis rejoint Bourdouleix. Pendant plus d’une semaine il vit avec les « terroristes ».
Avant d’exploiter le renseignement donné par A… et d’informer les autorités administratives et judiciaires l’adjudant Vergnole, commandant la brigade, recueille le maximum d’éléments afin de pouvoir alerter les maquisards en danger. Avant le lever du jour, par l’intermédiaire d’un correspondant sûr de Saint-Exupéry, il prévient le groupe qui change de gîte.
Une fois prises ces précautions, les gendarmes se chargent de l’intervention. Dans la matinée du 4 février, sous la conduite de leur chef, un détachement de 40 sous-officiers, prélevé dans les brigades de la section et guidés par A… se dirige vers le hameau de Bourdouleix. Les 15 F.T.P. qui s’y trouvaient ont déjà quitté les lieux. L’expédition infructueuse des gendarmes vaudra à la région une enquête puis une exploration par les Allemands.
En avril 1944, comme la population, les gendarmes subissent les effets néfastes des actions punitives engagées par les forces allemandes dans le département. Dans quel cadre s’inscrivent les événements ?
Avant que les colonnes répressives de la division Brehmer, unité composite constituée de deux régiments de Police SS et d’éléments recrutés parmi les prisonniers géorgiens, tartares, arméniens, etc., n’entreprennent l’épuration des maquis, en Dordogne d’abord, ensuite en Corrèze, les autorités allemandes obtiennent de Darnand qu’on leur laisse le champ libre. Darnand, prévenant, assure même l’occupant qu’il recevra le concours des forces du Maintien de l’ordre pour « intercepter les bandes qui tenteraient de sortir des départements soumis aux opérations. »
Le 31 mars, le préfet Trouillé relate dans son journal :
« À 11 heures, ce matin, la préfecture régionale me prévient que les Allemands désireux de poursuivre en Corrèze la destruction des bandes terroristes amorcée en Dordogne, viennent d’ordonner le repli sur Limoges de toutes les unités françaises de Police armée, à l’exception de la Gendarmerie. La mesure vise la garde mobile, les G. MR. et même la Milice […]. »
Par télégramme officiel n° 4813 du même jour le service technique du Maintien de l’ordre donne ses instructions au préfet régional à Toulouse :
« Objet : opération Dordogne, Corrèze.
Primo : Autorités allemandes menant opérations Dordogne, Corrèze, contre éléments terroristes ont demandé que forces Maintien de l’ordre françaises opérant dans ces départements soient ramenées à l’est ligne Limoges, Tulle. Stop. Secundo : Ai décidé en conséquence remettre à votre disposition G.M.R. Quercy et Languedoc. Stop.
Tertio : Vous prie prendre toutes mesures nécessaires pour barrer frontière votre région avec départements Dordogne et Corrèze en vue arrêter ou capturer toute bande ou tout élément terroriste tentant passer sur votre territoire. Stop. À cet effet, utiliser au maximum forces Gendarmerie et G.M.R. stationnées sur votre territoire. Stop. En vue adapter constamment votre dispositif à situation créée région Limoges vous tenir en contact avec préfet régional Limoges qui est en liaison avec commandement des troupes opérant Dordogne, Corrèze. Fin. »
En toute connaissance de cause, le régime associe les forces de l’ordre à l’action entreprise par les Allemands contre les maquis du Limousin. À Toulouse, le préfet régional donne pour mission à la Gendarmerie « de barrer en permanence, et jusqu’à nouvel ordre, à partir du 1er avril, les principales voies de communication venant de Dordogne et de la Corrèze avec 9 pelotons prélevés sur l’ensemble de la région. » Outre les 200 gendarmes mobilisés pour ce verrouillage, le G.M.R. Quercy se déploie dans la région de Souillac (Lot).
En Corrèze, dès que l’occupant entre en action, il neutralise la Gendarmerie de Larches. Dans l’après-midi du 31 mars, l’officier supérieur commandant le détachement qui a investi l’agglomération se présente au chef de brigade. Il lui notifie que les gendarmes passent sous ses ordres. L’interruption des communications téléphoniques, pendant cinq jours, coupe les gendarmes de leur hiérarchie.
Le 1er avril, dans l’ignorance de ce qui se passe à Larches, le commandant de section de Brive se rend sur place. Les troupes d’opérations le gardent à vue pendant plusieurs heures. Finalement il ne recouvre la liberté que sur l’intervention d’un capitaine de la Feldgendarmerie. Cependant, les Allemands lui ordonnent de se tenir à leur disposition. Déjà, dans la soirée du 31 mars, à Brive, l’officier a été contraint d’accompagner des policiers allemands pour les guider jusqu’à la brigade de Vigeois. Dans cette unité, ils exigent que deux gendarmes en civil se joignent à eux pour identifier les personnes de la région.
Entre le 1er et le 5 avril, dans d’autres brigades, Treignac, Uzerche, Juillac, etc., le commandement allemand non seulement a recours à des gendarmes, mais encore il s’empare de documents administratifs confidentiels, liste des étrangers et des Juifs notamment.
Pour compenser le refus des jeunes corréziens d’aller travailler en Allemagne, les troupes d’opérations effectuent une rafle monstre à Brive, dans la période du 3 au 5 avril. La Gendarmerie est une nouvelle fois sollicitée. Le 6 avril, en fin d’après-midi, un général chef d’une colonne allemande requiert le capitaine commandant la section de Brive de fournir, dans un délai de 3 heures, un détachement de 50 gendarmes pour escorter jusqu’à Paris 117 jeunes gens arrêtés au titre du S.T.O., momentanément rassemblés au collège Cabanis. Une fois recensés par un représentant du bureau de placement allemand, les requis pour le travail obligatoire sont conduits en autobus en gare de Brive où ils embarquent à bord de trois wagons de voyageurs. Sous la surveillance de deux pelotons de gendarmes, le convoi quitte Brive pour Paris, via Limoges, dans la soirée du 6 avril. La mission des gendarmes s’achève à la caserne de la Pépinière point de destination initial des requis avant leur départ pour l’Allemagne.
La pression de l’occupant revêt d’autres aspects. Le 7 avril 1944, le lieutenant P…, commandant la section d’Ussel, se rend avec M. Var maire, et le commissaire de Police, à Bédabourg, entre Ussel et Neuvic, où une compagnie de parachutistes allemands du camp de la Courtine vient de se livrer à des actes de représailles contre la population à la suite de l’attaque par des F.T.P., dans la nuit du 5 au 6 avril, de deux camions allemands. Un spectacle de désolation s’offre à leurs yeux : maisons incendiées, habitants chassés de leurs domiciles, bétail emmené, biens pillés, habitants pris en otages. Les soldats du Reich, très excités, poursuivent leurs exactions. Le capitaine des parachutistes reçoit fort mal la délégation. L’officier allemand reproche d’emblée à la Gendarmerie, pourtant alertée, de ne pas être venue au secours de ses hommes la veille, alors qu’ils étaient aux prises avec des « terroristes ». Au lieutenant P… qui justifie sa présence aux côtés du maire et du commissaire de Police il réplique que ce n’est pas la place de la Police française. Les trois hommes sont obligés de se retirer.
Lorsque le lendemain l’adjudant Vergnole se rend dans les hameaux de Pontabourg, Bédabourg et Entraigue pour procéder à l’enquête d’usage consécutive aux méfaits que viennent de commettre les militaires allemands, ces derniers, toujours présents dans le secteur, l’interpellent. Nouveaux griefs d’un officier envers les gendarmes accusés de ne rien faire contre « les hors-la-loi » qui agissent impunément jusqu’aux portes d’Ussel.
Dans les heures qui suivent, le capitaine des parachutistes investit la Gendarmerie d’Ussel avec un détachement. Les armes à la main, les soldats occupent la caserne jetant l’effroi parmi les femmes et les enfants. L’officier se précipite en vociférant dans le bureau du lieutenant P… et l’invective. Avec sang-froid, le commandant de section lui fait observer son manque d’éducation. L’Allemand l’interrompt, le traite d’insolent, puis profère des menaces à son endroit.
Le 10 avril, alors que rien ne le laisse présager, la situation s’aggrave. Deux officiers allemands arrivent à la Gendarmerie d’Ussel. Après avoir convoqué le maire, en sa présence, ils dénoncent une nouvelle fois la passivité de la Gendarmerie dans la lutte contre le maquis. L’avertissement est sérieux pour le lieutenant P… menacé d’arrestation si la Gendarmerie ne se montre pas plus entreprenante contre la Résistance. Pour sa part, le maire est mis en demeure de livrer, dans un délai de deux heures, « les terroristes » responsables de l’accrochage de Pontabourg. S’ils n’obtiennent pas satisfaction ils menacent d’incendier un quartier d’Ussel et de fusiller des otages dont le premier magistrat de la cité et 6 gendarmes.
L’intervention du préfet Trouillé et du maire, M. Vair, auprès du général commandant le camp de la Courtine, évitera le pire à la population mais aussi au lieutenant P…
Dans les arrondissements de Tulle et de Brive les gendarmes rencontrent les mêmes difficultés avec l’occupant. Le 8 avril 1944, la Police allemande arrête le chef Bléhaut, commandant la brigade d’Objat. Durant quarante-huit heures sa famille et ses chefs ignorent tout de son sort. À peine est-il de retour à son poste, le 11 avril, qu’il doit fournir quatre gendarmes à une formation de la Gestapo pour la guider dans la région de Vignols-Saint-Solve. Le commandant de compagnie prévenu rejoint immédiatement Objat. En y arrivant, il constate qu’une dizaine de Nord africains armés, vêtus de bleus foncés, coiffés de bérets, cernent la caserne. Ils appartiennent à la Gestapo française placée sous les ordres de Lafont qui agit en Corrèze sous l’identité d’emprunt de Henry avec le grade de capitaine.
Pratiquement jusqu’à la libération du département, la pression des Allemands sur la Gendarmerie ne se relâche pas. Le 9 juin 1944 ils pénètrent dans la caserne de Tulle, saisissent tous les véhicules, vident les magasins, s’emparent des archives secrètes. À Seilhac, le lendemain, après avoir pillé la brigade, ils arrêtent le gendarme Chatard et le détiennent jusqu’à la fin du mois.
Courant juin, deux gendarmes tombent sous les balles allemandes. Dans la nuit du 9 au 10 le lieutenant P…, commandant la section d’Ussel, met ses gendarmes regroupés au chef-lieu à la disposition du commandant Duret (Craplet) pour participer à l’attaque de la garnison allemande retranchée dans le groupe Jean Jaurès. Le 9 au matin, à la suite d’un échange de coups de feu, le gendarme Decout est mortellement blessé.
À Argentat, le 26, un détachement allemand surgit sur le champ de foire et surprend un groupe de maquisards parmi lesquels se trouve le gendarme Fronty. Le déluge de feu qui s’abat sur cet élément ne lui laisse aucune chance. Le gendarme Fronty est tué sur le coup.
À l’E.P.G. de Brive, plusieurs gendarmes d’encadrement, Laspoussas, Delvey, Chancelet et Jugea notamment, forment au sein de l’école un groupe de résistance. Dès le mois de septembre 1943, contact est pris avec le colonel Gontrand chef de la région 5. Selon les ordres reçus, ils restent à leur poste jusqu’au moment du débarquement. Le 7 juin le groupe rallie le maquis. Le gendarme Chancelet, adjudant-chef au bataillon de l’A.S. de Pique, trouve la mort dans une embuscade, le 29 juillet 1944, au Perrier-de-Beynat (Corrèze).
* *
*
L’épreuve de l’occupation coûte à la Gendarmerie, en Corrèze, la perte de 11 sous-officiers. Sept d’entre eux tombent en service commandé à la suite d’attentats ou d’accrochages fortuits avec des éléments de la Résistance. Trois sont victimes des Allemands lors des combats de la Libération. Probablement y a-t-il lieu de mettre sur le compte de l’épuration sauvage la disparition du gendarme L…, de la brigade de Bort, enlevé le 28 juillet 1944 par un groupe armé. Depuis cette date, sa famille n’a jamais reçu de lui la moindre nouvelle. De fortes présomptions permettent de penser qu’il a été passé par les armes pour avoir, fin 1943, fourni un renseignement dont l’exploitation a entraîné l’arrestation de plusieurs maquisards.
Harcelés par les F.F.I., les Allemands quittent définitivement la Corrèze fin août 1944. Commence alors l’épuration. Elle affecte la Gendarmerie comme toutes les administrations. L’éclairage qu’elle apporte sur le comportement des gendarmes, pendant les années noires, mériterait à lui seul une étude.
Entre le 3 et le 20 septembre, les organisations de Résistance interpellent 11 officiers, gradés et gendarmes à Tulle, Bort, Lapleau, Égletons, Objat, Allassac, Lubersac. Faute de charges suffisantes pour les inculper, la plupart recouvrent la liberté dans les semaines qui suivent. Cependant, en février 1945, trois d’entre eux sont envoyés devant une Cour de Justice.
En 1947, la Cour de Justice de la Vienne inflige au lieutenant L… P…, en poste à Ussel en 1943, 10 ans de travaux forcés et prononce la confiscation de ses biens. D’une phrase lapidaire le commissaire du Gouvernement, dans son réquisitoire, dénonce l’aveuglement de l’officier :
« Si cet homme, dit-il, avait agi intelligemment nous n’aurions pas à déplorer la mort de nombreux Français. »
Son jugement complète le témoignage de l’adjudant commandant la brigade d’Ussel en 1943. Il dépeint son supérieur « comme un homme violent et dur ne connaissant que le règlement. Il n’avait pas confiance en son personnel et ne communiquait ses décisions d’opérations qu’au dernier moment […]. »
Concomitante à l’épuration judiciaire, l’épuration administrative au sein de la Gendarmerie se traduit en Corrèze par différents types de sanctions : mises à la retraite d’office, mises en non-activité pour des périodes de 3 à 6 mois, mutations d’office. On peut estimer à une trentaine le nombre de militaires touchés par l’une ou l’autre de ces mesures. La commission d’épuration siégeant à Paris classe, après examen, la plus grande partie des dossiers qui lui ont été soumis.
À la Libération, des gendarmes de la Corrèze sont aussi à l’honneur. La médaille de la Résistance récompense les mérites de trois gradés (chef Robin, Pourcher, Pradier) et de quatre gendarmes (Carassou, Combes, Marcouyeu, Lefèbre).
D’autres sont cités au cours des combats de la Libération. Même s’ils ne sont pas décorés, on compte par dizaine ceux qui ont aidé les réfractaires, les maquisards, les Juifs. Une quinzaine ont payé le prix de leur complaisance ou de leur passivité. Le régime a sanctionné leur attitude par la révocation, la mise en non-activité durant des périodes variables ou en les plaçant en position de retraite d’office.
À partir de ce panorama sur la situation de la Gendarmerie en zone troublée, on imagine les embûches auxquelles les personnels étaient quotidiennement confrontés dans le reste du pays.
Avant de s’engager par milliers, à visage découvert, dans les combats de la Libération, les gendarmes, au lendemain de l’armistice, ne s’accommodent pas tous de l’ordre nouveau. Progressivement, en ordre dispersé, ils témoignent de leur hostilité à l’occupant.
En métropole, l’institution en tant qu’organisation d’État, représentée à Vichy par sa direction, reste loyale au pouvoir établi jusqu’à sa chute en août 1944. À ce titre, on ne peut la créditer d’avoir joué un rôle dans la Résistance. Plutôt que de parler de Résistance de la Gendarmerie il est plus conforme à la réalité d’utiliser l’expression de faits de Résistance dans la Gendarmerie. Ceux-ci se manifestent essentiellement par des initiatives personnelles et excluent toute impulsion émanant du commandement au sommet. Ce dernier cependant cautionne secrètement le concours apporté aux Services spéciaux de Vichy qui n’ont jamais cessé depuis l’armistice de remplir leur mission contre les forces de l’Axe avant de rallier Alger dans le courant de l’automne 1942.
VI – LE REFUS
CHAPITRE 16 – LES FAITS DE RÉSISTANCE
Les gendarmes acquis à la Résistance agissent, presque toujours, sous le couvert de l’uniforme. Souvent modeste dans ses objectifs, le travail qu’ils accomplissent n’en est pas moins efficace dans sa réalisation.
Parmi ceux qui refusent de plier sous le joug de l’oppresseur et de ses satellites, il y a d’abord quelques pionniers, véritables figures de proue de la Résistance au sein de la Gendarmerie. Dans cette phalange, le chef d’escadron Guillaudot occupe une place de choix.
En juin 1941, l’officier commande la compagnie de l’Ille-et-Vilaine à Rennes. Il refuse d’obtempérer à une réquisition du préfet lui ordonnant de faire charger les gendarmes contre la foule venue fleurir les tombes des victimes du bombardement du 17 juin 1940. À titre de sanction, à la demande des autorités françaises et allemandes, la direction de la Gendarmerie le mute d’office à la tête de la compagnie du Morbihan à Vannes.
Sitôt arrivé dans son nouveau poste, il conçoit l’idée de construire la Résistance sur les structures de la Gendarmerie. À cet effet, il crée un réseau « renseignements et action » qui s’appuie sur l’ensemble des 55 brigades de la compagnie, les cadres étant ceux-là mêmes de la gendarmerie départementale mis à part quelques irréductibles. Quoi qu’il en soit, il assure à son organisation un cadre éprouvé et respecté, un service de renseignements et de transmissions de premier ordre, une grande sécurité morale, bref de solides garanties. Des cadres de carrière et de réserve ne tardent pas à rejoindre le réseau.
En 1941, le Délégué Militaire Régional, avec l’aval de Londres, le nomme chef de la Résistance du Morbihan sous le pseudonyme de « Yodi ». L’officier accomplit un travail remarquable jusqu’à la date de son arrestation le 10 décembre 1943. Un de ses commandants de section, le capitaine S…, interpellé par les Allemands et qui d’ailleurs n’était pas membre du réseau, livre son nom. Torturé par la Gestapo puis déporté en Allemagne, à Neuengamme, le 28 juin 1944, il survit à l’enfer des camps d’extermination et retrouve la France début 1945, très affaibli par sa captivité. Le 15 mai, il réintègre la Gendarmerie en qualité de chef de corps de la 11e légion de gendarmerie départementale.
Par décret du 19 octobre 1945, le général de Gaulle l’admet dans l’Ordre de la Libération. La citation qui accompagne cette distinction résume l’ampleur et la qualité de son combat :
« Commandant la compagnie de Gendarmerie du Morbihan n’hésitant pas, malgré sa situation, à organiser les forces militaires de la Résistance de son département en collaboration avec les officiers F.F.C. en mission. C’est ainsi qu’il mit en place, avec le concours de ses subordonnés, un service de guet et de protection qui permit d’effectuer sans pertes le parachutage de près de 100 tonnes d’armes et de matériels. En outre, organisa un service de renseignements efficace dans les ports de guerre et les défenses côtières qui fit parvenir à l’état-major interallié une documentation précise sur le dispositif ennemi.
Désigné par le Délégué Militaire Régional comme chef départemental F.F.I. du département a réussi à mettre sur pied l’ossature et l’encadrement de 12 bataillons qui participèrent plus tard à la libération du département.
Arrêté le 10 décembre 1943 fut maintenu en prison jusqu’au 28 juin 1944 où il fut torturé à plusieurs reprises. Malgré la douleur ne fit aucune déclaration pouvant mettre en danger ses camarades. Déporté en Allemagne il subit pendant 9 mois une dure captivité.
Belle figure d’officier par son courage, son esprit combatif et sa foi dans les destins de la patrie. »
Autre pionnier de la Résistance dans la Gendarmerie, le capitaine Descamps, commandant la section de Soissons (Aisne). Dès sa constitution il adhère au groupe « Vérité française » de Soissons rattaché au réseau du « Musée de l’Homme » et en devient l’animateur et le chef moral.
À la lecture de la citation à l’ordre de l’armée qui accompagne sa nomination à titre posthume au grade de chevalier de la Légion d’Honneur, on découvre les grandes lignes de son action :
« Chef d’escadron des Forces Françaises de l’Intérieur, magnifique officier animé du plus pur patriotisme et du plus ardent désir de servir. Dès 1941 a participé effectivement à la résistance à l’occupant. Membre du groupe « Vérité Française » il devient rapidement l’âme, le conseiller et le chef moral en organisant les centres de parachutages ainsi que les sabotages de la machine ennemie. Arrêté par la Gestapo, condamné à mort, a gardé le silence malgré les tortures les plus incroyables, préservant ainsi de la mort de nombreuses vies de patriotes. Déporté par la suite a finalement été exécuté le 5 décembre 1942. »
Le 9 octobre 1971, à Aubers, Maurice Schumann lui apporte l’hommage de l’Ordre de la Libération. Il évoque son engagement en ces termes :
« Né pour obéir, a désobéi une fois, la seule fois où cela en valait la peine où cela a été nécessaire, pour obéir à la France. »
Non moins valeureux, le chef d’escadron Vérines commande, au moment de la défaite, le troisième bataillon de la Garde républicaine. Dès le mois d’août 1940 il met sur pied, sous la direction de « Saint-Jacques », un noyau de résistance recruté dans son entourage immédiat (lieutenant Bongat, chef Dufourcq, etc.).
L’organisation s’étend à l’extérieur de la Garde. Le commandant Vérines obtient le concours de militaires de la gendarmerie départementale des légions d’Amiens, de Tours et de Rouen. Il s’agit des colonels Boillin, Raby, des capitaines Albert Morel, Germain Martin, Le Flem, du lieutenant Laurent, de l’adjudant-chef Legrand, des gendarmes Le Guern, Jehan, Chana, Carette, Valencelle, Provin, Raymond.
Arrêté par les Allemands à la fin de l’année 1941, le chef d’escadron Vérines est condamné à mort puis interné en Allemagne à la prison de Düsseldorf. Sa vie s’achève devant un peloton d’exécution, à Cologne, le 20 octobre 1943. Le Gouvernement le décore de la médaille de la Résistance, à titre posthume, par décret du 24 avril 1946, pour les motifs ci-après :
« N’a pas hésité, dès août 1940 à organiser de sa propre initiative un puissant groupe paramilitaire clandestin à Paris et sa banlieue pour lutter contre l’occupant. Grâce à cette organisation a pu obtenir de nombreux renseignements, de grande valeur, sur l’ennemi. S’est immédiatement mis aux ordres du général de Gaulle en s’intégrant au réseau du capitaine Saint-Jacques. Pris par la Gestapo, en fin 1941, pour constitution d’armée clandestine, a été condamné à mort puis déporté en Allemagne, à la prison de Düsseldorf où il avait perdu définitivement la vue.
Son attitude a toujours été exemplaire et digne, en tout point de celle qu’il a eue en 1914-1918. Il laisse une femme et deux enfants. »
Résistants de la première heure, des gendarmes le sont aussi qui n’ont pas la notoriété que confère le grade ou le martyr. Il est juste ici d’évoquer l’un d’entre eux.
Garde d’encadrement au 32e G.R.D.I., Paul Joyeux participe vaillamment à la campagne de France au cours de laquelle il est cité et décoré de la médaille militaire. Prisonnier, il s’évade. Capturé à nouveau, il parvient dans les semaines qui suivent à se faire libérer prétextant qu’il est agriculteur.
Versé dans la gendarmerie départementale, il sert successivement dans les brigades de Remiremont et d’Épinal à partir de 1941. Dès l’été 1940, il noue des relations avec des patriotes qui cherchent à se regrouper pour agir contre l’occupant. Agent P2 au réseau Kléber-Uranus, début 1941, il déploie une activité inlassable, malgré les risques encourus, parvenant même à infiltrer la Gestapo et la Felkommandantur d’Épinal. Lorsque le réseau, pour des raisons de sécurité, est mis en sommeil, fin 1942, il poursuit le combat.
Pour le compte du B.C.R.A., il met sur pied et dirige dans le département des Vosges, de 1943 à septembre 1944, le réseau de renseignement « Mithridate » rattaché au F.F.L. Sous le pseudonyme de « Camille », immatriculé E. 865, il est à la tête d’une cinquantaine d’agents et fournit à Londres, via la centrale de Nancy, des informations inestimables. Il concourt directement à la destruction d’objectifs stratégiques et sauve d’une mort certaine et de l’arrestation des dizaines de personnes menacées.
En janvier 1945, Paul Joyeux reprend son service comme simple gendarme à Épinal et y termine sa carrière, en 1959, adjudant-chef adjoint au commandant de compagnie.
Ce soldat courageux et tranquille ne tire aucune gloire des titres que lui ont valu son engagement dans la Résistance : deux citations, médaille de la Résistance, Légion d’honneur pour services de guerre exceptionnels, médaille des Passeurs, Officier de l’Ordre national du Mérite. Comme il se plaît à le dire « le mérite en revient » à ceux qui l’ont aidé dans sa tâche et dont certains ont été emportés dans la tourmente.
À ces noms s’en ajoutent d’autres pour la plupart ignorés ou tombés dans l’oubli. Rares sont ceux qui connaissent le sacrifice du gendarme Maxime Garin, de la légion d’Amiens, premier militaire de l’Arme tombé face à un peloton d’exécution le 30 décembre 1941 « pour avoir mené une campagne active en faveur de la Résistance. »
Le gendarme Charlot, membre du réseau S.R. Klébler-Uranus, décapité à la hache le 4 janvier 1943 est tout aussi méconnu. L’occupant exécute dans les mêmes conditions, le 28 novembre 1944 à Munich, les gendarmes Delefosse, Seneuze, Defontaine, de la brigade de Vitry-en-Artois, arrêtés dans la nuit du 13 au 14 septembre 1943. Ces sous-officiers appartenaient à l’O.C.M.
Autre résistant intrépide, le gendarme Bouyer, de la brigade de Sées (Orne), qui milite au réseau « Vengeance ».
À la suite d’une dénonciation la Gestapo l’arrête le 7 août 1943 et l’emprisonne à Alençon où il subit la torture. C’est ensuite la déportation dans plusieurs camps.
Son terrible calvaire s’achève dans celui de Nordhausen, en mars 1945. D’abord malade puis grièvement blessé lors d’un bombardement allié il meurt d’épuisement, le 10 avril 1945, trois jours après la libération du camp par les Américains.
La liste est longue de tous ces hommes, officiers et sous-officiers, qui se sont courageusement dressés contre l’occupant et auxquels le destin a parfois réservé un sort tragique. Leur combat ne saurait cependant faire oublier le rôle, aussi humble soit-il, de leurs frères d’armes. Sans prétendre dresser un inventaire exhaustif des actes de résistance que ces derniers ont accomplis, on peut toutefois en donner une idée à travers des exemples.
* *
*
Sous des formes variées, des gendarmes apportent leur aide aux personnes recherchées par l’occupant ou sur ordre des autorités françaises. Début août 1940 se pose la grave question de la démobilisation des militaires de l’armée française ayant rejoint leur domicile, en zone occupée, sans être munis d’une pièce justificative. Or les Allemands considèrent que tous les soldats français présents en zone occupée à un titre quelconque, en traitement dans les hôpitaux, en congé de convalescence, ou ayant rejoint leur domicile après avoir échappé à la capture au moment de leur arrivée, doivent être traités comme des prisonniers de guerre. Il est hors de question de les démobiliser. Assimilés à des fuyards ou à des déserteurs il convient de les livrer aux troupes d’occupation.
Bien que rendu responsable des démobilisations irrégulières, le capitaine Sérignan ordonne aux brigades de la zone nord de régulariser la situation de tous les militaires rentrés dans leurs foyers sans document justificatif. Il organise un service qui délivre des fiches de démobilisation timbrées par les organes militaires habilités de la zone sud. Malgré des incidents et des menaces écrites et verbales du commandement militaire allemand, il mène à bien l’opération. Des milliers de militaires de l’armée française promis à la captivité y échappent.
Des prisonniers évadés, recherchés par la Police allemande, évitent l’arrestation grâce aux fiches établies par les gendarmes. D’autres franchissent la ligne de démarcation sans être inquiétés, sous le couvert de ces pièces. Dans ces conditions, en septembre 1940, l’adjudant Petit, de la brigade de Mérignac (Gironde), facilite le passage en zone libre de 8 militaires qui viennent de s’échapper d’un camp.
Pilotes et soldats alliés en difficulté sur le territoire français trouvent assistance auprès de militaires de la Gendarmerie. Courant janvier 1941, les gendarmes Parbailles et Latus, de la brigade d’Angerville, arrêtent trois soldats anglais, évadés d’un camp, qui se déplacent imprudemment sur la nationale 538. Les fugitifs, résignés, rejoignent sous bonne garde les locaux de la Gendarmerie. À l’abri des regards indiscrets les gendarmes les réconfortent, leur fournissent des vêtements civils, de l’argent et toutes indications utiles, schéma à l’appui, pour passer clandestinement la ligne de démarcation à Saint-Aignan-sur-Selles.
À Châteauroux, le gendarme Marais, de la brigade locale, donne asile à deux soldats britanniques évadés, capturés à Dieppe lors de la tentative de débarquement du 18 août 1942. Il leur procure ensuite des renseignements sûrs pour échapper aux recherches. Ces deux militaires atteignent l’Angleterre indemnes.
Courant décembre 1941, le commandement punit les gendarmes Nicot et Barbaux, de la brigade de Périgueux, qui au cours d’un transfèrement ont facilité l’évasion d’un officier britannique arrêté pour atteinte à la sûreté de l’État. Il s’agit d’un agent du S.O.E., appartenant à la mission « Corsican », largué dans l’arrondissement de Bergerac le 10 octobre 1941 et intercepté par les gendarmes de Villamblard. L’amiral Darlan ordonne son transfert à Lyon pour y être traduit devant le tribunal d’État. Les deux sous-officiers prennent le train avec leur prisonnier, dans la soirée du 17 décembre. Malgré les consignes, ils enlèvent les menottes au Britannique et le laissent s’enfuir. À six heures du matin, en arrivant à Roanne, ils signalent sa disparition.
En mai 1944, deux pilotes anglais sautent en parachute de leur avion en difficulté avant que celui-ci ne s’écrase au sol, dans la région de Giroux (Indre). Les rescapés qui atterrissent dans les parages du point de chute de l’appareil trouvent refuge chez le maire de la localité. Des troupes allemandes arrivent rapidement sur les lieux et commencent à ratisser le terrain. Le capitaine Barbe, commandant la section d’Issoudun, informé de la présence des aviateurs, oriente les recherches des Allemands dans une direction opposée à celle où se cachent les deux hommes. Dès la chute du jour, ces derniers gagnent le maquis d’Issoudun.
En Lorraine, le capitaine Debrosse, commandant la section de Lunéville, membre du réseau d’action et de renseignement « Jean-Marie », en liaison avec le mouvement « Lorraine », dirige en zone libre, par des filières de passage, des dizaines de pilotes alliés tombés avec leurs appareils, au cours de missions de reconnaissance ou de bombardement, au-dessus de la France.
L’adjudant Pradier, commandant la brigade d’Auros (Gironde), prend en charge en mars 1943 quatre aviateurs alliés :
« Au printemps 1943, écrit-il, des officiers américains et anglais tombés en parachute à Saint-Nazaire, au cours d’un combat aérien, arrivaient à la brigade en tenue civile et munis chacun d’un outil de bûcheron, ne parlant pas un mot de français. L’un d’eux me présenta un papier portant la mention « se présenter à la brigade de Gendarmerie à Auros ». À l’aide d’un interprète, curé d’une paroisse voisine, américain de naissance, j’appris que les quatre officiers, au cours d’un combat aérien à Saint-Nazaire, avaient dû sauter en parachute et que des patriotes français les avaient vêtus, leur avaient procuré des outils et acheminé sur la zone libre. Je les fis cacher et ravitailler pendant une semaine. Au bout de huit jours, un membre de la Résistance, M. Lacampagne, vint chercher les officiers alliés. Ils traversèrent la Garonne en barque et, le lendemain, dans la nuit, un avion vint les prendre à Sainte-Bazeilles (Lot-et-Garonne) et les emporta en A.F.N. »
Par l’intermédiaire d’un prêtre, l’abbé Ferrand, les gendarmes d’Avallon apprennent que des pilotes anglais se cachent à l’abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire et que leur arrestation est imminente. Toutes affaires cessantes, ils alertent les moines. Le lendemain matin un détachement de policiers allemands se présente à l’abbaye et perquisitionne. Il n’y a pas la moindre trace de passage ou de séjour des pilotes déplacés dans un autre refuge.
Prisonniers de guerre, membres des forces alliées, mais aussi jeunes gens requis pour le service du travail obligatoire en Allemagne bénéficient de la complicité de gendarmes pour échapper à leur sort. Pourtant, par circulaire en date du 18 août 1943 relative au S.T.O., le chef du Gouvernement met en garde les échelons d’exécution contre toute attitude de complaisance à l’égard des requis :
« À partir de la date de réception des listes de recherches des réfractaires, la responsabilité des commissaires de Police ou commandants de brigade sera engagée vis-à-vis de leur chef sur les conditions régulières de séjour, dans leur circonscription territoriale, de tout jeunes gens nés en 1922, 1921, 1920 et 4e trimestre 1919. »
Pour arriver à ses fins, Laval ne se contente pas de responsabiliser les exécutants, il renforce aussi leurs prérogatives. La loi n° 342, du 11 juin 1943, habilite les préfets à prendre des arrêtés d’internement spéciaux à l’encontre des réfractaires au S.T.O. Ces arrêtés ont les effets attachés par la législation aux mandats d’arrêts. Ils constituent une véritable réquisition à la force publique d’arrêter les défaillants et surtout ils donnent à tous ses membres, policiers et gendarmes, pouvoir de procéder en tous lieux, sans aucune restriction, à toutes perquisitions utiles facilitant ainsi les recherches et les arrestations.
De plus, la Gendarmerie reçoit des consignes strictes. Le chef du Gouvernement ne lui demande-t-il pas de s’attacher « à recueillir des renseignements précis sur le nombre, le lieu de refuge, l’activité, les conditions de vie des réfractaires constitués en groupements illégaux, le plus souvent armés, contre lesquels il convient de prévoir des actions de force […]. »
Les services des Archives départementales détiennent de nombreux procès-verbaux de recherches infructueuses de requis au S.T.O. tel celui établi le 18 août 1943 sous le n° 393 par le gendarme Faye, de la brigade motorisée de Nexon, faisant suite à un avis de recherche concernant le jeune B… de la commune de Lastours (Haute-Vienne). Le rédacteur précise que « l’intéressé a rejoint l’Allemagne ». Or le requis n’a jamais obtempéré à l’ordre de départ et se cache dans un refuge connu du gendarme chargé de l’enquête.
Lorsqu’au mois d’août 1943 la préfecture de la Corrèze ordonne à la Gendarmerie de perquisitionner à Seilhac où de nombreux réfractaires couchent chez eux le soir, les gendarmes les préviennent et rédigent des procès-verbaux qui constatent le résultat négatif de leurs opérations.
Dans l’Indre, le commandant de compagnie recommande à ses brigades de ne pas inquiéter les réfractaires employés dans les fermes de la région où leur nombre dépasse le millier.
Non seulement des gendarmes renseignent les requis sur les dangers qui les menacent, mais encore ils leur trouvent des cachettes dans la campagne ou bien facilitent leur embauche dans des exploitations prioritaires les mettant à l’abri d’un départ pour l’Allemagne.
D’autres gendarmes provoquent l’évasion de réfractaires comme l’adjudant Dussidour, de la brigade de Lubersac (Corrèze), puni d’ailleurs pour ce motif le 31 juillet 1943.
Autre forme d’intervention en faveur des requis. Lors de la visite médicale d’incorporation au S.T.O., des gendarmes de la brigade de Chef-Boutonnet (Deux-Sèvres), chargés de renseigner les fiches de visites des requis, inscrivent de faux renseignements. Ils augmentent les tailles, diminuent les poids et les tours de poitrine. Par la suite, des jeunes gens sont classés dans une catégorie inférieure et dispensés. Dans le même département, à Niort, avec la complicité d’un employé du S.T.O., l’adjudant-chef Amblard, commandant la brigade, provoque l’exemption d’une centaine de jeunes gens en les rayant des listes.
En mars 1943, le secrétaire du commandant de l’école préparatoire de Gendarmerie de La Fontaine-du-Berger reçoit l’ordre d’établir, pour tout élève démissionnaire, une fiche signalant que l’intéressé devient disponible pour le S.T.O. et de l’adresser au préfet du lieu où il se retire. Une fois les pièces signées par le commandant de l’école, ce sous-officier prend l’initiative, systématiquement, de les incinérer.
Des jeunes gens partis en Allemagne, au titre du S.T.O., reviennent chez eux en permission, après un an d’absence et décident de ne pas repartir. Les autorités adressent à la Gendarmerie des avis de recherche. Des brigades les renvoient. Elles se contentent de signaler qu’ils ont quitté leur domicile après l’expiration de leur permission.
Courant 1943, le chef Cazals « oublie » de retirer, malgré les ordres reçus, les titres d’alimentation à une soixantaine de réfractaires au S.T.O. de sa circonscription ce qui équivaut à l’octroi d’un titre qui les place en situation régulière. Malgré une dénonciation qui entraîne une enquête des renseignements généraux et de ses chefs hiérarchiques, il évite le pire grâce au rapport favorable de son commandant de section.
Les opérations de police montées à partir de février 1943 contre les « groupements illégaux » de réfractaires, dans les régions refuges (Massif-Central, Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, etc.), sont rarement fructueuses. Avec la complicité de la population, de fonctionnaires et de gendarmes les réfractaires évitent les forces de l’ordre. Les exemples abondent de gendarmes désignés comme guides qui égarent les recherches.
Au mois de septembre 1943, le général Martin obtient du ministre de l’Intérieur que les commandants de compagnie ne fournissent plus aux préfets, deux fois par mois, comme l’imposait une dépêche ministérielle du mois de juin, un état de renseignements sur les résultats obtenus dans la recherche des insoumis et des réfractaires. La suppression de ce document permet à certaines unités de masquer leur inertie et le sabotage des ordres.
La complaisance des gendarmes patriotes s’étend, sans discrimination, à toutes les victimes du régime et de l’occupant. À la sollicitude manifestée aux Juifs, précédemment évoquée, s’ajoute celle apportée aux internés politiques, aux communistes, aux résistants.
Sur réquisition du préfet du Tarn, le 24 mars 1943, trois pelotons de Gendarmerie placés sous les ordres d’un officier transfèrent, par voie ferrée, 200 internés politiques du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) sur les chantiers de construction du mur de l’Atlantique (organisation Todt) à Bayonne où ils doivent être répartis dans les secteurs de Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure. Tout au long du trajet le signal d’alarme ne cesse de retentir. Le train s’immobilise régulièrement. Pendant les arrêts, au milieu d’indescriptibles bousculades, les internés en profitent pour s’enfuir. Les gendarmes ne réagissent pas. À l’arrivée, 76 internés manquent à l’appel. Un des fuyards, Joseph Sorrentini, quelques années après la Libération, s’interroge sur l’attitude des gendarmes :
« Les gendarmes, rapporte-t-il, ont fait ce qu’ils ont pu, ou alors ils ont fait semblant ; en tout cas, ils n’ont jamais fait usage de leurs armes ; cette attitude a facilité les évasions. »
Sans doute, ignore-t-il les sanctions infligées aux gendarmes à la suite de cette affaire incroyable. On leur reproche précisément de ne pas avoir employé la force des armes pour s’opposer aux tentatives de fuites. Le lieutenant F…, commandant le détachement, est mis aux arrêts de rigueur pour le motif suivant :
« Commandant de l’escorte par voie ferrée d’un convoi important d’internés administratifs et s’étant trouvé aux prises avec de très graves difficultés provenant à la fois de l’état d’esprit des individus transférés et de l’insuffisance des dispositions matérielles prises en dehors de lui pour effectuer le transfèrement, n’a pas eu toutes les initiatives nécessaires et a manqué d’autorité en ne prescrivant pas à son personnel l’emploi des moyens de coercition dictés par les circonstances. Est, en particulier, responsable de multiples évasions qui se sont produites dans une partie du trajet. »
Les gendarmes Encely, Godefroy, Raynal, Gaspart, Durant encourent des arrêts de rigueur et sont suspendus de leurs fonctions pendant huit jours.
À la suite d’une dénonciation, le 12 septembre 1942, le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur saisit le préfet de l’Allier pour lui signaler la passivité des gendarmes de Bourbon-l’Archambault dans la répression des activités communistes. Les agitateurs, d’après le délateur, ne sont pas inquiétés et organisent des réunions au su et au vu des gendarmes qui ne réagissent pas. Le secrétariat général du chef de l’État, destinataire de la lettre anonyme mettant en cause les gendarmes, note à l’intention du secrétariat d’État à l’Intérieur, qu’il « serait urgent de déplacer les gendarmes de Bourbon-l’Archambault dont les rapports avec les communistes des communes qui sont dans leur ressort n’est pas sans émouvoir les populations […]. »
Des militaires de la Gendarmerie, appartenant à la Résistance ou agissant isolément, en poste à proximité de la ligne de démarcation ou des frontières espagnoles et suisses, facilitent le passage des candidats à la liberté : prisonniers évadés, soldats alliés, Juifs, réfractaires, militaires de l’armée d’armistice après leur démobilisation. Ils couvrent aussi l’acheminement de documents : courriers, valeurs, etc.
Henri Frenay, fondateur du mouvement « Combat », rapporte comment, en 1941, il franchit la ligne de démarcation avec l’aide du commandant de section de Tours :
« Pour passer la ligne je dois me confier au capitaine Morel, un officier de Gendarmerie. À Tours je me fais sans peine reconnaître de Jacques (c’est le pseudonyme de l’officier). Je déjeune chez lui. L’après-midi, une voiture de la Gendarmerie m’amène à un petit village, non loin de la ligne de démarcation. Le conducteur frappe à une porte, il ne rentre même pas. À l’homme qui ouvre il dit simplement :
– Rien de nouveau ?
– Non, tout va bien.
– Alors vous passerez ce soir ce monsieur. Choisissez pour lui le meilleur itinéraire. »
Ces actions, apparemment banales, sont dangereuses. Au moment où le capitaine Morel se dispose à franchir la ligne de démarcation, le 25 juin 1941, porteur de documents compromettants, en provenance de Paris, sur les installations militaires allemandes en cours de construction en Normandie ainsi que d’un plan complet de la base de sous-marins de Saint-Nazaire, les Allemands l’arrêtent. Emprisonné en Allemagne il tombe sous les balles d’un peloton d’exécution, à Cologne, le 9 octobre 1943.
Pour faire franchir la ligne de démarcation à des personnes recherchées, le capitaine Fernand Rombach recourt à un procédé simple mais efficace. Ses hôtes prennent place dans la voiture de la Gendarmerie, menottes aux poignets. Un ordre de transfèrement, confectionné par les gendarmes, sert de sésame devant les postes de contrôles tenus par les Allemands qui laissent passer, sans aucune difficulté, le véhicule de service de l’officier.
Au début de l’année 1941, le capitaine Sérignan, avec la complicité d’officiers de Gendarmerie des territoires occupés, organise à Bourges un point de franchissement clandestin de la ligne qu’utilisent des prisonniers évadés, des militaires de l’Arme et des civils menacés d’arrestation. Lorsque la Gendarmerie de la zone nord est rattachée fictivement à la Délégation générale du Gouvernement français, c’est par Bourges que transite le courrier confidentiel en provenance ou à destination de la direction.
Qu’ils appartiennent aux brigades implantées près de la ligne de démarcation ou aux unités supplétives qui y sont déplacées pour en assurer la surveillance – dans la région de Bazas (Gironde) trois pelotons contrôlent la ligne sur une longueur de soixante kilomètres – des gendarmes apportent leur concours aux clandestins. À cet effet ils leur indiquent les points les plus propices au franchissement, l’emplacement des postes allemands, les heures des patrouilles, les mesures de prudence à observer, les noms des passeurs, les lieux de refuge, etc.
De juillet 1941 à février 1942, le capitaine Peytou, commandant la section de Mont-de-Marsan, transporte des documents sensibles au profit du réseau « Jade-Amicol ». Le chef de brigade d’Aire-sur-Adour, Arsène Le Bars, en est un des membres. Muté à Paris en 1942 à la suite de sa promotion au grade de lieutenant il y poursuit son activité. Des réunions se tiennent à son domicile, à la caserne Nouvelle-France, dans le XXe arrondissement, dirigées par le colonel Ollivier fondateur du réseau. À la Libération Le Bars en devient le liquidateur.
À la frontière espagnole, le dispositif de la Gendarmerie, articulé en secteurs commandés par des officiers, est très dense. La prévention et la répression des passages clandestins constituent la principale mission.
Tous les personnels n’obéissent pas aux ordres. Dans les Pyrénées-Orientales, le gendarme Cressonnier recueille le 7 janvier 1944 un pilote canadien qui s’est égaré à proximité de la frontière. Il l’héberge et organise son passage en Espagne en même temps que celui de 6 aviateurs américains, dont un colonel, acheminé sur Banyuls-sur-Mer par une organisation de la région parisienne avec laquelle Cressonnier est en liaison. Le 14 mai, ce sous-officier tombe dans les griffes de la Gestapo. Traduit devant un Conseil de guerre le 15 juin, il est condamné à la peine de mort. L’exécution n’a pas lieu. Le 19 août 1944, il s’évade à Aramond (Gard) lors du mitraillage par l’aviation alliée du train de déportés, dans lequel il se trouve, en route pour l’Allemagne. Complice de son activité pour avoir « favorisé le passage clandestin de la frontière », son épouse est déportée.
Les risques encourus par ces gendarmes et leur entourage ne sont pas illusoires. On en a encore la preuve courant mars 1944. Le Gendarme Salban, d’Agen, accompagne de Nérac à la frontière espagnole les onze membres de l’équipage d’une forteresse volante américaine abattue dans la région de Cocumont. Via la péninsule ibérique tous gagnent sains et saufs l’Angleterre. À peine ont-ils quitté le Lot-et-Garonne, la Gestapo identifie M. Bianco qui les avaient hébergés avant de les confier au gendarme Salban. Le malheureux est fusillé sur-le-champ.
À la frontière suisse, un bureau mixte italo-allemand, installé à Annemasse, coordonne la surveillance à laquelle participent les gendarmes français. Pendant un an, de janvier 1943 à janvier 1944, l’adjudant Genoud commandant le poste de Moëllesulaz organise une filière de passage pour le compte du réseau « Gilbert » rattaché à l’Intelligence Service. Le gendarme Curtet et deux femmes qu’il a recrutées, Marguerite Marmoud et Irène Gubier, l’assistent. Chaque nuit, dans un sens ou dans l’autre, les passages se succèdent : résistants appartenant à diverses organisations, Juifs pourchassés, agents de l’Intelligence Service, prisonniers évadés, militaires alliés, personnalités (colonel Groussard, Dejussieu-Pontcarral, Rosenthal, Valette d’Osia, Mangin délégué militaire pour la zone sud, etc.). L’adjudant Genoud déserte, courant janvier 1944, à la suite de la découverte par les Allemands de son activité clandestine. Il se réfugie dans un premier temps à Annecy puis franchit la frontière à Saint-Julien, déguisé en curé, sur un corbillard.
André Devigny, chef de la branche lyonnaise du réseau « Gilbert », a rendu hommage à l’équipe formée par l’adjudant Genoud. À ce sujet il écrit :
« L’adjudant Genoud, le gendarme Curtet, Marguerite Marmoud, Irène Gubier apportèrent à la cause commune une si large contribution que je dirai aussi « que jamais, autant de gens, durent à si peu, tant de reconnaissance » […]. »
Les gendarmes apportent leur contribution à la protection des dépôts d’armes et de matériels soustraits à l’ennemi et aux opérations de ravitaillement de la Résistance. Le commandant Mollard, maître d’œuvre du C.D.M. (conservation du matériel) de l’armée de Terre, destiné en réalité à couvrir sous les mêmes initiales le service du camouflage du matériel, reçoit à la démobilisation de l’armée, en novembre 1942, l’aide de gendarmes.
Dans le Lot, à Sousceyrac, ses collaborateurs installent une fabrique d’automitrailleuses qui fonctionne jusqu’en avril 1943, après avoir réalisé plus de 125 engins. Les gendarmes connaissent la situation et servent d’intermédiaires pour l’acheminement du courrier adressé au responsable de l’usine. Lorsque l’occupant découvre l’existence de l’installation, le « gérant » s’enfuit grâce à la complicité des gendarmes de la brigade. Ces derniers neutralisent, pendant deux heures, les policiers allemands en feignant de les prendre pour des agents anglais. Le propriétaire des locaux M. Canet, prévenu à temps, réussit à fuir avec sa famille.
Intégrés aux équipes de camouflage du C.D.M., les gendarmes transportent en lieu sûr effets d’habillements, armes, matériels divers. Jamais, par la suite, ils ne dévoilent ces emplacements malgré les sanctions prévues par les autorités allemandes qui exigeaient expressément la remise de tous les dépôts.
Pour faciliter la tâche du C.D.M., les gendarmes établissent secrètement la liste des personnes sûres susceptibles d’accepter de stocker du matériel de guerre dans des caves, granges, immeuble, combles, etc., et les remettent aux officiers responsables de l’armée de Terre. Par la suite, ils surveillent discrètement les dépôts constitués dans leur ressort. En juillet 1943, le chef Pradier, à la brigade d’Auros, apprend que la Milice s’apprête à perquisitionner au domaine de « Vergnes » chez Madame Leclerc de Hautecloque, belle-sœur du général Leclerc. Un dépôt de 7 000 bottes en caoutchouc, des masques à gaz et des pneus y sont entreposés. À temps, il fait enlever et cacher dans un autre endroit tout ce matériel. Probablement évite-t-il de terribles représailles à ceux qui avaient accepté de le détenir.
Autre type d’action à l’actif de militaires de la Gendarmerie. Sur l’ensemble du territoire, certains participent à la réception de parachutages. Ils n’hésitent pas à entreposer des containers d’armes dans les dépendances de leurs logements avant qu’ils ne soient répartis par les chefs de la Résistance.
Les gendarmes Tellion et Dommanget, de la brigade de Buzançais (Indre), agissent de cette façon comme leurs camarades de Sancoins dont l’action a été évoquée.
Le 21 avril 1944, la Gestapo, sur dénonciation, arrête le chef Riu, les gendarmes Bidart, Goualouic et Bounichou de la brigade de Bouglons (Lot-et-Garonne). Eux aussi concourent depuis le mois de janvier à des réceptions de parachutages et à des transports d’armes. Seul, le gendarme Chambon réussit à s’échapper. Bidart et Bounichou ne survivent pas à la déportation. Le premier disparaît début avril 1945 et le second en novembre 1944.
D’autres gendarmes veillent à la sécurité des terrains de parachutages. Au cours de services de nuit, ils détournent la circulation des routes avoisinantes pour empêcher que les opérations ne soient troublées par des visiteurs, donner si nécessaire l’alerte et le cas échéant, retarder l’arrivée des Allemands. À Bletterans (Franche-Comté), l’élément de la Résistance chargé de la réception des parachutages et de l’accueil de personnalités sur le terrain de Coages, baptisé « Orion », reçoit le renfort des gendarmes de la brigade. Ils interdisent l’accès de la zone d’atterrissage aux intrus. En quelques mois, ils couvrent des dizaines d’arrivées et de départs pour l’Angleterre. Les résistants qui attendent un avion pour quitter la France trouvent souvent asile dans leurs familles. Lucie Aubrac a rendu hommage au gendarme Roblin et à son épouse. Fin novembre 1943 le couple l’accueille :
« M. et Mme Roblin habitent en plein bourg une jolie petite maison avec un jardin. Ce sont des gens près de la retraite qui ouvrent pour nous tous la porte de leur logis et acceptent, du même coup, de rompre avec une vie sans histoire. Je repense aux garçons de mon groupe-franc, certains avaient été membres du Parti communiste, d’autres avaient milité à la C.G.T. Pour eux le chemin de la désobéissance était relativement aisé : jeunes, habitués aux luttes politiques ou syndicales, la Résistance était dans la continuité de leurs actions passées. Mais pour un gendarme, presque en fin de carrière, dont la vie a été consacrée au respect de l’ordre, quel problème de conscience que cette décision de basculer dans la Résistance, le mensonge, la clandestinité.
Nous sommes émus, note-t-elle, quand il nous dit, le soir, au dîner : « Je considère qu’il est de mon devoir de militaire de ne pas accepter la défaite et l’occupation, donc il est tout à fait normal que je vous cache chez moi. Je deviens receleur. »
Un receleur ! M. Roblin ne trouve pas un autre mot pour se qualifier. »
Un incident se produit le 8 février 1944. Un Hudson lourdement chargé effectue un décollage difficile dont le sol porte les traces. Une grande animation règne dans le secteur qui attire l’attention des Allemands. La Gestapo se rend sur place le lendemain et découvre des indices de passage de l’aéronef. Les gendarmes de Bletterans, interrogés, prétendent n’être au courant de rien.
Deux mois plus tard, le 8 avril, un commando du S.D. cerne la brigade et arrête le chef Bodevin, le gendarme Lamanthe et Madame Scheibel épouse du gendarme Scheibel. Ce dernier réussit à s’enfuir. Les deux gendarmes déportés en Allemagne meurent respectivement le 9 janvier et le 5 mars 1945. Madame Scheibel survit à l’enfer de Ravensbrück.
Dans le Pas-de-Calais, des gendarmes de la brigade de Croisilles (Laurent, Lemaire, Maline, Gérard) et d’Arras (adjudant Camus) assurent la sécurité de terrains de parachutage du réseau W.O. (Sylvestre-Farmer). À Béthune, les gendarmes Desmarchellier, Caraux, Baillet, Lecomte, Graves, Charles transportent des armes parachutées pour le compte de la même organisation et les cachent dans la caserne avant de les répartir.
Des gendarmes adoptent une attitude passive en ne signalant pas aux autorités, l’existence de terrains de parachutages. Homologué au printemps de l’année 1943 le site désigné sous le nom de code de « Chénier », au lieu-dit la Fombelle (Cantal) et la Luzette (Lot), se trouve à quelques kilomètres de la brigade de Sousceyrac. Il s’agit du centre de parachutage le plus important de la France du sud. Les Britanniques, depuis sa mise en service, y larguent des dizaines de tonnes d’armes utilisées pour approvisionner les régions R4, R5 et R6. En même temps, il permet la réception d’agents parachutés ou débarqués. À partir de 1944 le terrain devient un centre de radioguidage pour les avions alliés ce qui nécessite en permanence la présence d’une équipe au sol. Jamais les gendarmes de Sousceyrac ne dévoileront la présence de ce complexe.
Quelquefois, à la suite d’erreurs de largage, du matériel tombe en dehors des zones de réception prévues. Des témoins pris de peur alertent la Gendarmerie. Malgré l’obligation qui est faite aux gendarmes de saisir directement les autorités allemandes et hiérarchiques, ils s’abstiennent de rendre compte. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1944, la R.A.F. parachute du matériel et des armes sur la piste balisée du Mont-Mouchet. L’un des avions, pour une raison inconnue, libère son chargement sur la centrale électrique du Ranc, en bordure de la Truyère. Attirés par le bruit de l’avion les gardiens de la centrale sortent et aperçoivent, jonchant le sol, de nombreux parachutes. Ils alertent la brigade du Malzieu. Le chef Cazals au lieu de prévenir les autorités se rend immédiatement sur les lieux et avec l’aide de plusieurs personnes dissimule les containers dans un sous-bois à l’abri des regards indiscrets. Au lever du jour un détachement du maquis, prévenu par ses soins, enlève tous les containers.
Des gradés préfèrent rendre compte mais prennent la précaution de différer l’envoi de l’information aux autorités et laissent le temps aux maquisards, mis dans la confidence, de venir récupérer le matériel.
Les initiatives en faveur de la Résistance dépassent le cadre des parachutages, transports et camouflages d’armes. Elles prennent des formes inattendues. En Haute-Savoie, le commandant Humbert Clair, officier démobilisé de l’armée dissoute, prend le commandement de l’A.S. dans le département. Les gendarmes n’ignorent pas sa présence dans les Glières. Alors qu’il doit émarger chaque mois le registre tenu par la Gendarmerie relatif aux officiers démobilisés, un militaire de l’Arme signe à sa place. D’où son étonnement : « Après la libération, rapporte-t-il, j’ai demandé à voir le fameux registre et j’ai pu constater que très ponctuellement, j’avais apposé, chaque mois, ma signature à l’endroit prévu. Quel est le gendarme qui s’est substitué à moi et qui, au mépris de la loi, a joué les faussaires ? J’aurais aimé le savoir ne serait-ce que pour le remercier. Je n’ai jamais pu retrouver cet homme qui était sûrement un patriote. »
Quand, pour se ravitailler, des maquisards s’emparent dans les mairies des tickets de rationnement, des gendarmes pourtant alertés, réagissent tardivement. Les enquêtes diligentées sur ces affaires sont de pure forme. À Thaninges (Haute-Savoie), maquisards, secrétaire de mairie chargé de la distribution des tickets et gendarmes mettent au point un stratagème pour ne pas inquiéter les résistants auteurs de ces actions. Par agent de liaison interposé le maquis avertit le responsable de la mairie du jour et de l’heure arrêtés pour l’enlèvement des titres. Le secrétaire de mairie fournit ces éléments aux gendarmes qui n’interviennent qu’à retardement. Les enquêtes n’aboutissent jamais au moindre résultat. Le procédé utilisé permet en outre aux gendarmes d’agir, avec une certitude suffisante, contre les malfaiteurs de droit commun qui ne font pas connaître leurs intentions à l’avance.
Des milliers d’enquêtes relatives à des sabotages, des parachutages, des évasions, des distributions de tracts sont déformées pour protéger les résistants. Dans les procès-verbaux et rapports on trouve invariablement les mêmes formules « auteurs et directions prises inconnus » où encore « les recherches continuent ». Finalement, rien n’est fait qui pourrait compromettre la sécurité des individus recherchés, souvent d’ailleurs, connus des gendarmes.
L’imagination, pour tromper l’occupant, n’a pas de bornes. Mars 1944, les Allemands interceptent un parachutage sur le terrain du « Vincet » à proximité de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne). Ils saisissent une camionnette chargée de containers. Malheureusement le véhicule appartient au chef local de la Résistance. Celui-ci a réussi à s’enfuir, mais a abandonné sur place les papiers afférents au véhicule. Les gendarmes Mary et Cluzel parviennent à l’innocenter en établissant un procès-verbal de vol de véhicule antérieur au parachutage.
Des officiers, des gradés et des gendarmes avertissent les clandestins des dangers qui les guettent : barrages routiers, opérations de police, ordres d’arrestation à exécuter.
Dès la constitution des maquis, fin 1942 début 1943, les autorités administratives font pression sur la Gendarmerie pour qu’elle fournisse des renseignements à leur sujet. Malgré la volonté de ne rien voir, il faut bien donner l’impression que l’on ne néglige pas les recherches. Des brigades s’arrangent alors pour communiquer des informations erronées ou déformées. S’il y a danger imminent, on n’hésite pas à donner l’alerte. Au mois d’avril 1943, le capitaine Caubarrus commandant la section de Marvejols (Lozère) a connaissance d’une action projetée par l’intendant de Police de Montpellier contre un maquis stationné près de Saint-Germain-du-Teil. Une personne sûre de ses relations prévient les maquisards. Lorsque les G.M.R. arrivent ils ne découvrent que quelques indices de passage.
La contribution qu’apportent les gendarmes aux Services spéciaux, qu’ils y soient détachés ou à titre de « correspondants », constitue une facette méconnue de leur activité anti-allemande. L’artisan de leur engagement n’est autre que le capitaine Paillole. Au lendemain de la défaite, ce dernier, chef adjoint du contre-espionnage, réorganise le dispositif de son service pour qu’il soit en mesure de poursuivre l’exécution de sa mission avec toute l’efficacité requise.
Dès le mois de septembre 1940, il obtient un rendez-vous avec M. Chasserat, directeur de la Gendarmerie et de la Justice militaire. D’emblée, un dialogue franc se noue entre les deux hommes. Le capitaine Paillole n’a-t-il pas, à sa sortie de Saint-Cyr, servi dans la Gendarmerie successivement en qualité de stagiaire, à l’école d’application de Versailles, puis dans la G.R.M. à Lyon, avant de rejoindre les Services spéciaux. Son interlocuteur, comme il le lui demande, est favorable à une répression rapide et exemplaire des affaires d’espionnage. Il accepte d’une part de sensibiliser à ce problème les magistrats des tribunaux militaires placés sous son autorité. De l’autre, il consent à accorder le concours de la Gendarmerie. Sur l’heure, il charge le général Fossier, sous-directeur, d’en négocier les modalités avec le capitaine Paillole.
De la discussion se dégagent plusieurs points positifs. Un : principe de la participation de l’Arme à la lutte contre l’Axe. Deux : détachement de personnels dans les postes T.R. (Travaux Ruraux, couverture du service de C.E.). Trois : acheminement des courriers les plus secrets sous le couvert des brigades. Ces points d’accord ne donnent pas lieu à l’établissement d’un protocole car, selon les propres termes du général sous-directeur, « il ne faut pas que la Gendarmerie, en tant qu’institution d’État, soit prise en flagrant délit d’hostilité contre l’Axe. »
Le capitaine Paillole, dès lors, peut commencer à recruter, assuré du soutien du général Fossier qui lui précise :
« Si l’un de mes officiers vous manifeste un quelconque scrupule de conscience, engagez-le à venir s’ouvrir à moi ! »
Le capitaine Hugon, mis à la disposition du contre-espionnage, dirige, sous le pseudonyme d’Hurel, le poste T.R.114 de Lyon jusqu’en 1943, date à laquelle celui-ci est neutralisé par la Police allemande. Le lieutenant Darme, commandant la section de Poligny, apporte son aide à T.R.114. Son rôle consiste à faciliter la tâche des passeurs officiels qui acheminent des recrues volontaires pour servir dans l’armée d’Afrique. Il s’emploie à recueillir des renseignements auprès de ces recrues et surtout à détecter les agents allemands qui, sous une fausse identité et sous des déguisements de circonstance, tentent de s’introduire en zone libre. Dans un rapport d’activité du 1er novembre 1941 l’officier évalue à 1672 le nombre des engagés dirigés sur Lons-le-Saunier, prélude à leur départ vers Marseille. En novembre 1942 le capitaine Delmas prend la direction de T.R.117 à Toulouse, au départ pour l’A.F.N. du titulaire du poste le capitaine d’Hoffelize. Il n’y reste que quelques mois. Son activité anti-allemande entraîne son arrestation. Il est déporté à Dachau où il meurt le 9 décembre 1944.
Le commandement détache également des sous-officiers dans les Services spéciaux. Le gendarme Saint-Jean y sert en qualité d’archiviste. En 1943 les Allemands découvrent à Ledenon (Gard), dans la propriété de M. Favre de Thierrens, le dépôt d’archives surveillé par le gendarme Saint-Jean camouflé en jardinier. Ce sous-officier est déporté. Il retrouve la liberté en 1945. Le gendarme Herrmann fait partie d’une équipe volante T.R. chargée d’effectuer des liaisons et de rechercher des terrains de parachutages. Pendant un mois, en 1943, il assure la retransmission de tous les messages provenant des postes T.R. Ce sous-officier, à la Libération, quitte la Gendarmerie pour servir dans l’armée où il termine sa carrière avec le grade de commandant.
Si le nombre de permanents détachés par la Gendarmerie dans les Services spéciaux ne représente que quelques dizaines d’hommes, en revanche, l’effectif des « correspondants », officiers et sous-officiers, est nettement plus élevé. Les chefs des différents T.R. et leurs collaborateurs s’appuient sur eux en toute confiance.
Fin 1940, le poste T.R.117 de Toulouse dispose pour ses liaisons de la Gendarmerie. Le lieutenant Getten alias « Sermont » officier traitant du C.E. en donne témoignage :
« À la différence de bon nombre de services de l’armée et de la Police, la Gendarmerie, avec des officiers comme le commandant Baggio de Perpignan, l’adjudant Poncet de Banyuls ou le lieutenant Kermadec, adjoint de Baggio, ou le commandant Chaignaud, successeur de Baggio, a toujours manifesté, même après notre rupture avec Vichy en 1942, un patriotisme et un esprit de résistance sans lesquels l’action de T.R.117 eût été vite rendue impossible à cause des tracasseries des officiels de Vichy, puis plus tard, à la répression allemande, notamment en ce qui concerne nos liaisons, les protections officielles apportées à nos agents et à nos réseaux de passage clandestin, à partir surtout de 1942 […]. »
De septembre 1940 au 15 avril 1943, le chef Pradier communique aux Services spéciaux à Toulouse, par l’intermédiaire du commandant de section de cette ville, tous les renseignements sur les déplacements des troupes d’opérations dans un rayon de 60 à 100 kilomètres de profondeur.
André Fontès, cadre permanent du réseau Morhange, signale l’action du capitaine Guiochon de la Gendarmerie d’Agen :
« Il me renseignait sur les agissements de la Gestapo de cette ville et des agents français qu’elle avait à sa solde, aiguillant les enquêtes sur des fausses pistes lors d’opérations que nous menions dans la région et allant jusqu’à nous donner asile, dans la Gendarmerie, alors qu’il était en possession de fiches de recherches, en provenance des polices de Vichy, qui comportaient l’ordre de m’arrêter. »
Effectivement, le capitaine Guiochon centralise les renseignements recueillis sur les déplacements des Allemands, la variation de leurs effectifs, l’activité de la Gestapo et de ses agents. Il les transmet soit au lieutenant « Marnier » du 2e bureau, soit à Taillandier chef du réseau Morhange. En janvier 1944, une nuit, l’officier abrite le groupe d’action « Marcel » du réseau Morhange qui, le lendemain, avec trois autres équipes arrête et exécute, R…, B…, H…, agents de la Gestapo.
Toujours pour le compte des Services du colonel Paillole, un subordonné du capitaine Guiochon, le chef Foucrit, procède à des travaux de documentation. Au mois de mai 1943 il relève sur une carte les emplacements des travaux de fortification effectués dans la région de Saint-Malo. Le gendarme Belot, de la même compagnie, est spécialement chargé de recenser les cantonnements des troupes allemandes dans la région d’Agen et la liste des Français compromis avec la Gestapo. Le chef Dussour, de janvier 1943 à avril 1944, camoufle des postes émetteurs. Dans la seule légion de Gascogne, le colonel Cabanié, le chef d’escadron Demoyen, les capitaines Guiochon, Abadie et plusieurs dizaines de sous-officiers courageux travaillent ainsi dans l’ombre.
Le 3 novembre 1985, à Toulouse, en présence des rescapés du groupe Morhange et de son président André Fontès, le colonel Paillole délivre un diplôme de reconnaissance aux brigades de Gendarmerie de Toulouse Saint-Michel, Auch, Saint-Gaudens, Gimont, l’Isle-Jourdain, Mauvezin, Saint-Lys, Léguevin, Nailloux, Cologne et Agen pour l’aide apportée à ses Services dans l’accomplissement de leurs difficiles missions. À cette occasion, il remet à l’adjudant-chef Botet, ancien commandant de brigade à Saillagouse, les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Ce gradé a facilité le passage en Espagne, via les Pyrénées, à de nombreux agents des Services spéciaux, à des chefs de la Résistance et à des patriotes pourchassés par les Allemands.
L’action du capitaine Abadie, de la légion de Gascogne, en faveur du 2e bureau, illustre le travail obscur mais qui porte des fruits réalisé par les gendarmes hostiles à l’occupant. Dès son arrivée à Toulouse, en 1941, l’officier accepte d’apporter son concours aux réseaux tissés par le capitaine Paillole. En matière de renseignements, il communique régulièrement les informations recueillies par la Gendarmerie sur les menées des commissions allemandes d’armistice, les groupes collaborationnistes, les postes de l’Abwehr, le S.D., la Gestapo et ses complices. Par la suite, il signale l’emplacement des barrages tenus par la Milice et la Police allemande, fournit des indications sur la date des transfèrements de patriotes emprisonnés. Il s’occupe de faire acheminer le courrier du S.R. entre les postes intérieurs et extérieurs du réseau S.S.M./F.T.R. Il héberge les agents des réseaux menacés d’arrestation. Le lieutenant Robert Terrès, du 2e bureau, trouve asile chez lui, après son évasion de la prison de Castres, fin octobre 1943.
« J’ai emménagé, écrit-il, pour près d’une semaine chez mon ami, le capitaine Abadie. Sa femme était aux petits soins pour moi, j’ai pu me reposer sans problème et faire soigner par le docteur Lannelongue mes genoux endommagés au cours de l’évasion de Castres. Mais je ne pouvais pas rester trop longtemps, Abadie courant déjà assez de risques en faisant préparer et coder nos courriers chez lui, en nous prêtant uniformes et voitures pour que je n’aille pas l’exposer encore plus par ma présence. »
Le capitaine ne se préoccupe pas des conséquences éventuelles de son engagement pour sa propre existence. En 1944, il héberge dans son logement, à la caserne Saint-Michel, du 31 mars au 15 avril, Mme de Lattre de Tassigny et son fils Bernard recherchés par l’ennemi. C’est ensuite le départ en train jusqu’à Perpignan. Mme de Lattre voyage sous l’identité de Mme Abadie tandis que Bernard de Lattre, âgé de 17 ans, passe pour le fils du capitaine.
À Perpignan, le beau-frère du chef Botet camoufle chez lui, pendant quarante-huit heures, la famille du général avant qu’elle ne rejoigne Saillagouse où le chef Botet la dissimule dans son logement. Le 21, sous la conduite et la protection de ce gradé, les clandestins se dirigent vers l’enclave de Llivia qu’ils atteignent sans encombre.
Avec des uniformes de gendarmes prêtés par le capitaine Abadie, le 2 janvier 1944, un commando du groupe Morhange tend une embuscade à Messak, chef de la Gestapo de Toulouse et découvre dans sa voiture les archives de la Police allemande de la région. Dans les mois qui suivent la Résistance élimine la plupart des traîtres formellement identifiés grâce aux documents saisis.
L’épouse du capitaine Abadie ne reste pas étrangère à l’engagement de son mari. Elle partage les mêmes dangers comme le prouve la citation, à l’ordre de la division, qu’on lui décerne en 1944 :
« A fait preuve d’un magnifique dévouement et d’un patriotisme ardent en participant directement à l’action clandestine du service de contre-espionnage français en territoire occupé par l’ennemi. A effectué avec courage les missions de liaisons dangereuses et a facilité le camouflage du personnel et du matériel recherché par l’ennemi. »
Non seulement dans le Sud-Ouest, mais sur l’ensemble du territoire, des gendarmes agissent pour les Services spéciaux. À Paris, le capitaine Sérignan qui a appartenu à l’état-major de l’armée 2° bureau (S.R.- S.C.R.) continue d’être en relation avec les services de renseignements. Régulièrement il fournit au colonel d’Alès, chef du bureau M.A. (2° bureau E.M.A.) à Royat, des rapports sur les troupes allemandes qu’il fait établir par les brigades de la zone occupée. Sous sa seule responsabilité, il en assure la centralisation et la transmission à Royat. Outre des informations sur l’organisation allemande en zone nord il transmet en zone libre le plan de la défense côtière de Saint-Jean-de-Luz et du nord de la France.
Sa connaissance approfondie de la langue allemande lui permet, à la faveur des contacts de service qu’il est dans l’obligation d’assurer avec les autorités allemandes, de recueillir de précieuses informations. Au mois d’août 1942, il perçoit une certaine tension dans ses relations avec ses interlocuteurs allemands. Il craint que ceux-ci n’aient été informés de ses rapports avec le 2e bureau. Il décide d’y surseoir passagèrement. Son intuition s’avère juste. Une note de l’Abwehr (contre-espionnage allemand) retrouvée dans les archives de ce service et datée du 12 août 1942 rapportant l’interrogatoire d’un officier des Services de renseignements français arrêté par la Police allemande, torturé puis fusillé, établit qu’il a des contacts avec le 2e bureau :
« Gaston déclare les 7 et 10 août 1942 : Je certifie, avec une absolue précision, que l’organisation du contre-espionnage français se trouve à Marseille, Promenade de la Plage, villa Eole entre les numéros 200 et 220, et que son chef est le capitaine Perrier alias Pailhol (lire Paillole). Le capitaine Perrier était auparavant officier de garde mobile. C’est un vieil ami du commandant Savignon (lire Sérignan) officier de liaison avec la Police allemande […]. Le capitaine Nouvel, l’adjoint de Savignon et le capitaine Perrier se connaissent. »
* *
*
La contribution qu’apportent des gendarmes à la sauvegarde des populations menacées de représailles par l’occupant représente une autre forme de résistance dont on ne parle pas ou très peu. Des militaires de l’Arme ne craignent pas d’exposer leur vie pour s’opposer à la barbarie. Un exemple remarquable a pour théâtre les Alpes-Maritimes. Le 3 mai 1944, trois officiers allemands se présentent à la Gendarmerie de Puget-Théniers. Ils demandent qu’un gendarme soit mis à leur disposition pour les guider jusqu’au col de Saint-Raphaël. En cours de route, au lieu-dit « Le Breuil », ils se rendent dans une grange qui paraît abandonnée et mettent à jour un dépôt d’armes. Soudain, des coups de feu claquent. Deux soldats allemands sont mortellement blessés. La riposte s’organise. Des renforts se rendent sur place. Après avoir détruit la grange à l’explosif les Allemands abattent un vieux cultivateur et un jeune homme de vingt-quatre ans.
Dans les heures qui suivent, un détachement encercle Puget-Théniers. Toute la population masculine est parquée sur la place Conil. D’autres militaires perquisitionnent dans les habitations et s’emparent des postes de T.S.F. Les Allemands choisissent, au hasard, parmi les hommes valides retenus en otage, huit d’entre eux. On les conduit vers la barrière de chemin de fer en bordure de la route nationale n° 202. Un peloton d’exécution se met en place pour les fusiller publiquement. Soudain retentit l’ordre « Halt » suivi d’une injonction prononcée en allemand : « Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sera une honte pour la Wehrmacht. » Les fusils s’abaissent. Les soldats éberlués voient s’interposer un sous-officier de Gendarmerie en tenue, l’adjudant-chef Rémond, de la brigade de Puget-Théniers. C’est un alsacien originaire de Baltzenheim dans le Haut-Rhin. Les militaires le désarment brutalement et l’arrêtent.
Son insistance à défendre ses compatriotes et sa qualité dévoilée d’Alsacien déplaisent au chef du détachement allemand. Mais l’exécution n’a pas lieu. Les huit rescapés, soixante autres pugétois et l’adjudant-chef Rémond prennent en camion la direction de Nice. Un mois plus tard, c’est le départ pour l’Allemagne. En gare de Dijon l’adjudant-chef Rémond est séparé de ses compagnons. Il doit sa libération à l’intervention de son colonel. Impressionnés par son courage les Allemands lui rendent la liberté certes, mais exigent de ses supérieurs qu’ils lui infligent des arrêts de rigueur.
Dans quelles conditions ce gradé est-il intervenu ? Il sortait de la caserne de Gendarmerie lorsqu’il a croisé un camion allemand débâché. Deux corps gisaient sur la plate-forme. Au même instant il entend un soldat tenir un propos alarmant : « C’est un nid de terroristes ici. Il faut brûler ce village ». Il se précipite sur la place et y arrive juste à temps pour empêcher la fusillade.
Avec beaucoup de modestie il explique ainsi son geste : « Il fallait que je fasse quelque chose. Ou plutôt il fallait que quelqu’un intervienne à ce moment précis. Comment expliquer ? Je parlais allemand pour la première fois depuis 1918. »
Fin mai 1945, les soixante déportés de Puget-Théniers, dispersés en Allemagne dans des camps de travail, retrouvent indemnes leur cité. L’adjudant-chef Rémond devient, après délibération du conseil municipal, citoyen d’honneur de la ville. Depuis ce moment-là, une rue porte son nom.
Pendant les années de servitude, sans appartenir nécessairement à un mouvement de Résistance ou mener des actions armées, des gendarmes utilisent toutes les ressources qu’offre leur position pour contrecarrer la volonté de l’occupant auquel ils refusent de se soumettre. Leurs actions, peu spectaculaires, ignorées de la population, n’en sont pas moins audacieuses. Membres de la force publique, il leur appartenait de veiller à l’exécution des lois et d’obéir aux règlements qu’ils avaient pour devoir de respecter. En choisissant d’agir selon leur conscience, ils ont apporté une contribution appréciable et appréciée à la cause de la Libération.
M. Maurice Schumann, porte-parole de la France combattante, leur rend hommage, en 1945, en ces termes :
« Maintes fois, les émissaires de la Résistance clandestine nous avaient dit : « Que deviendrions-nous sans les gendarmes français ? Non seulement ils sont l’émanation du peuple, mais encore ils vivent au contact de la terre. Elle leur tient son langage qui ne ment pas, lui. Elle leur dit comme à nous, « Résistez »…
Et ils résistent ». »
Le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Algérie et au Maroc. Par suite des mauvaises conditions météorologiques, ils annulent, au dernier moment, l’opération aéroportée prévue sur la Tunisie où deux régiments devaient être largués. Les Allemands réagissent immédiatement. Pour s’opposer à toute offensive contre la Régence, en Tunisie, ils y débarquent des troupes, par planeurs d’abord, puis par voie maritime. Ces événements entraînent une situation nouvelle pour la Gendarmerie d’Afrique du Nord.
En Tunisie, les 600 militaires de la légion de gendarmerie départementale, créée par décret du 6 août 1939, subissent, à partir du 11 novembre 1942 et jusqu’au 12 mai 1943, la présence des forces de l’Axe engagées contre les troupes franco-alliées dès le 19 novembre.
CHAPITRE 17 – CONTRIBUTION DE LA GENDARMERIE D’AFRIQUE
L’armée française de Tunisie ne se range pas immédiatement du côté des Alliés. L’amiral Estéva laisse la voie libre aux forces du Reich. Cependant, sous les ordres du général Barré, les troupes stationnées dans la Régence se replient vers le sud-ouest et se concentrent près de la frontière, en avant-gardes de bataille, pour tenir le verrou de la plaine de Tunisie : Medjez el-Bab.
Alors que ce mouvement est en cours, le 9 novembre, les brigades de Gendarmerie reçoivent l’ordre « quoi qu’il arrive, de rester sur place en continuant à s’en tenir sur un terrain strictement professionnel, d’assurer la sécurité des personnes et des biens. »
Pendant l’occupation italo-allemande, le service, comme le souligne le commandant de légion, est « axé essentiellement sur la répression des pillages et des attaques à main-armée commises par les musulmans. » Principalement dans les villes, les gendarmes effectuent des services mixtes avec les carabiniers, les feldgendarmes et le Service d’ordre légionnaire.
Fin janvier 1943, le commandant de légion assure les autorités « que la Gendarmerie de Tunisie sert avec dévouement et garde une entière confiance dans les destinées de la France et en son chef le maréchal Pétain. » Cependant, les troupes de l’Axe soupçonnent des gradés et des gendarmes d’actes de sympathie avec « la dissidence » et les placent en détention. Le préfet délégué à la sécurité générale de la Tunisie obtient leur libération, faute de charges suffisantes.
Sans le soutien des autorités tunisiennes, au milieu d’une population souvent hostile et dont le désir d’émancipation s’exacerbe, courant mars 1943, avec l’arrivée sur le territoire du leader nationaliste Bourguiba, la Gendarmerie assure le bon ordre et la sauvegarde des intérêts français jusqu’à la capitulation des troupes allemandes, au cap Bon, le 12 mai 1943.
Tandis que les Allemands préparent l’invasion de la Tunisie, à Alger, le 10 novembre 1942, l’amiral Darlan, sur les conseils du général Juin, signe avec le général Clark, représentant le général Eisenhower, commandant suprême des troupes d’invasion, un armistice général pour l’Algérie et le Maroc. L’arrivée des Alliés marque la rupture de l’Afrique du Nord avec le régime de Vichy et l’entrée en guerre de l’armée française à leurs côtés. À compter de cette date, les légions de Gendarmerie d’Algérie et du Maroc passent au service des nouvelles autorités.
Dans un premier temps, les événements propulsent à la tête de l’Afrique l’amiral Darlan. Le commandant en chef des forces militaires de Vichy se trouve fortuitement à Alger, début novembre 1942. Il a quitté précipitamment la métropole pour se rendre auprès de son fils, gravement malade, dont les jours sont en danger. Surpris par le débarquement, après quelques atermoiements, il se rallie aux Anglo-Américains. Darlan organise rapidement le pouvoir militaire. Il prend le titre de haut-commissaire pour la France en Afrique et de commandant en chef des forces françaises sur ce continent. Le poste de commandant en chef des forces terrestres et aériennes en Afrique revient au général Giraud, « homme unanimement respecté et admiré pour son œuvre africaine et sa glorieuse participation aux deux guerres » comme le précise Darlan dans un discours radiodiffusé du 15 novembre 1942 destiné aux habitants de l’Afrique française.
Entre le 14 novembre et le 23 décembre 1942, veille de son assassinat, Darlan met en place les structures des institutions relevant du haut-commandement. L’ordonnance n° 36, du 6 décembre 1942, fixe le statut de la Gendarmerie en Afrique française et organise son commandement. L’institution sort de l’orbite de la direction générale de la Gendarmerie. Désormais, les légions de Gendarmerie d’Algérie et du Maroc, ainsi que la Gendarmerie coloniale, dépendent de l’autorité du général commandant la Gendarmerie en Afrique française installé à Alger. Ce commandement est successivement subordonné au haut-commissaire pour la France en Afrique puis, après la disparition de Darlan, au général Giraud nommé le 6 février 1943 commandant en chef civil et militaire, enfin au commissaire à la Guerre du Gouvernement provisoire de la République française mis sur pied en mai 1944 sous l’autorité du général de Gaulle.
L’état-major guerre, par note de service n° 2985 du 24 mars 1944, transforme le Commandement de la Gendarmerie en Afrique en Commandement Général de la Gendarmerie placé sous les ordres du général Taillardat, ancien commandant de la légion du Maroc.
À partir de la fin de l’année 1942, la Gendarmerie d’Afrique du Nord et de l’Empire participe à l’œuvre de libération. Tout d’abord, elle détache des prévôtés dans les grandes unités de l’armée française renaissante. La légion de gendarmerie départementale d’Algérie (19e légion) met sur pied la prévôté du 19e corps d’armée engagé dans la campagne de Tunisie. Après la dissolution de cette grande unité, en juillet 1943, la prévôté de la 19e légion est rattachée à la 3e division d’infanterie algérienne dont elle partage les heures difficiles et les moments glorieux en Italie, en France puis en Allemagne où prend fin sa mission, en 1945, sur les bords du Neckar.
De même, en décembre 1942, la légion de Gendarmerie du Maroc constitue la prévôté de la division de marche marocaine du général Mathenet. Son prévôt, l’adjudant Berlan, trouve la mort le 18 janvier 1943 au cours du bombardement de Rebaa pendant les opérations en Tunisie.
Après avoir joué un rôle de premier plan en 1940, au Cameroun, lors du ralliement de la colonie à la France Libre, le capitaine Dubois prend le commandement de la prévôté d’une division blindée avec laquelle il effectue la campagne de France.
La prévôté de la première division française libre du général de Larminat, formée par des éléments de la Gendarmerie coloniale, est une des premières à être mise sur pied en Afrique. Les prévôts remplissent leurs missions efficacement comme le prouve la citation décernée au chef Guillemot qui a « exécuté de nombreuses enquêtes et missions dans des conditions souvent difficiles et dangereuses à proximité immédiate des lignes ennemies et en se signalant toujours par son courage et son sang-froid. »
La Gendarmerie fournit encore des officiers et des sous-officiers pour encadrer des unités de combat. Au mois de décembre 1942, le chef d’escadron Gaillard, de la légion du Maroc, se porte volontaire pour servir au Corps franc d’Afrique en voie de création. Il prend le commandement du 3e bataillon. Pendant la campagne de Tunisie, aux côtés de l’armée britannique, il participe à l’offensive victorieuse qui refoule l’ennemi du djebel Abiod à Sedjane et du cap Serrat à Bizerte. Première unité de l’armée française à rentrer dans Bizerte, le 8 mai 1943, le Corps franc d’Afrique hisse le pavillon tricolore sur le fort d’Espagne. À la dissolution de l’unité, le 15 juillet 1943, le chef d’escadron Gaillard obtient une nouvelle affectation dans une unité combattante.
Le commandement de la Gendarmerie d’Afrique fournit non seulement des détachements prévôtaux et des personnels d’encadrement, mais encore il met des officiers et des sous-officiers à la disposition des Services spéciaux D.S.R./S.M. (Direction des Services de renseignements et de Sécurité militaire) rattachés jusqu’en mai 1944 au cabinet du général Giraud à Alger. Deux officiers se signalent, tout spécialement, à l’occasion de missions clandestines dont ils sont chargés dans des territoires occupés : les capitaines Colonna d’Istria et Demettre.
Au début de l’année 1943, le général Giraud élabore secrètement un plan d’action pour libérer la Corse. Il charge le commandant Gambiez de mettre sur pied un bataillon de choc appelé à être le fer de lance de l’opération. Le commandant en chef se préoccupe par ailleurs de la Résistance intérieure sur laquelle il prévoit de s’appuyer, le moment venu.
Au mois de janvier 1943, pressenti par les services de Giraud, le capitaine Colonna d’Istria, adjoint au général commandant la Gendarmerie en Afrique, accepte de se rendre en mission en Corse. Descendant d’une illustre famille de l’île où il est né en 1905, à Petreto-Biccisano, il connaît parfaitement le terrain et les mentalités. Colonna d’Istria s’entoure d’une équipe franco-britannique composée d’un radio anglais, d’un instituteur, Antonietti, de ses deux cousins, Charles Andréi et Antoine Colonna d’Istria.
Alors que l’équipe s’apprête à partir, Colonna d’Istria tombe malade et doit être hospitalisé. Ses agents embarquent sans lui à bord d’un sous-marin britannique et débarquent dans la baie de Copabia à Serra di Ferro. Sous le nom de code de réseau « Frédéric » la mission renseigne Alger jusqu’en juillet 1943 date à laquelle l’O.V.R.A. arrête, à la suite d’une dénonciation, la plupart de ses membres à l’exception d’Antoine Colonna d’Istria qui parvient à leur échapper.
Début mars 1943, le capitaine Colonna d’Istria, en relation avec le commandant Lejeune, officier de liaison entre le cabinet du général Giraud et les Britanniques (S.O.E.), constitue une seconde équipe en vue de rejoindre la Corse pour y préparer le combat. Giraud le charge de « coordonner les efforts de ses compatriotes, de fusionner, si possible, les groupements particuliers en un faisceau cohérent, homogène, capable d’obéir à une impulsion unique et d’apporter, le moment venu, une aide efficace aux troupes franco-alliées appelées à débarquer en Corse. » La mission que lui assigne Giraud exclut toute action de guérilla avant le débarquement du corps expéditionnaire. Son rôle, comme il le précise à André Maurois, lors d’un entretien, au lendemain de la guerre, a été « d’armer, d’encadrer et surtout de freiner les combattants, de les empêcher de partir trop tôt, de se faire tuer pour rien. »
Fin mars, la mission placée sous les ordres de Colonna d’Istria embarque à Alger à bord d’un sous-marin britannique. Elle débarque clandestinement, le 1er avril, à l’embouchure du Travo, sur la côte orientale de l’île de Beauté. Plusieurs tonnes d’armes destinées à la Résistance corse sont mises en lieu sûr. À son arrivée, Colonna d’Istria installe son P.C. dans la région du Niolo, près du mont Cinto, au sud-est de Calvi. Par mesure de sécurité, l’officier change fréquemment d’identité. Tour à tour il porte les noms de « Césari », « Jean-Pierre », « Francis », « Maurice » et « Léo ».
L’unification de la Résistance constitue une de ses tâches prioritaires. Si le Front national, proche du Parti communiste, est bien structuré et représente une force d’au moins deux mille hommes, les autres organisations, Combat, Libération, Franc-tireur, Action R2 Corse, émanation du B.C.R.A. décapitée après l’arrestation de Fred Scaramoni, ne regroupent que quelques éléments. Tous ces mouvements agissent dans l’ignorance les uns des autres, quand ils ne s’opposent pas pour s’adjuger armes et équipements qui font cruellement défaut.
Césari, pour des raisons d’efficacité, considère que le Front national est dans l’île la seule force capable d’entrer immédiatement en action. Aussi décide-t-il de fusionner autour de lui toutes les autres organisations. Pendant des semaines, il parcourt la Corse sans relâche, multiplie les prises de contact avec les dirigeants et les adhérents pour les convaincre de se ranger derrière le Front national avec lequel il est en relation. En même temps Colonna d’Istria redouble d’effort pour élargir le recrutement. De 2 000, le Front national passe à 9 000 membres en mai 1943 pour atteindre le chiffre 12 000, en septembre, au moment de la libération de la Corse.
Non seulement Colonna d’Istria soude les différentes composantes de la Résistance corse, mais il les organise sur la base d’une décentralisation et d’une spécialisation poussées. Il arrête les modalités de liaison à l’intérieur et avec Alger. Pour pouvoir agir avec le maximum d’efficacité, au moment de l’arrivée du corps expéditionnaire qui déterminera l’entrée en action de la Résistance, il met sur pied un service de renseignements afin d’acquérir les informations essentielles sur l’ennemi : effectifs, installations défensives, centres de transmissions, dépôts de munitions, logements des officiers, etc.
À tous les responsables, le représentant du général Giraud ne cesse constamment de rappeler les buts visés : soutenir le débarquement et la pénétration dans l’île des forces de libération en agissant par surprise sur les objectifs fixés, mettre à la disposition des troupes des guides et des agents de renseignements.
Autre préoccupation de Césari : l’armement des patriotes. Il multiplie, avec succès, les démarches auprès d’Alger pour les armer, les équiper et les ravitailler. Du matériel a déjà été acheminé, à plusieurs reprises, par sous-marins, depuis l’Algérie. L’état-major de Giraud lui donne son accord pour envoyer des armes par avion et homologue soixante terrains de parachutage répartis dans l’île. L’aviation anglaise, pour la première fois en mai 1943, largue 4 tonnes d’armes. D’autres parachutages suivent qui complètent les cargaisons amenées par voie maritime. Le 3 juillet 1943, le « Casabianca » dépose 12 tonnes d’armes sur la plage de Saleccia, en bordure du désert des Agriates. Le 31 au cours d’une nouvelle liaison il en débarque 20 autres. Le jour du soulèvement il y aura en Corse 8 000 mitraillettes et 800 fusils-mitrailleurs largement approvisionnés.
Césari ne relâche pas son activité. Déplacements, liaisons, réunions, réceptions et répartitions d’armes se succèdent qui l’exposent à l’arrestation. Les autorités italiennes le recherchent. Plusieurs fois repéré, poursuivi et même cerné, il déjoue avec sang-froid tous les pièges. L’amiral Lepotier rapporte un exemple de son audace :
« Pour satisfaire à une demande du S.R. français, Colonna dont la tâche était limitée au combat proprement dit organise un réseau de renseignement. Pour mieux réussir, il s’enrôle lui-même dans les services de l’ennemi. Un soir, alors qu’il se trouve à Bastia avec le dessein de préparer l’arrivée d’un stock d’armes en pleine ville, il est arrêté. Il refuse de se laisser fouiller.
Malgré la menace de leurs mitraillettes, il impose aux carabiniers sa volonté et obtient d’être présenté au général Stivale qui commande la place. À celui-ci il exhibe confidentiellement l’ordre de mission qui le classe au service de l’occupant et obtient instantanément d’être relâché avec des excuses. Une voiture ennemie est mise à sa disposition moyennant quoi, dans la nuit même, cinq tonnes d’armes destinées aux maquisards entrent dans Bastia […]. »
Alors qu’il est en mission, le 25 juin 1943, Colonna d’Istria est promu chef d’escadron à titre temporaire. Dans les jours qui suivent il se rend à l’embouchure du Travo où il doit prendre contact avec un sous-marin en provenance d’Alger. À son bord des armes ainsi qu’un officier de liaison, envoyé par Giraud, auquel il doit faire le point de la situation. L’attente de Césari se prolonge plusieurs nuits avant que le submersible n’apparaisse en surface. À bord d’une chaloupe il s’apprête à rejoindre le sous-marin lorsque les Italiens, embusqués aux abords de la plage, déclenchent un feu nourri. Colonna, pour leur échapper, prend place dans le sous-marin qui plonge, gagne le large, et rejoint sa base à Alger. Dès son arrivée, Colonna, mis au secret, rend compte à Giraud de l’avancement de sa mission. Il repart pour la Corse avec le « Casabianca » et y débarque le 3 juillet.
Nouvelle alerte pour Césari. Le 8 septembre 1943, 1 200 soldats italiens convergent vers son P.C. situé dans une grotte, au flanc d’une montagne, entre Poggio et Orezza. Colonna relate dans quelles conditions il réussit à s’enfuir :
« Moi-même j’ai été cerné par nos ennemis dans une grotte qui, heureusement, communiquait à leur insu avec une autre de sorte que, quand ils ont lancé leurs grenades, je n’y étais plus. Ils ont mis le feu au maquis pour me prendre mais j’avais des bergers fidèles qui connaissaient tous les chemins […]. »
Au fil des mois, l’impatience gagne les résistants, de mieux en mieux armés, qui veulent en découdre avec l’occupant. Pour contenir leur ardeur, Colonna a les plus grandes difficultés. Des actions isolées sont engagées d’ailleurs, ici et là, contre les Italiens.
Le 27 août, le Comité directeur du Front national décide que si l’Italie met bas les armes les résistants passeront à l’attaque. Gagné par l’ambiance, Césari, favorable au déclenchement de l’insurrection, adresse le lendemain un câble à Giraud :
« Patriotes troublés par perspectives armistice redoutent que leurs sacrifices antérieurs soient devenus inutiles et leur activité sans objet. Stop. Je sollicite directives fermes pour conduite à tenir. Suggère attaque forces allemandes et tous pouvoirs hostiles cause libération quelle que puisse être attitude italienne : hostile, sympathisante ou indifférente. Stop. Si d’accord proclamons département rallié à C.F.L.N. Organisation Résistance impatiente d’agir, difficile à maîtriser. Stop. »
Le commandant en chef répond en retour :
« Vos suggestions retenues. Instructions fermes suivent. Bravo. »
Giraud adresse un nouveau message à Césari en totale contradiction avec le précédent :
« Pour le Comité directeur du Front national par Paul. Prière dire patriotes corses que je compte sur leur obéissance pour ne pas déclencher opération prématurément. Projets établis toujours valables actuellement. Si apprenons armistice, vous enverrons ordres en conséquence. »
Les événements se précipitent. Le 8 septembre, sitôt connue l’armistice avec l’Italie, le Front national lance l’ordre d’insurrection générale pour le 9 au matin. Effectivement, le lendemain, des milliers de Corses déferlent dans les rues d’Ajaccio et se dirigent vers la préfecture. Le préfet refuse de les recevoir. Le Comité départemental du Front national, érigé en Conseil de préfecture, au sein duquel figure Césari aux côtés de Giovani (responsable politique) et de Vittori (responsable militaire), dissout les organisations vichystes et proclame le ralliement de la Corse à la France Libre. À 18 heures, le 9 septembre, Césari annonce à Giraud, par message, le soulèvement de la Corse :
« Insurgés maîtres d’Ajaccio. Italiens passifs. On se bat à Bastia. La Corse demande l’aide de l’armée. »
Soucieux de lever toute incertitude quant à l’attitude des Italiens, Colonna s’adresse au général Magli, qui commande les quatre divisions installées dans l’île, pour connaître sa position à l’égard des insurgés. Il peut compter sur la neutralité de ses troupes.
Du côté allemand, on se prépare à la riposte. La défense de la Corse incombe au général Senger. Il dispose de la brigade S.S. Reichsführer et si nécessaire de la 90e division de panzer grenadier, du général Legerhause, stationnée en Sardaigne.
À Alger, le commandant en chef rassemble les moyens pour intervenir. Le 11 septembre, il désigne le général Henry Martin pour prendre le commandement de l’opération « Vésuve » en vue de libérer la Corse. Pour remplir sa mission, le général Martin dispose du groupement n° 2 avec le bataillon de choc du commandant Gambiez, la 4e division marocaine de montagne, un groupement de tabors marocains, quelques éléments de réserve générale et des formations de la base aérienne 901. Le rôle initial de ces unités est de créer une large tête de pont, autour d’Ajaccio, pour permettre le débarquement du gros des forces nécessaires à la conquête de l’île. Le 11 septembre, nouveau message de Césari à Giraud :
« Patriotes dirigent préfecture et toutes administrations. Accord avec les Italiens contre les Allemands. Alliés attendus. Ordre règne. Allemands à Bastia avec Chiobini et Lioghi sont déjà isolés par troupes italiennes, mais danger imminent. Arrivez par Ajaccio sans danger. Demandez pilote pour acheminer. Avons un navire. »
Le 12 septembre, à 23 heures, le sous-marin « Casabianca » débarque à Ajaccio l’élément précurseur de l’opération « Vésuve », 109 hommes du bataillon de choc. Le lendemain, les contre-torpilleurs « Fantasque » et « Terrible » en amènent 500 autres. À partir du 19 septembre, 6500 militaires français combattent en Corse. La Résistance tient la ligne des cols, artère centrale de l’île, face aux incursions allemandes. Partout les combats sont âpres. À Lévie 200 maquisards résistent plusieurs jours à une colonne de 1 200 Allemands appuyés par des chars lourds. En 21 jours, entre le 13 septembre et le 4 octobre, la Corse est libérée.
À l’aube du 21 septembre, un « Glen Martin » atterrit à Campo del Oro. À la surprise générale le commandant en chef, Giraud, et le général Bouscat, commandant de l’armée de l’air, débarquent de l’appareil. Le lendemain Giraud se rend au chevet de Colonna d’Istria hospitalisé dans une clinique d’Ajaccio. Au nom de la France, il lui remet la croix de chevalier de la Légion d’honneur assortie d’une citation flatteuse :
« Organisateur et chef de la Résistance en Corse, le commandant Colonna d’Istria a, pendant six mois, mené sur sa terre natale une vie de proscrit, relevant les énergies, armant les patriotes, préparant avec un courage indomptable la liberté de son pays. À su, pendant les heures tragiques, incarner les plus belles qualités de sa race : fierté indomptable, haine farouche de l’ennemi et amour profond de la France. »
Dans la préparation du soulèvement comme dans la phase insurrectionnelle, le chef d’escadron Colonna d’Istria a manifestement joué un rôle décisif. Grâce à lui, la Résistance corse parvient à concilier la triple obédience à l’état-major giraudiste, gaulliste et au Front national. En s’élevant au-dessus des partis et des clans il réussit à catalyser toutes les énergies vers le but assigné : la libération de l’île.
Si Colonna d’Istria trouve des appuis auprès des gendarmes de la compagnie autonome de la Corse, rattachée à la 15e région d’inspection, l’organisation qu’il met en place n’en repose pas pour autant sur la Gendarmerie, pourtant hostile à l’occupant. Parmi les officiers, à l’exception du commandant de compagnie arrêté et écroué au lendemain de la Libération – il sera sanctionné par la commission d’épuration instituée dans l’île le 1er octobre 1943 – tous les autres pactisent avec les patriotes. Certains, comme les lieutenants Person, Lecas et Pétrignani participent aux opérations et entraînent avec eux les militaires sous leurs ordres. Le lieutenant Lecas se distingue lors d’un coup de main exécuté sur l’usine d’Abbazia.
Des sous-officiers concourent aussi à la lutte contre l’occupant. L’adjudant Labussière, secondé par les gendarmes Gonalch et Mortie, met sur pied, fin 1942, un réseau de renseignements. L’adjudant-chef Paganelli, les gendarmes Carboune, Cornus et Oustry participent à des actions armées contre les troupes allemandes.
La Corse libérée, Colonna d’Istria regagne l’Afrique du Nord. Il prend les fonctions de chef d’état-major auprès du général Taillardat.
Le 28 juin 1944, il est détaché auprès du Commandement supérieur des forces françaises en Grande-Bretagne où il représente la Gendarmerie avant d’être affecté, en septembre 1944, au Commandement de la Gendarmerie et de la Garde républicaine.
La coopération exemplaire de l’officier avec les services britanniques, durant sa mission en Corse, lui vaut d’être décoré de la Distinguished Service Order. Le général de Gaulle, le 16 août 1944, l’admet au nombre de ses Compagnons pour le motif suivant :
« Animé d’une foi patriotique ardente et d’une haine farouche de l’envahisseur, s’est dressé contre la défaite dès juin 1940. Dans les circonstances toujours difficiles, souvent périlleuses, a joué un rôle de tout premier plan dans l’organisation de la Résistance en Corse. A été le principal artisan de la libération de l’île. »
Au moment où Colonna d’Istria est de retour à Alger, un autre officier de Gendarmerie se prépare à partir pour la métropole. Son action s’inscrit dans le cadre particulier de la Sécurité militaire.
* *
*
Courant février 1943, le capitaine Paillole, directeur de la Sécurité militaire et chef des Services de contre-espionnage, décide, avec l’approbation du général Giraud, commandant en chef civil et militaire, de créer en France métropolitaine un « Service de Sécurité Militaire précurseur » capable de prendre en main, à la Libération, les mesures relevant normalement de la Sécurité militaire en temps de guerre, c’est-à-dire la sécurité des troupes et le maintien de l’ordre. Pour le capitaine Paillole « son rôle n’est pas de renseigner mais de se renseigner pour le moment où il fera surface. » Pratiquement, il s’agit pour ce service de repérer, dans chaque région, au sein des administrations et de la population, les éléments favorables ou hostiles à la Résistance ou qui sont douteux. Dès la Libération, les membres de ce service doivent émerger de la clandestinité, arrêter les suspects contre lesquels des preuves ont été rassemblées et les livrer aux tribunaux chargés de réprimer les crimes contre la sûreté de l’État.
Au mois de mars, le capitaine Paillole confie le soin au lieutenant-colonel Navarre d’organiser en métropole le contre-espionnage défensif ou Service de Sécurité Militaire (S.S.M.). L’idée est de créer un bureau S.S.M. et un service action par région militaire.
En avril, Navarre entre clandestinement en France et s’installe à Clermont-Ferrand d’où il met en place les bases de l’organisation. En juin le S.S.M. s’étoffe. Il couvre la zone sud et s’étend progressivement en zone nord. En décembre 1943, Navarre constitue à Paris le bureau de Sécurité Militaire 407 dont la zone d’action comprend les départements de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. L’implantation des postes se poursuit à Châlons-sur-Marne, Nancy, Dijon, Besançon, etc.
À la fin de l’année 1943, le capitaine Paillole à l’intention d’appuyer le réseau clandestin du S.S.M. sur les éléments les plus solides de la Gendarmerie, ceci afin de pouvoir compléter ses moyens de recherche. Pour réaliser son projet, il fait appel à un officier de Gendarmerie, le capitaine Demettre. Ce dernier, âgé de 34 ans, est en poste en Algérie depuis le 16 novembre 1942. En provenance de la direction de la Gendarmerie à Vichy il commande la section de Tiaret avant d’être détaché, le 30 novembre 1943, à l’état-major particulier du général commandant la Gendarmerie en Afrique française.
De l’automne 1943 jusqu’à son départ pour la France, en fin d’année, les Services spéciaux l’initient aux missions du Service de Sécurité Militaire précurseur. La tâche que lui assigne le capitaine Paillole est claire : mettre en rapport, en France occupée, le maximum possible d’officiers de Gendarmerie avec le S.S.M. précurseur de Navarre.
Le 5 décembre 1943, le capitaine Demettre embarque à Alger à bord du sous-marin Protée. Le submersible touche Barcelone dans la journée du 6. Dans la capitale de la Catalogne, le poste T.R. des Services spéciaux organise son acheminement en France. Par Puigcerda et l’enclave de Llivia, la filière de passage aboutit à Saillagouse. Là, le maréchal des logis-chef Botet, commandant la brigade, conduit le clandestin jusqu’à Perpignan où il arrive le 13 décembre. Pour se déplacer, en France occupée, dans les meilleures conditions de sécurité, le capitaine Demettre prend l’identité d’un officier de la direction générale de la Gendarmerie. Sous cette couverture, revêtu le plus souvent de l’uniforme, il échappe à la plupart des contrôles.
De Perpignan il rejoint Toulouse où l’accueille le capitaine Abadie, de la légion de Guyenne. Il gagne ensuite Paris pour y rencontrer le lieutenant-colonel Navarre. Ce dernier lui précise les modalités de sa mission.
Entre le 20 décembre 1943 et la fin mars 1944 le capitaine Demettre effectue un véritable tour de France pour tenter de joindre les officiers de Gendarmerie connus de lui et les convaincre de s’associer à son entreprise. Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, Lyon, Dijon, Vichy, Givors, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Rouen, Troyes, Château-Thierry, Lille, Argentan-sur-Orne et enfin Perpignan constituent les étapes de son périple. À tous ceux qui acceptent d’apporter leur concours il donne un mot de passe permettant aux chefs locaux du S.S.M. précurseur de prendre contact avec eux.
Lors de son passage à Dijon, le capitaine Demettre se met en relation avec le capitaine Cherasse, de l’état-major du général Durand commandant la Gendarmerie de la 4e région d’inspection. Son interlocuteur est disposé à agir au sein de l’organisation du lieutenant-colonel Navarre qui pourra ainsi compter sur le soutien de la Gendarmerie dans l’est. Les deux officiers conviennent en outre de mettre sur pied, au profit du S.S.M. précurseur, un réseau de renseignements qui s’appuie sur les unités de Gendarmerie des 14 départements de la 4e région d’inspection. Le capitaine Cherasse se charge de rallier les quatre commandants de légion concernés. Il y parvient.
Dans les semaines qui suivent les brigades commencent à alimenter le réseau « I. G. IV ». Au cours des services, les gendarmes recueillent des informations sur les forces allemandes en stationnement ou de passage, sur l’attitude et l’état d’esprit des populations, les agissements des collaborateurs et des miliciens.
Les liaisons avec les postes S.M. se font à Châlons-sur-Marne, Nancy, Besançon et Dijon. À Nancy, un officier de Gendarmerie, le capitaine Debrosse, commandant la compagnie de Lunéville, dirige d’ailleurs le bureau régional du S.S.M. précurseur. D’autre part, tous les mois, le capitaine Cherasse a un contact à Paris avec le lieutenant-colonel Navarre. L’ensemble des renseignements fournis par le réseau Gendarmerie sont ensuite transmis à Alger en vue de leur exploitation. Le temps manquera pour réaliser sur l’ensemble du territoire, au sein de la Gendarmerie, des réseaux analogues à celui de la 4e région d’inspection.
Après une dernière entrevue à Paris avec le lieutenant-colonel Navarre pour l’informer des résultats de sa mission, le capitaine Demettre quitte la France le 1er avril 1944 pour rejoindre Alger via l’Espagne.
À son retour, il réintègre le Commandement général de la Gendarmerie. Le 21 juin il embarque pour l’Angleterre avec le détachement de Gendarmerie n° 1 avant de recevoir une affectation à la direction de la Gendarmerie en cours de création à Londres. À la fin de l’année 1944 il est muté en Algérie. Un décret du 26 décembre le nomme chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Une élogieuse citation avec palme accompagne cette distinction :
« Officier d’élite, animé du plus pur esprit de sacrifice. A accompli en France occupée, avec un plein succès et au péril de sa vie une mission de résistance de la plus haute importance. »
À la libération le S.S.M. précurseur bénéficie, grâce à l’action du capitaine Demettre, du concours précieux de la Gendarmerie dans de nombreuses régions. Renforcé par des éléments en provenance d’Alger et de Londres le dispositif du lieutenant-colonel Navarre entre en action partout où les conditions le permettent. Les bureaux régionaux de S.M. et leurs antennes départementales traquent les collaborateurs et alimentent les juridictions chargées de réprimer les atteintes à la sûreté de l’État. Cette action ne se fait pas sans difficultés car des organismes d’épuration, plus ou moins politisés, apparaissent qui agissent illégalement, sans liaison entre eux quand ils ne sont pas en conflit les uns avec les autres.
À Nancy, le S.S.M., sous les ordres du capitaine Debrosse, sort de la clandestinité le 14 septembre 1944. L’officier reçoit un renfort inattendu. « Camille », chef du réseau Mithridate-Vosges, est détaché dans son service. Grâce aux informations dont il dispose, des affaires importantes seront réglées tant dans les Vosges qu’en Meurthe-et-Moselle.
L’engagement du capitaine Demettre au profit du S.S.M. n’exonère pas pour autant les militaires de la Gendarmerie qui se sont compromis avec l’occupant durant les années noires.
Des officiers et des sous-officiers sont l’objet d’investigations de la part de la Sécurité Militaire comme c’est le cas à Nice pour les commandants de légion qui se sont succédé et à Toulon où le commandant de section est mis au secret.
Dernier volet de la contribution de la Gendarmerie d’Afrique à la Libération : la mise en place des structures de transition qui vont se substituer à celles de Vichy. Le 21 juin 1944, le général Taillardat signe la directive sur l’organisation et l’emploi des détachements de Gendarmerie appelés à intervenir sur le territoire métropolitain libéré par la création de théâtres d’opérations militaires.
Ces formations, constituées avec des effectifs prélevés sur les légions d’Afrique du Nord, prennent l’appellation de « détachements de Gendarmerie n° 1 à 15 ». Une double mission leur incombe.
D’une part, en cas de dissociation par l’ennemi des unités de Gendarmerie qui sont stationnées sur le territoire métropolitain, fournir par leur éclatement les cadres nouveaux des unités dissociées pour en poursuivre l’action et opérer la réorganisation.
D’autre part, si cette dissociation n’est pas consommée, réaliser la liaison avec les formations du territoire pour resserrer les liens moraux et matériels qui doivent unir la Gendarmerie de métropole et de l’Empire sur le plan de la souveraineté nationale. En toutes circonstances, les détachements conservent les attributions essentielles de la Gendarmerie dans les domaines de la Police générale, judiciaire et militaire. En matière judiciaire les autorités attendent des détachements qu’ils apportent leur plus large concours à la Sécurité Militaire pour la répression de l’espionnage, du pillage, des activités hostiles à la défense nationale, et la recherche des individus ayant eu des intelligences avec l’ennemi, etc.
Les officiers affectés dans les détachements sont, en principe, appelés à prendre des commandements territoriaux pour assurer l’exécution des ordres donnés par les généraux délégués militaires du Gouvernement provisoire pour les théâtres d’opérations. La directive les habilite à donner le commandement de sections à leurs subordonnés immédiats, adjudant-chefs et adjudants, dans les postes où la nécessité impérieuse s’en ferait sentir. Les chefs de détachements disposent d’une large initiative pour adapter aux circonstances les règles fixées par le commandement général de la Gendarmerie. En fait, les détachements seront dissous moins d’un mois après avoir débarqué en métropole.
Le détachement n° 1 embarque le 26 juin à Alger, à destination de l’Angleterre. Le 6 juillet il arrive à Liverpool. Puis c’est le départ pour la France le 2 août.
Par décision en date du 21 juillet 1944, le général Kœnig, commandant supérieur des forces françaises en Grande-Bretagne et délégué militaire du Gouvernement provisoire de la République française, crée une direction de la Gendarmerie appelée à se substituer à la direction générale de Vichy. Fait unique dans les annales de l’Arme, deux directions coexistent pendant au moins un mois. L’une itinérante, celle de la France Libre, placée sous les ordres du lieutenant-colonel Girard (officier ad- joint capitaine Demettre). L’autre, celle de l’État français, installée à Vichy.
Cette structure de transition, ossature de la nouvelle administration centrale, a une triple fonction. En premier lieu, orienter, coordonner et contrôler le service de la Gendarmerie dans les territoires libérés. Étudier ensuite les questions se rapportant à l’organisation, aux besoins, à l’instruction et à l’administration des forces de Gendarmerie. Enfin, mettre au point les mesures à prendre en métropole pour assurer, au fur et à mesure de la libération du territoire, la continuité du service.
Le 2 août, en même temps que le détachement n° 1, la direction embarque à Portsmouth à destination de Cherbourg. Les dates des notes de service signées par le lieutenant-colonel Girard permettent de déterminer l’itinéraire qu’elle emprunte dans sa marche vers Paris. Toujours à Cherbourg le 7 août, le 8 elle est à Rennes, le 17 à Angers, le 23 à Rambouillet, le 25 à Paris.
Le 10 septembre, la direction change d’appellation. Elle devient « Commandement de la Gendarmerie et de la Garde républicaine ». Des officiers et des sous-officiers en poste en métropole et même à la direction générale à Vichy y sont affectés. La Gendarmerie peut poursuivre sa mission au service de la République bien que fragilisée par les années de servitude.
Le 6 juin à l’aube, les Alliés débarquent sur les côtes des départements de la Manche et du Calvados. Après de violents combats il y établissent une tête de pont, prélude à la reconquête des territoires occupés.
Avant que Londres n’en donne le signal, la Résistance intérieure déclenche « l’insurrection nationale ». Pour les gendarmes des brigades implantées sur le théâtre des opérations, en l’absence de directives du commandement dont ils sont coupés, le choix est clair. Tout en continuant de remplir leur mission de protection des personnes et des biens qui nécessite de multiples interventions de leur part pour dégager et évacuer les blessés, identifier les morts – on compte par milliers les victimes des bombardements aériens au sein de la population – prévenir les pillages, les gendarmes apportent d’initiative une aide directe aux troupes parachutées.
CHAPITRE 18 – L’ÉCLATEMENT
Jusqu’à la fin de la bataille de Normandie, aux environs du 21 août, cette coopération se traduit par des actions multiformes : participation au nettoyage du terrain, ramassage des prisonniers, fourniture de renseignements sur les mouvements et les positions ennemies, accompagnement d’unités parachutées ou débarquées sur leurs objectifs. Les gendarmes de Sainte-Mère-Eglise guident les premiers éléments américains parachutés à travers le pays, transportent des blessés, concourent au ravitaillement en munitions. Ceux des brigades de Beaumont, Hague et Equeurdreville capturent et désarment des soldats allemands. Le gendarme René Jamaux se joint aux troupes américaines et prend part au combat dans un de leurs chars. Blessé au cours de la progression, il est par la suite cité. Un de ses collègues de la brigade de la Haye-du-Puits, François Joret, effectue une mission de renseignements derrière les lignes ennemies. Alors qu’il se porte au-devant d’un convoi américain pour lui signaler la présence d’une zone minée, le gendarme Prosper Barbereau, de la brigade de Villedieu, saute, le 4 août, sur un engin explosif. Il meurt, peu après, de ses blessures. Quarante-huit heures auparavant, le chef Laurent Kervan, de la section de Mortain, établit dans le secteur de Romagny la première liaison avec un détachement américain. Avec un groupe de quatre gendarmes il détruit deux véhicules de la Wehrmacht puis capture, au cours d’une embuscade, trois SS.
Des gendarmes membres de la Résistance passent aussi à l’action. À Barenton, le groupe dit « les Courtils », commandé par le chef Dauvergne, commandant la brigade, coupe des fils téléphoniques, arrache des pancartes de signalisation installées par les troupes d’occupation, tend des embuscades. Le 22 juillet il prend d’assaut et détruit un camion de munitions. Dans l’Orne, depuis le jour « J », les groupes de résistance de la région de Domfront, sous les ordres du capitaine Lefèvre, commandant la section, multiplient les opérations de sabotage et de guérilla.
Premier militaire français à débarquer en uniforme dans le secteur des côtes normandes, à l’est d’Arromanche, avec le 30e corps d’armée britannique, Maurice Schumann porte-parole de la France combattante, délégué à l’assemblée consultative, écrit en 1945 :
« Le premier gendarme français que je vis fut le héros modeste sans lequel Port-en-Bassin aurait fini par être pris, mais après une longue et coûteuse bataille qui n’eût probablement pas épargné une seule pierre de cette vaillante cité. Lorsque commença l’avance sur Cherbourg, à la tête des volontaires qui nous guidaient, c’était encore un gendarme qui figurait. Je me rappellerai toujours le courage dont il fit preuve après sa blessure. Une seule question revenait sans cesse sur ses lèvres : « J’aurai bien voulu tout de même entrer un des premiers dans la ville pour embrasser mon lieutenant ». Hélas ! son lieutenant fut tué par une atroce méprise, au matin même du jour pour lequel il avait vécu depuis quatre ans. »
Sous la menace des Allemands, à proximité du front, plusieurs brigades des compagnies de la Manche, du Calvados et des départements voisins se replient. Elles ne rejoindront leurs résidences qu’après la Libération.
Après d’âpres combats, les Alliés gagnent du terrain. Le Gouvernement provisoire reprend, au fur et à mesure, le contrôle des administrations y compris celui de la Gendarmerie qui passe sous la tutelle des généraux délégués militaires du G.P.R.F.
* *
*
Dans le reste du pays, le Gouvernement de Vichy tente de faire front à l’insurrection naissante. Darnand, dès le 8 juin, déclenche le plan M.O. arrêté trois mois avant dans la perspective d’opérations militaires sur le territoire métropolitain. Ce document prévoit, notamment, le regroupement des brigades de Gendarmerie. Selon son promoteur, il s’agit de soustraire leurs faibles effectifs aux entreprises des groupes terroristes, plus nombreux et mieux armés, contre lesquels elles ne disposent pas de moyens suffisants pour résister efficacement.
L’application de cette disposition provoque une véritable hémorragie, dans les rangs de la Gendarmerie, qui draine vers les maquis plusieurs milliers de ses personnels. L’heure sonne, pour eux, de la lutte ouverte contre l’occupant aux abois.
Le télégramme d’exécution relatif au regroupement parvient aux préfets régionaux de la zone sud le 7 juin :
« Appliquez mesure 33, regroupement par compagnies à ensemble région Limoges et à départements Haute-Loire et Cantal. Appliquez regroupement par sections à autres départements zone sud à l’exception Allier et Puy-de-Dôme où aucun regroupement ne sera effectué. Communiquez présente instruction à commandants de légions intéressés. »
En zone nord, l’ordre de regroupement est fixé au 13 juin.
La décision de rassembler les gendarmes dans les chefs-lieux d’arrondissement ou de département, selon les situations locales, ne suscite pas, loin de là, l’unanimité au sein des instances administratives. Si des préfets estiment qu’il vaut mieux que les gendarmes restent sur place, dans leurs circonscriptions habituelles, même désarmés à la rigueur, comme représentants symboliques de l’autorité, d’autres en revanche, tels les intendants du Maintien de l’ordre, miliciens pour la plupart, préfèrent la solution dictée par Darnand qui limite la vulnérabilité des brigades aux attaques des maquisards.
La population ne voit pas d’un bon œil le départ de « ses gendarmes ». Des habitants attristés viennent assister à leur départ. Les brigades parties, l’inquiétude prévaut même si, dans beaucoup de casernes, un sous-officier reste sur place pour assurer une garde symbolique et dans toute la mesure du possible renseigner le commandement sur l’évolution des événements.
Dans la Gendarmerie, les avis divergent sur l’opportunité du regroupement. D’une manière générale les commandants de légion y sont hostiles. À ce sujet le colonel commandant la légion de Provence écrit le 28 juin :
« L’exécution commence le 8 juin au soir et entraîne, immédiatement, des défections nombreuses.
Les mobiles probables des défections sont d’ordre général et d’ordre particulier :
– sur le plan général, il est indéniable que la Gendarmerie n’a pas échappé au désarroi des esprits et à la crise morale qui se manifestaient depuis longtemps dans le pays. Se défiant de la puissance occupante, ignorant les intentions du Gouvernement, manquant de confiance en ses chefs, connaissant par ailleurs les mots d’ordre de la radio de Londres et les bruits divers circulant dans tout le pays elle redoutait quelques pièges susceptibles de la conduire à son désarmement et peut-être à son internement […]. »
Comme on le verra par la suite, une motivation plus noble, contrairement à ce qu’affirme ce commandant de légion, est à l’origine de la désertion du plus grand nombre.
Conscient des graves inconvénients provoqués par le regroupement des gendarmes, début juillet Darnand laisse toute latitude aux préfets régionaux pour les renvoyer, s’ils le jugent utile, dans leurs brigades, à condition d’obtenir préalablement l’avis des commandants de légion et de compagnie.
Entre le déclenchement de la mesure et l’autorisation de l’interrompre, comment évolue la situation ? La direction générale de la Gendarmerie ne confirme l’ordre de regroupement des brigades, transmis au commandement par les préfets, que le 12 juin. Le 19, le général Martin donne des instructions sur l’action à mener par la hiérarchie auprès des gendarmes regroupés que guette la démoralisation :
« L’obéissance aux ordres, prescrit-il, doit être totale, toute critique doit être immédiatement et sévèrement réprimée, aucune conversation à caractère politique ne doit être tolérée […]. »
Après avoir insisté sur le rôle primordial des cadres, il poursuit :
« Il résulte des renseignements que je possède que certains officiers sont incapables d’exercer avec fruit une action auprès du personnel et que d’autres sont même responsables de la baisse du moral de leurs subordonnés. De telles défaillances ne sauraient être tolérées. Je donne délégation aux généraux inspecteurs pour relever immédiatement de leur commandement les officiers et gradés qui se révéleraient insuffisants et pour les remplacer par le chef le plus apte, sans considération de grade, en ayant recours, s’il en est besoin, à la lettre de service. »
Dans la Drôme, les gendarmes sont regroupés à Valence, Romans et Montélimar. Le commandant de compagnie constate dans un rapport « que le moral est médiocre et extrêmement influençable ; les esprits sont inquiets […] ». Depuis le 8 juin il dénombre 39 désertions connues, sans compter celles des arrondissements de Dié et de Nyans occupés « par la dissidence.
Des obstacles se dressent, imputables aux circonstances ou aux hommes, qui retardent ou empêchent, comme dans la Drôme, l’application de la « mesure 33 ». Le rassemblement des gendarmes, en zone sud, s’échelonne entre le 8 et le 15 juin. À la suite des perturbations ou de la rupture des communications téléphoniques, les messages d’exécution ne parviennent à leurs destinataires qu’avec plusieurs jours de retard. Leur acheminement par voie postale se heurte aux mêmes aléas. Force est de recourir à l’envoi d’estafettes. On ne s’y hasarde que rarement car l’insécurité règne sur les axes routiers.
Dans les Hautes-Pyrénées, les maquisards occupent plusieurs agglomérations : Bagnères, Lannemezan, Castelnau-Magnoac, etc. Les gendarmes ne sont plus libres de leurs mouvements et, par voie de conséquence, ne se rendent pas dans les centres qui leurs sont assignés, trop heureux, pour la plupart, de pouvoir se prévaloir d’une telle excuse.
En Corrèze, les autorités régionales anticipent les instructions gouvernementales. Les gendarmes se regroupent à Tulle le 4 juin. Les événements se précipitent. Le 7 au matin les F.T.P. investissent la ville. Gardes et G.M.R. ne tardent pas à se replier vers Limoges. Les Allemands continuent le combat sans l’aide des forces mobiles du M.O. Les F.T.P. reprennent l’assaut contre la ville le 8, avec une violence accrue. Pendant ces quarante-huit heures, les gendarmes observent une stricte neutralité.
Un détachement des F.T.P. cerne la Gendarmerie. Après plusieurs sommations le capitaine B…, commandant provisoirement la compagnie, accepte de négocier avec eux. Dans un premier temps, il refuse de se rallier et de livrer l’armement. Toutefois il se ravise, car les maquisards menacent d’incendier la caserne. Dans la soirée du 8 le commandement des F.T.P. renvoie les gendarmes rassemblés à Tulle dans leurs résidences d’origine.
À la demande d’un chef F.T.P. le capitaine B…, bien que réticent, accepte d’envoyer deux gendarmes en side-car pour effectuer une reconnaissance sur la nationale 20 en vue de détecter l’approche éventuelle des troupes allemandes susceptibles d’arriver d’Uzerches. On connaît la suite. Le lendemain 9 juin le drame s’abat sur le chef-lieu de la Corrèze. Les SS de la division Das Reich occupent l’agglomération et pendent 99 otages. Consignés dans leur caserne, sous la surveillance de la Feldgendarmerie, les gendarmes de la brigade de Tulle seront parmi les premiers à constater l’horreur de la tragédie.
Les autorités allemandes s’opposent quelquefois à l’exécution du regroupement. Le 9 juin, le commandant de compagnie de la Creuse demande l’agrément préalable de la Feldkommandantur. Le feldkommandant le somme de surseoir à l’application de la mesure.
Des préfets, comme celui du Tarn, invoquent des raisons de sécurité pour maintenir les gendarmes à leur poste.
Des chefs de maquis interdisent aux gendarmes d’obéir à l’ordre de regroupement. C’est le cas dans l’Indre. Le 15 juin, la brigade de Delabre s’apprête à partir pour Le Blanc, chef-lieu de section désigné pour le regroupement. Quinze hommes armés surgissent à cet instant. Ils exigent que les gendarmes remettent leurs armes. Ceux-ci parlementent et obtiennent de conserver leur pistolet. Avant de quitter les lieux, les maquisards enjoignent aux représentants de l’ordre de ne pas rejoindre Le Blanc sous peine de sanctions. À l’exception de deux gendarmes, qui saisissent cette opportunité pour rallier le maquis, les autres se dispersent dans la campagne avant de se rendre individuellement au point de regroupement.
En zone nord, le préfet régional de Rennes agissant sur délégation de Darnand, sans en référer à la direction de la Gendarmerie, modifie le plan initial et décide le 22 juin d’utiliser les gendarmes de la compagnie du Morbihan, du moins ce qu’il en reste car beaucoup ont déserté, pour garder les canaux.
En Savoie, le lieutenant Jacquet, commandant la section de Bonneville, exécute dès réception, le 9 juin, les instructions gouvernementales. Cinq jours plus tard, il renvoie d’initiative tous ses hommes dans leurs brigades pour éviter qu’on ne les emploie contre le maquis.
Le 14 il adresse un rapport justificatif au chef d’escadron Calvayrac, commandant la compagnie, mais il dissimule la véritable raison de son choix :
« Les gradés me rendirent compte que les hommes s’en allaient isolément sans vouloir écouter leurs ordres. J’essayai de faire comprendre au personnel que l’ordre du commandement était de rester, que le pays entier et la Gendarmerie particulièrement devaient plus que jamais faire preuve d’une discipline absolue. J’éprouvai la profonde tristesse de parler à des hommes fatigués, inquiets, mais dont la résolution me semblait prise.
C’est alors que voulant à tout prix éviter le pire je donnai l’ordre de rejoindre les résidences.
J’ai pris la responsabilité de l’ordre précédent, conscient de sa gravité mais conscient aussi de servir la Gendarmerie française et, par elle, notre pays tout entier. J’avais d’ailleurs l’accord de M. le sous-préfet. »
Le sous-préfet Lespès, qui était de connivence avec le lieutenant Jacquet, sera fusillé quelques jours après par les Allemands.
* *
*
Le passage dans l’illégalité a certes commencé bien avant le débarquement, mais il ne concerne, comme on le verra, qu’un petit nombre. Le gros des désertions s’échelonne du début juin à la mi-septembre
1944. Il prend des aspects très divers. L’analyse du phénomène ne peut que contribuer à une meilleure perception de l’atmosphère qui régnait au sein de l’institution.
D’emblée doit être écarté le cas d’une minorité de gendarmes en proie à un grand désarroi. Devant le cours des événements, influencés par la rumeur qui circulait d’après laquelle les Allemands s’apprêtaient à déporter tous les hommes de 18 à 60 ans ou faisant valoir parfois des raisons familiales, ils abandonnent leur poste pour se cacher. Lorsqu’ils réintègrent leurs unités, après une absence de quelques jours à plusieurs semaines, le commandement prend à leur encontre des punitions sévères. Le libellé de ces dernières est très révélateur des motivations qui déterminent leur conduite :
« A subi l’influence du mauvais exemple et de faux bruits qui l’ont incité à s’absenter irrégulièrement, pendant onze jours, au lieu de suivre sa section regroupée au chef-lieu compagnie. »
« Détaché avec son peloton à Annecy et faisant état de la situation particulière dans laquelle se trouvait la Gendarmerie, a quitté son unité, sans autorisation, pour rentrer à sa résidence. »
« A quitté clandestinement le détachement dont il faisait partie pour se soustraire aux mesures de regroupement des brigades au chef-lieu de compagnie. A, par la suite, rejoint isolément le point de regroupement après une absence illégale. »
Un patriotisme ardent, au contraire, inspire les officiers et sous-officiers qui, à partir de la fin mai, rallient isolément le maquis. Depuis des mois, la plupart entretiennent des relations suivies avec des responsables de la Résistance. Ces derniers les ont incités à rester le plus longtemps possible à leur poste car ils étaient mieux à même de rendre de précieux services en qualité d’agents de liaison et de renseignements.
Des ralliements collectifs conduisent dans le maquis des personnels qui partagent les mêmes convictions. La persuasion de certains chefs suffit à convaincre des indécis. L’effet d’entraînement joue un rôle non négligeable dans les départs en groupe. On observe surtout des désertions en bloc à l’échelon des unités élémentaires (brigades). Dans les autres structures, sections, compagnies et légions, l’unanimité est difficile à réaliser. Henri Dufresnes, gendarme à la brigade de Saint-Marcellin (Isère) en 1944, écrit quelques années plus tard :
« Lors du débarquement un sondage avait permis de constater qu’environ la moitié de l’effectif en réserve à la section de Saint-Marcellin optait pour la Résistance alors que l’autre moitié préférait rester fidèle au Gouvernement. Une vraie salade ! »
Ceci n’empêche pas, bien sûr, une partie de la section de rejoindre le Vercors le 15 juillet entraînée par son chef le lieutenant Morel.
À la section d’Alès (Gard), lorsque l’ordre de regroupement est donné le 8 juin, sur 9 brigades, 3 n’obéissent pas : Saint-Jean-du-Gard, Anduze et Lédignan. Il faut attendre le 12 août pour que le reste de la section, soit 53 gradés et gendarmes appartenant aux brigades de Vézenobres, Tamaris, la Levade, Salindre et Boucoiran gagnent le maquis, capitaine en tête :
« À 3 heures, le samedi 12 août 1944, le capitaine commandant la section d’Alès (Gard) se conformant aux instructions données par le commandant des F.F.I. et pour ne pas reverser l’armement, comme il l’avait été prescrit, réunit les gradés de la section présents et leur donne ordre de préparer le départ. »
Initialement, il est question d’un regroupement des brigades à Nîmes. Les gendarmes ne sont pas dupes. Quand ils apprennent en cours de route que c’est vers le maquis qu’ils vont se diriger, tous acceptent de suivre leur officier. Sous ses ordres, ils constituent la 35e compagnie des F.F.I.
Dans la compagnie de la Loire, le lieutenant Sanvoisin, officier adjoint, membre de l’A.S. depuis son affectation en mars 1944, charge l’adjudant Jouffraix dont il est sûr des sentiments patriotiques de sonder les intentions des gendarmes des sections de Saint-Étienne et de Montbrison regroupées depuis le 8 juin au quartier Grouchy. Il s’agit de déterminer le nombre de volontaires susceptibles de partir au maquis.
Ce gradé réussit à convaincre seulement 23 sous-officiers, pour la plupart, de la section de Montbrison. Lorsque l’officier exige d’eux la signature d’un acte d’engagement indiquant « qu’ils agissaient en toute liberté et connaissance de cause, conscients des dangers auxquels ils allaient s’exposer et des représailles éventuelles qui pourraient s’exercer à l’encontre de leurs familles » très peu sont d’accord pour se prêter à cette formalité. La conviction qu’affiche l’officier finit par les persuader de signer.
Le groupe « France », ainsi baptisé par le lieutenant Sanvoisin, passe à la dissidence dans la nuit du 18 août. Le lendemain soir il stationne à Saint-Bonnet-le-Château où dix sous-officiers provenant des brigades des cantons voisins viennent grossir l’effectif.
Comme à l’échelon section, sous l’impulsion de leurs officiers, des compagnies optent pour la lutte ouverte, même si des irréductibles restent à leur poste. Ils sont pourtant nombreux, dans le Vaucluse, ces 174 gendarmes qui, répondant à l’appel de leur commandant de compagnie, le chef d’escadron Médard, consécutif à l’ordre de mobilisation lancé par les M.U.R. (Mouvements Unis de Résistance), se rassemblent avec armes et bagages le 6 juin et gagnent le point de destination qui leur a été fixé.
Dans l’Aveyron, le chef d’escadron Morisot donne l’exemple à suivre. Dès le mois de mars 1943, il accepte de travailler avec ses hommes au profit du commandant Arète (René) délégué militaire départemental. Il convient avec lui de détacher le moment venu des instructeurs et des cadres dans les maquis du Rouergue, d’assurer les liaisons avec le P.C. départemental en fournissant des estafettes motocyclistes, d’observer l’attitude et les mouvements des troupes allemandes, d’alerter si possible en cas de danger le maquis, de rester en place le plus longtemps pour remplir toutes ces missions et interdire de la sorte le « coiffage » de la population par la seule Police allemande, enfin de rallier les F.F.I., soit sur ordre au jour « J » (débarquement), soit plus tôt si la situation l’exige.
Le 10 juillet 1944, sur un effectif réalisé de 378 officiers et sous-officiers, 249 se trouvent dans des groupements armés. Les autres continuent d’exécuter leurs missions dans les brigades.
Sur 310 militaires que comprend la compagnie du Morbihan, 80 seulement à la fin du mois de mai passent du côté des maquisards. Il faut attendre le 22 juin pour que le gros de la compagnie franchisse le pas de l’illégalité. Au chef d’escadron Guillaudot, résistant de la première heure, succède, après son arrestation, le 10 décembre 1943, un commandant de compagnie « pétainiste convaincu » qui a repris ses troupes en main, mais seulement en apparence.
Dans la compagnie de l’Allier, selon le rapport établi par le capitaine Valmetz, « du 6 juin au début septembre 1944 une soixantaine de gradés et gendarmes sur un effectif de 370 hommes avaient quitté leur poste pour se joindre à des unités F.F.I. ».
La vague du mouvement de désobéissance touche les personnels des formations en déplacement. Éloignés de leurs résidences, en mission dans des régions qu’ils connaissent mal, il n’est pas toujours aisé pour eux de se déterminer. La persuasion des maquisards suffit quelquefois à les convaincre. Comme toutes les forces de police stationnées dans la région de Limoges, les pelotons motorisés déplacés en Corrèze reçoivent l’ordre, le 6 juin, de rejoindre la capitale du Limousin. Le jour même, les 9 pelotons (180 hommes) aux ordres du lieutenant M… quittent Brive pour Limoges via la nationale 20. Or les maquisards surveillent cet axe, en particulier dans la région de Magnac-Bourg, car il jouxte une zone de parachutages intenses.
En fin d’après-midi un poste de guet tenu par les maquisards signale l’arrivée d’un camion d’essence. En fait, il s’agit d’un véhicule des pelotons motorisés. Rapidement, aidés par des sympathisants, 8 maquisards improvisent une déviation pour canaliser le convoi vers le champ de foire.
Gendarmes et F.T.P. sont face à face. Les versions varient sur les conditions de ralliement de la colonne. D’après un compte rendu de l’adjudant Naboulet, en date du 2 octobre, il est spontané :
« Là, écrit-il, des unités du maquis nous arrêtent et nous fusionnons avec eux. »
En décembre 1944 le lieutenant-colonel S…, commandant la légion du Limousin, adresse au ministre de la Guerre une relation tout à fait différente de celle de ce gradé. Il indique expressément que « les gendarmes, mis en demeure de passer au maquis sous peine d’être fusillés, rejoignirent les forces de la Résistance dans la région de Sussac, canton de Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) […]. »
Du côté des maquisards, quarante ans après, on parle « d’invitation à passer au maquis » et de « négociations. »
Quoi qu’il en soit, les gendarmes restent à Sussac jusqu’au 9 juin avant d’être ventilés dans trois groupes cantonnés dans des villages environnants. Certains réceptionnent des parachutages, d’autres participent à des patrouilles, gardes et embuscades. Entre le 17 et le 21 juillet, presque tous prennent part aux combats contre les Allemands et les miliciens qui attaquent les positions des maquisards. La brigade motorisée d’Ivry capture 6 soldats allemands. Le 16 juillet le gendarme Munier, du peloton motorisé de Prades, s’empare avec un groupe de F.T.P. d’une automitrailleuse allemande. Il la retourne contre les troupes d’opérations. Le 17 un engin antichar touche de plein fouet le véhicule blindé piloté par ce sous-officier. Le reste de l’équipage, deux F.T.P., réussit à s’enfuir. Munier tombe aux mains des Allemands. Interrogatoire, tortures, mutilations précèdent son exécution de deux balles dans la tête tirées à bout portant.
À l’issue des combats, une soixantaine de gradés et gendarmes errent plusieurs jours dans les bois. Ne trouvant aucune unité du maquis pour s’y intégrer ils se rendent à Limoges afin de se mettre à la disposition du chef d’escadron commandant le groupement des pelotons motorisés de la région.
Le 12 décembre 1944, ils sont inculpés de désertion en temps de guerre à la suite de la plainte déposée par le lieutenant-colonel chef de la 4e brigade F.F.I. qui les avait sous ses ordres au maquis. Après plusieurs audiences, le tribunal militaire les condamne à un mois de prison avec sursis.
Fin juillet, les 120 gendarmes toujours présents dans le secteur se rassemblent à le Poumeau sur ordre du lieutenant M… nommé commandant militaire de la place de Châteauneuf-la-Forêt. À la mi-septembre, ils réintègrent la Gendarmerie. Quant au lieutenant M… promu capitaine F.F.I. le 29 août, il part pour Limoges où, jusqu’en octobre, il remplit les fonctions d’adjoint au commandant d’Armes avant de reprendre un commandement dans la Gendarmerie à Perpignan.
Dans les écoles de formation, comme dans les unités déplacées, on enregistre des défections de cadres et d’élèves-gendarmes. Le cas du capitaine Dubarry, instructeur à l’école des officiers, a déjà été signalé de même que celui du capitaine Vessereau professeur à Courbevoie également.
En service à Toulouse, dans le cadre du plan de maintien de l’ordre, 7 élèves-gendarmes de l’école préparatoire de Pamiers désertent, le 8 août, en emportant leurs armes et un véhicule. Le lieutenant N…, leur officier instructeur, constatant leur disparition déplore « qu’il n’existe aucun moyen d’empêcher des actes de ce genre. »
La lettre, qu’avant leur départ, les élèves-gendarmes écrivent à leur commandant de peloton laisse apparaître la flamme qui les anime :
« Par suite des événements qui se déroulent sur notre patrie depuis quelques semaines et constatant notre inaction devant notre ennemi héréditaire nous avons décidé, quelques camarades et moi, d’aller rejoindre les forces de l’armée régulière afin de participer, dans une bien modeste mesure, à la libération de notre pays.
Pour ce départ nous empruntons un véhicule automobile et quelques armes appartenant à la compagnie. Soyez certains que ce matériel sera remis entre les mains d’hommes dignes d’intérêt et non de voyous. Nous sommes peinés de ne pouvoir faire cette expédition avec vous et les chefs que nous avions jusqu’alors mais nous avons la ferme conviction de pouvoir nous retrouver un jour pour rehausser le prestige de la Gendarmerie, d’ailleurs, nous retrouverons là-bas environ une centaine de gendarmes. »
Pour éviter aux familles des déserteurs des représailles toujours possibles de la Milice ou des Allemands, les gendarmes, de connivence avec les maquisards, recourent au stratagème de « l’enlèvement ».
Le colonel Guingouin, chef des F.T.P. du Limousin, narre celui de la brigade d’Eymoutiers (Haute-Vienne) :
« Tir au F.M. à l’extérieur, tir au fusil et au pistolet à l’intérieur, pour un semblant de riposte. L’astucieux Barou (gendarme), écrit Guingouin, ira même jusqu’à faire rapporter, par un témoin, au capitaine Anglade à Limoges (commandant de section) que les gendarmes se sont rendus après avoir épuisé toutes les munitions […]. »
Abusé ou non, l’officier rend compte de l’enlèvement des gendarmes en ces termes :
« Le 7 juin, vers une heure, une violente fusillade où se distinguaient de nombreuses rafales d’armes automatiques et qui a duré 40 à 50 minutes, a été entendue, partant de l’intérieur et des abords de la caserne de Gendarmerie. À 11 heures, le commandant de section qui n’avait pu obtenir de communication avec la brigade réussissait, par l’intermédiaire d’un abonné, à communiquer avec la femme de l’adjudant V…, commandant la brigade, qui lui déclarait ce qui est indiqué ci-dessus. »
Le 5 juin 1944, à Saint-Flour (Cantal), des maquisards font diversion du côté de la place d’Armes pour attirer l’attention des Allemands.
Pendant ce temps, d’autres enlèvent, à bord de deux camions, les gendarmes du capitaine Jacques commandant la section.
Les G.M.R., chargés de surveiller les gendarmes, feignent de ne rien voir alors que les véhicules s’ébranlent en direction du Mont-Mouchet où le maquis d’Auvergne se prépare au combat.
En accord avec le lieutenant Vimard, commandant la section d’Espalion (Aveyron), le 13 juin les chefs des maquis d’Aubrac et des Bessades mènent une action conjuguée contre la caserne qui assure le passage à la dissidence de 45 gendarmes. Des cars emportent ces derniers dans l’Aubrac où cantonne le maquis « Roland ». Douze d’entre eux n’y resteront pas mais les autres participeront, avec leur officier, à la défense du réduit de la Truyère (Cantal) lieu de refuge du maquis d’Auvergne après les combats de la Margeride.
Dans l’Isère, le lieutenant Morel, commandant la section de Saint-Marcellin, convient avec le commandant Huet (Hervieux), un des chefs militaires du Vercors, d’un simulacre d’attaque contre la caserne. Dans la nuit du 15 juillet 1944, selon la mise en scène imaginée, un groupe encercle la Gendarmerie. Impacts de balles sur les murs, fils du téléphone arrachés, fausses taches de sang sur le sol donnent l’illusion parfaite d’un assaut en règle et du départ des gendarmes sous la contrainte.
Malgré les pressions de la Résistance des gendarmes font preuve d’intransigeance et refusent de céder aux injonctions des maquisards qui leur demandent de se joindre à eux. Conformément à l’ordre de regroupement, le 12 juin 1944, quarante-deux officiers, gradés et gendarmes de la section de Rochechouart se rendent par voie routière à Limoges. Peu de temps après avoir quitté l’agglomération, plusieurs véhicules du convoi tombent en panne. Le reste de la colonne, qui n’en compte pas moins d’une quinzaine, les attend près du pont de Gorre. Soudain, une forte bande de maquisards ouvre le feu sur les gendarmes. Ces derniers, pris à revers, ne résistent pas. Le chef des assaillants les invite à se rallier. Une dizaine accepte. Tous les autres sont alors désarmés et reconduits à la gare de Saillat d’où ils prennent le train pour gagner Limoges.
Des gendarmes ne suivent parfois qu’avec réticence les maquisards. Le 8 juin 1944, en Dordogne, un groupe franc décide d’attaquer la Gendarmerie de Ribérac. La caserne abrite 55 gradés et gendarmes de la section regroupés sous les ordres de leur chef le capitaine B… La caserne cernée, vers les onze heures du soir, le chef des maquisards demande à parler à l’officier, domicilié en ville, que l’on va chercher immédiatement. Comme le révèle le responsable de l’opération « dès son arrivée le capitaine B… parlemente, refusant de comprendre les raisons impérieuses que nous lui exposons Roland et moi ». Finalement le commandant de section suit « contraint et forcé », comme il se plaît à le dire lui-même.
Plus rares sont les légions qui, état-major en tête, rejoignent le maquis, généralement peu de temps avant la Libération. L’exemple type est celui de la légion du Languedoc. Courant juin 1944, le lieutenant-colonel Vernageau et le chef d’escadron Colonna d’Istria, commandant la compagnie de l’Hérault, négocient avec les responsables régionaux de la Résistance, « Sultan » (commandant Jacques Picard) délégué militaire régional, Jean Bene, président du comité départemental de Libération de l’Hérault et Carrel (Gilbert de Chambrun), chef régional des F.F.I., le ralliement des formations de la légion du Languedoc composée de 5 compagnies : Hérault, Pyrénées-Orientales, Lozère, Aveyron, Aude. Au cours de réunions ultérieures, en juillet, Carrel définit le rôle que les responsables régionaux entendent donner à la Gendarmerie. Placée sous l’autorité directe des chefs départementaux des F.F.I. elle exécutera des missions militaires et formera des prévôtés. Une fois les départements libérés, les unités repasseront sous les ordres de leurs chefs. Fin juillet, le D.M.R. informe Londres des dispositions envisagées. Le 3 août, il reçoit en réponse un message codé, « L’agneau est téméraire », qui l’autorise à déclencher, à sa convenance, le départ des gendarmes au maquis. Il arrête au 13 août le jour « J ».
Le lieutenant-colonel Vernageau diffuse sans tarder ses ordres préparatoires aux compagnies. Le 12 août, avec un état-major réduit, il quitte Montpellier, comme convenu, pour aller installer son P.C. de campagne à Panissargues (Aveyron). Les compagnies, entre le 10 et le 15 août, se portent dans les maquis de rattachement qui leur ont été assignés. À la mi-août, sur un total de 2 110 militaires, 1 314 n’obéissent plus aux ordres de Vichy. Ce dernier chiffre inclut tous les départs d’initiative antérieurs au mouvement collectif de la légion. Dans les unités, près de 790 gendarmes continuent d’obéir aux ordres du colonel B… nommé au commandement de la légion lorsque le colonel Vernageau a été démis de ses fonctions.
Le 15 août, Carrel destitue le nouveau chef de corps. Menacé par la Résistance le colonel B… quitte son poste. À ce moment-là, la direction de la Gendarmerie désigne le colonel D…, inspecteur par intérim à Toulouse, pour assurer le contrôle et l’inspection de la légion du Languedoc.
Le départ coordonné de plusieurs légions au maquis revêt un caractère exceptionnel. Un seul cas a été rapporté : celui des légions de la 4e région d’inspection (Dijon). Le capitaine Chérasse, chef d’état-major du général Durand, commandant la région, apprend au début du mois d’août 1944 que les Allemands s’apprêtent à désarmer la Gendarmerie de Dijon placée, depuis plusieurs mois, sous haute surveillance. L’officier, on l’a vu, dirige le réseau de renseignement « I.G.4 » auquel adhère une forte proportion de cadres et de gendarmes des légions de Bourgogne, Franche-Comté, Champagne et Nancy. Pour contrecarrer le projet des policiers d’Oberg il donne l’ordre à toutes les formations de décrocher pour rejoindre les rangs des F.F.I. Le général Durand approuve l’action de son subordonné mais ne désire pas s’y associer. On lui trouve un refuge dans un château des environs de Dijon. Le capitaine Chérasse installe initialement le P.C. des forces de Gendarmerie à Faverolles (Côte-d’Or) avant de l’établir définitivement à la caserne d’Aigny-le-Duc où déjà, le chef d’escadron Berger, commandant la compagnie de la Côte-d’Or, a organisé le sien.
Par l’intermédiaire d’un commando britannique parachuté, le capitaine Chérasse signale à Londres le ralliement des gendarmes. Quelques jours après, la B.B.C. lance sur les ondes un vibrant communiqué :
« Entraînés par les officiers de l’état-major du commandement régional, la Gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté est passée en entier, le 15 août 1944, dans les rangs des F.F.I. Elle demande que cet exemple soit suivi dans toute la France pour que la Gendarmerie puisse inscrire sur ses drapeaux la gloire d’avoir contribué à la libération de la patrie. »
Les légions de Champagne et de Nancy effectuent le mouvement dans les jours qui suivent. Le 17 août, 689 gendarmes des compagnies de la Côte-d’Or, de la Haute-Marne et de la Saône-et-Loire, arborent le brassard des F.F.I. La seule compagnie de la Côte-d’Or représente le gros de l’effectif avec 348 hommes dont 10 officiers, y compris ceux de l’état-major légion. En fin de compte, 2 500 gendarmes de la 4e région d’inspection passent au maquis. Ils y renforcent les partisans et fournissent des instructeurs. Deux corps francs autonomes forment une réserve opérationnelle à la disposition du colonel Claude, un des chefs militaires de la région.
* *
*
Les premières désertions, dans la Gendarmerie, ne datent pas des jours qui précèdent ou suivent le débarquement en Normandie. Elles sont très antérieures. On les observe à partir de la fin de l’année 1942. Leur nombre, avant le 6 juin, n’excède pas deux cents hommes. Le plus souvent, elles concernent des personnels menacés d’arrestation en raison de leur activité au profit de la Résistance qui, à un moment donné, les place dans l’impossibilité de poursuivre leur entreprise sous le couvert de l’uniforme. Elles sont aussi le fait de gendarmes impatients d’en découdre avec l’occupant.
L’exposé de quelques situations individuelles permet de mieux comprendre les motifs qui les inspirent. À la mi-décembre 1943, le capitaine Guiochon, commandant la section d’Agen (Lot-et-Garonne), apprend que la Police allemande est sur le point d’arrêter le chef Saint-Martin, les gendarmes Condat et Engrève de la brigade de Lauzun. Par personne interposée, pour ne pas se faire repérer, il alerte immédiatement ses subordonnés. Ces militaires mettent leurs familles à l’abri puis quittent leur poste en emportant leurs armes. Le 21 décembre des policiers allemands se présentent à la Gendarmerie. La disparition de leur « proie » les irrite.
L’affaire cependant en reste là. Membres d’un groupe de Résistance de l’A.S. depuis le début de l’année 1943, ces gendarmes participaient régulièrement à des activités clandestines, en particulier à la réception de parachutages.
Un mois avant, dans des circonstances semblables, les gendarmes Jaury et Barreau d’une brigade voisine avaient dû déserter eux aussi.
Autre désertion, celle du gendarme Lamy, de la brigade motorisée de Sancoins, déjà relatée. Impliqué dans une affaire de détention d’armes parachutées et recherché par la Gestapo, il entre dans la clandestinité en août 1943.
Le gendarme Achille Courset, de la brigade de Riom, concourt dans la nuit du 2 au 3 septembre 1943 à l’évasion du général de Lattre de Tassigny détenu à la prison de la ville. La Gendarmerie surveille l’extérieur de l’établissement. Ce soir-là, Courset se porte volontaire pour remplacer un de ses camarades. En faction sur le chemin de ronde, au moment convenu, il quitte son emplacement et rejoint le corps de garde installé devant l’entrée principale de la prison. Il joue l’homme ivre et provoque du scandale pour détourner l’attention des services de sécurité, gardiens et gendarmes. La diversion réussit. Pendant ce temps le général de Lattre de Tassigny, avec d’autres complicités, prend la fuite. Avant que le juge d’instruction ne délivre un mandat d’arrêt contre le gendarme Courset, ce dernier part au corps franc d’Auvergne. Le 15 décembre les Allemands l’arrêtent alors qu’il transporte un chargement d’armes et d’explosifs.
Au début de l’année 1944, la sécurité du gendarme Paul Joyeux, pseudo « Camille », chef du réseau Mithridate-Vosges, est menacée à la suite de la trahison d’un traître à la solde de la Gestapo. Il entre alors dans la clandestinité. Évoquant son nouvel état il en souligne les difficultés :
« Vous savez, la clandestinité, c’est très bien quand on parle… dix, vingt ou quarante ans plus tard. Mais il faut savoir ce que c’est ! Vos amis font tout ce qu’ils peuvent pour vous aider, mais le fait qu’à chaque instant, vous vous demandez si à votre tour vous allez être arrêté ou non, provoque sur l’organisme une tension incessante, sans parler des restrictions alimentaires du moment… Et puis, j’avais mon foyer. Mon épouse elle aussi avait passé des nuits blanches à se demander si j’étais encore vivant… »
En Savoie, le gendarme André Désir, de la brigade de Grésy-sur-Isère, chef local de l’A.S., déserte au début du mois d’octobre 1943 pour pouvoir se consacrer entièrement à la lutte contre l’occupant. Le 6 juin 1944, il entraîne au combat, pour la libération du département, la compagnie qu’il a recrutée dans les mois précédents.
La désertion, ultime degré de la désobéissance pour un militaire, entraîne des conséquences graves pour celui qui s’en rend coupable. Les gendarmes le savent comme ils n’ignorent pas que s’ils tombent aux mains de l’ennemi l’uniforme qu’ils portent ne les protège pas. Au contraire, il les expose aux pires sévices avant d’être généralement exécutés. Choisir l’illégalité ne va donc pas de soi. Quel qu’en soit le moment, la décision prise implique des sacrifices et de grands risques.
Il n’est pas inutile de rappeler que la désertion a des effets judiciaires et administratifs. Judiciaires d’abord. Elle donne lieu à l’ouverture d’une enquête qui s’accompagne du lancement d’un avis de recherche dans tous les services de Police et de Gendarmerie. En cas d’arrestation, le déserteur est traduit devant une juridiction, tribunal militaire avant le 18 juin 1944, tribunal du M.O. postérieurement à cette date. La désertion a d’autre part des conséquences administratives. À la mi-juin 1944, la direction donne l’ordre aux chefs de corps de suspendre immédiatement le paiement de la solde des personnels « ayant quitté volontairement leurs postes ». La mesure ne s’applique cependant pas aux gendarmes enlevés par la force. Ainsi s’expliquent les nombreux simulacres d’enlèvement de gendarmes grâce auxquels ils continueront de bénéficier de leur solde. Naturellement, il est hors de question de verser secours ou pensions aux veuves des déserteurs tués au combat, excepté si le commandement établit « qu’il n’y a aucune collusion entre le disparu et « la dissidence » ».
* *
*
Globalement, quelle ampleur revêt le mouvement de désobéissance, dans la Gendarmerie, au lendemain du débarquement ?
Le 14 juin, le général Martin, conscient du péril de déstabilisation qui guette la Gendarmerie à la suite des désertions de plus en plus nombreuses, exhorte les officiers et sous-officiers à l’accomplissement de leur devoir. Dans l’ordre du jour solennel qu’il leur adresse, il tente d’accréditer l’idée que les abandons de poste ont été imposés par la force :
« Bon nombre d’entre vous, contraints par la violence de suivre les éléments du désordre ont réussi à s’échapper et à rejoindre leurs formations, je les félicite. Leur geste efface largement l’erreur coupable de quelques égarés, heureusement trop peu nombreux pour entacher une Arme qui conserve intact le culte de l’honneur et de la loyauté. »
Son discours, en tout cas, n’a pas d’effet notable sur le flux des désertions. Pourtant, dans le rapport qu’il fournit à Darnand, le 20 juillet, il en minimise l’importance :
« Les défaillances, annonce-t-il, n’ont pas atteint en définitive un pour cent dans le personnel sous-officier et quatre pour mille dans le personnel officier. »
Or, en juin la Gendarmerie totalise un effectif de 39 983 hommes dont 1 162 officiers. Il n’y aurait donc environ que 400 gendarmes et 4 officiers en état de désertion. Lorsqu’on sait que depuis le 10 juin les légions informent la direction de la Gendarmerie des défections constatées, il est impensable que le général Martin ne connaissent pas la réalité de la situation.
Quelques statistiques partielles sont révélatrices. Le 26 juin, la légion du Berry constate l’absence de 82 militaires sur un potentiel de 800. Celle de Gascogne signale 210 défaillants pour un total de 1 589 personnels. Sur 1 487 officiers, gradés et gendarmes la légion de Guyenne dénombre 414 manquants. Le 30 juin, la légion de Bretagne recense 250 déserteurs sur un effectif de 1 614 militaires. À la même période on enregistre dans la légion du Limousin 236 défections pour un effectif de 1 819 militaires. À la libération de Limoges en août 1944, 613 membres de la légion sont dans les rangs des F.F.I. Dernier exemple, dans la légion de Marseille, à la mi-juin, plus de 340 gendarmes sont « introuvables ».
En définitive, selon une estimation fréquemment citée, le nombre de militaires de la Gendarmerie ayant rallié la Résistance, isolément ou en unités constituées, de gré ou plus rarement sous la contrainte, s’élève à quelque 12 000 hommes. Ce chiffre inclut les personnels de la Garde aussi doit-il être sensiblement corrigé. Quoi qu’il en soit, en juin 1944, on assiste manifestement à l’éclatement de la Gendarmerie.
Quand les gendarmes s’engagent massivement dans la lutte ouverte contre l’occupant, ils ne se préoccupent pas de l’obédience des maquis qui les accueillent. Ils servent aussi bien dans les formations F.T.P., proches du Front national et du Parti communiste, que dans celles de l’A.S. issues de « Combat et Libération » ou de l’O.R.A. (Organisation de Résistance de l’Armée). En fait, les circonstances guident leur choix. Dans le Sud-Ouest, où il est solidement implanté, le corps franc Pommiès en incorpore plusieurs centaines. Les grands maquis mobilisateurs exercent une forte attraction. Les gendarmes s’y retrouvent en grand nombre.
D’aucuns peuvent s’interroger sur la décision prise par les gendarmes, très tardive, de rejoindre les F.F.I. et plus encore de l’acceptation par Londres du ralliement de légions la veille de la Libération. Sur le premier point les responsables de la Résistance considéraient, dans leur majorité, que les gendarmes étaient plus utiles dans leurs brigades, où ils avaient la possibilité de les renseigner, que sur le terrain. Ils leur donnent comme consigne de rester à leur poste aussi longtemps que la situation le permettra.
Le colonel Georges, chef des maquis du Lot, écrit à ce propos :
« Les gendarmes ne demandaient qu’à passer de notre côté, mais nous leur disions : « En aucun cas ne nous rejoignez. Vous être plus utiles dans les gendarmeries que dans le maquis ». C’était pour nous une source de renseignements extraordinaire. Quand il y avait une opération de prévue, allemands, Milice, G.M.R., généralement les gendarmes étaient au courant et ils nous informaient […]. »
Le chef de l’Armée Secrète de l’arrondissement d’Albertville (Savoie), le capitaine Bulle, a la même conception quant à leur emploi. II convient, avec le capitaine Bellet, commandant la section, que lorsqu’il en donnera le signal, et à ce moment-là seulement, 20 gendarmes seront affectés en qualité de chef de section ou de groupe dans les compagnies de l’A.S. Au moment où s’engagent les combats pour la libération de la Savoie, le 20 août, le capitaine Bulle fait appel à eux.
Sur le second point, aucun élément ne permet d’étayer la thèse soutenue par quelques auteurs d’après laquelle, en acceptant le passage au maquis de légions entières, à quelques semaines de la libération, l’état-major du général Kœnig voulait redonner à la Gendarmerie, dès le départ de l’occupant, une autorité sérieusement altérée par le rôle qu’on lui avait assigné pendant quatre ans. Si pour une minorité le brassard des F.F.I. est l’occasion de redorer un blason parfois terni, ce n’est pas le cas général.
Du reste, l’arrivée des gendarmes dans les maquis n’entraîne pas de réactions hostiles de la part des résistants. Qu’il existe parfois des préventions à l’égard de ceux qui, quelques semaines avant le débarquement, n’hésitaient pas à pourchasser les patriotes n’a rien d’étonnant. Pour réduire les facteurs de tension avec les jeunes éléments du maquis, on emploie les gendarmes au sein de prévôtés ou en formations autonomes sous la conduite de leurs chefs. L’amalgame, lorsqu’ils sont incorporés directement à leurs côtés, s’effectue sans poser de problème. Militaires de carrière, ils mettent sans la moindre réserve leur compétence au service des maquisards.
Tel est l’état d’esprit du lieutenant Vimard, de la section d’Espalion (Aveyron). Sans arrière-pensée il se met à la disposition du capitaine « Roland » (Carrière), chef du maquis d’Aubrac, jeune industriel de Millau « fluet, blond qui semble plutôt un étudiant ». Le 20 juin, il le conseille pour organiser la position qu’occupe sa compagnie au sud du bois de Védrines, dans le réduit de la Truyère (Cantal). En début de matinée, au moment où les troupes du général Jesser donnent l’assaut au réduit, l’officier de Gendarmerie sert un fusil-mitrailleur. Soudain, il décèle une manœuvre d’encerclement. Aussitôt il se lève pour mettre en garde son capitaine. Deux balles explosives l’atteignent de plein fouet. Évacué vers l’arrière, à Maurines, un médecin l’opère d’urgence. Il meurt au cours de l’intervention.
Employés comme conseillers, simples exécutants, chefs d’équipes, de groupes, de sections, de compagnies, de bataillons et même de régiments – le gendarme Bonvallet de la brigade d’Issigeac (Dordogne) commande au combat, en septembre 1944, le 3e régiment F.T.P.F. dans la région de La Rochelle où il contribue à la reddition de l’amiral Schirlitz – les militaires de la Gendarmerie prennent une part active dans les opérations défensives, de harcèlement, de retardement ou de destruction menées contre les troupes allemandes.
Les bilans obtenus par les formations de Gendarmerie opérant de manière autonome donnent une indication sur les efforts déployés. En quelques jours, la légion du Languedoc perd dix hommes (2 officiers et 8 gendarmes) auxquels s’ajoutent six blessés. Elle inflige à l’ennemi des pertes relativement lourdes : 49 tués dont 4 officiers, 93 blessés, 339 prisonniers y compris 5 officiers. En outre, les gendarmes s’emparent d’un important butin : 2 canons D.A.T. (défense antiaérienne), 1 canon de 37, un obusier de 77, 14 mitrailleuses, 11 camions, 6 voitures légères et 3 camions.
Amalgamés aux F.F.I. les gendarmes font preuve d’une aussi grande efficacité comme le souligne le général Chérasse :
« Très vite nous avons l’occasion d’engager le combat. Des éléments blindés, chars lourds et chenillettes, débris de panzers traversent la région où opèrent nos pelotons mixtes Gendarmerie – F.F.I. munis de bazookas ; nous les stoppons et faisons des prisonniers. Au fur et à mesure parviennent d’autres moyens parachutés qui permettent de créer des corps francs la plupart du temps aux ordres d’un officier de Gendarmerie. Ils nomadisent au profit des responsables du commandement O.R.A./F.F.I. On peut citer la libération de Besançon, Beaumes-les-Dames ; la libération de Vesoul ; la participation aux violents combats contre 2 000 Allemands sur le plateau de Lomont etc. […]. »
Durant les combats, la 4e région d’inspection déplore 52 tués et 12 blessés.
L’institution a ses martyrs, au moment de l’ultime combat libérateur.
Le gendarme Offner, de la brigade de Roybon (Isère), tombe avec panache le 5 août 1944 devant un peloton d’exécution. Courant juillet il rallie la Résistance et participe aux combats du Vercors. C’est ensuite le repli au maquis des Chambarands. Les Allemands le capturent dans une embuscade tendue près du village de Grand-Serre, alors qu’il effectue une reconnaissance avec Pecheir, un jeune maquisard. Conduit à Beaurepaire, il subit la question. Ses tortionnaires n’obtiennent aucun renseignement. Son martyre s’achève dans la soirée. Les Allemands le traînent, pantelant, face à un mur. Dans un dernier sursaut, s’adressant à son compagnon promis comme lui à la mort, il s’écrie : « On va leur montrer, à ces brutes, qui nous sommes ». Puis, se retournant, il s’adresse au sous-officier qui commande le peloton d’exécution :
« Je suis gendarme français et je suis fier d’appartenir aux Forces Françaises de l’Intérieur. Je vais vous montrer comment sait mourir un Français. Je réclame l’honneur de commander le feu. »
Les fusils se mettent en jour. « Feu ! » ordonne le gendarme Offner. Une salve retentit. Le supplicié s’écroule.
L’éclatement de la Gendarmerie n’empêche pas les personnels, du reste nombreux, qui ont estimé en conscience devoir rester à leur poste, de poursuivre tant bien que mal leur mission. Ils rencontrent d’énormes difficultés mais ne déméritent pas. Comme leurs camarades de la Manche et du Calvados ceux de la légion du Poitou qui n’ont pas rejoint le maquis se mettent à la disposition des éléments alliés, en l’occurrence des Britanniques, opérant dans leur secteur. Le général J. TH. Calvert, commandant les troupes parachutistes S.A.S., dans une lettre adressée au commandant de légion lui exprime, au lendemain de la libération, ses remerciements pour l’aide apportée par les gendarmes dans les districts de Pleu-Martin et des Puits de Giraud, « où ils montrèrent une si belle détermination au combat. »
Quel que soit le moment de leur engagement, le sacrifice consenti par les militaires de la Gendarmerie, au cours des combats de la Libération, ne laisse planer aucun doute sur la sincérité de leur patriotisme. Ils témoignent, par le sang versé, que tous leurs frères d’armes qui comme eux avaient choisi le difficile chemin de la désobéissance en acceptaient les risques.
Au terme de l’exploration entreprise pour mieux connaître la Gendarmerie des années noires, une double évaluation s’impose au sujet de l’institution et des hommes qui l’ont incarnée. Elle s’appuie sur les réalités mises à jour et prend en considération l’état de l’Arme à la Libération, véritable révélateur de la période qui précède.
Le premier volet de l’examen nous éclaire sur l’institution. Tout d’abord, on observe, après la disparition de l’État français, que la Gendarmerie sort notablement affaiblie de la rude épreuve qu’elle vient de traverser.
ESQUISSE D’UN BILAN
Trois mois après le débarquement sur les côtes anglo-normandes, le reflux des troupes allemandes s’accélère. Le 25 août, le drapeau français flotte à nouveau sur Paris libéré. À la mi-septembre, les Allemands, chassés des trois quarts du territoire, ne contrôlent plus que quelques enclaves où ils mènent de violents combats d’arrière-garde : Lorraine, Alsace, poche de Royan, Saint-Nazaire, Lorient, Dunkerque.
A la liesse, que provoque la délivrance, succède paradoxalement au sein de la Gendarmerie un profond désarroi motivé par la crise des effectifs qui se double d’une crise de confiance.
De nombreux officiers, gradés et gendarmes ont cessé temporairement et parfois définitivement d’exercer leurs fonctions, pour des causes diverses. Les uns ont été l’objet de mesures répressives de la part des Allemands ou de la Milice (déportés, fusillés, tués, blessés, disparus). Les autres ont été victimes de l’épuration sauvage, administrative ou judiciaire (arrestation, internement, mise en disponibilité, etc.). Enfin, des absents volontaires ont été incorporés dans les F.F.I. De plus les opérations de guerre ne sont pas achevées fin 1944 aussi le commandement doit-il constituer des prévôtés à Cherbourg, Brest, Saint-Nazaire et dans le Sud-Ouest. La réorganisation de l’ancienne légion d’Alsace et Lorraine, confiée au lieutenant-colonel Sérignan, nécessite un prélèvement d’effectifs sur les 4e, 5e, 11e, 20e, 1re et 2e légions. Par rapport à 1939, la Gendarmerie présente un déficit de 200 officiers et de 10 000 sous-officiers.
Dans les départements libérés, où les exactions se multiplient, règne une grande agitation. La Gendarmerie se heurte à de sérieuses difficultés, faute de personnels en nombre suffisant, pour faire face à la situation.
Bien plus grave est la baisse du moral qui affecte l’Arme. Des critiques s’étalent contre elle dans la presse. Des dénonciations mettent en cause des officiers et des sous-officiers en raison de leur comportement sous l’Occupation. Arrestations et emprisonnements arbitraires fondés très souvent sur des accusations fantaisistes sont signalés sur l’ensemble du territoire. En outre, on enregistre des entraves à l’exécution du service provoquées par des organisations de résistance incontrôlées. Bref, la conjonction de tous ces faits ne facilite pas le retour à la normale.
Le 15 décembre 1944, à l’occasion de la réunion à Paris de tous les chefs de corps, le colonel Meunier, successeur du lieutenant-colonel Girard à la tête de la Gendarmerie, accueille M. Diethelm, ministre de la Guerre, désireux de prendre contact avec les officiers. Dans son allocution de bienvenue il fait part au représentant du Gouvernement des préoccupations de la Gendarmerie en insistant notamment sur le malaise dont souffre l’ensemble du personnel :
« La Gendarmerie a rempli pendant quatre ans, au service de la France, face à l’ennemi, un rôle difficile, ingrat, périlleux dont l’opinion publique n’a qu’une idée imparfaite. Certains officiers ou gendarmes ont pu faillir à leur devoir, ils seront éliminés sans pitié. Mais l’ensemble du personnel, qui a fait son devoir et souvent plus que son devoir, étonné de certains entrefilets de presse, de certaines mesures hâtives, demande à être rassuré. Votre visite de ce jour, M. le ministre, y contribuera grandement. »
Autre élément constitutif du malaise dont souffre la Gendarmerie : il réside dans le fait que l’État français a utilisé l’institution plus pour les besoins du régime que pour le service de la collectivité nationale. Ainsi a-t-il détourné sa capacité d’action vers l’accomplissement de missions nouvelles – garde des camps d’internements, recherche des réfractaires au S.T.O., arrestation des Juifs et des opposants à l’occupant – incompatibles avec l’intérêt général. L’exécution de missions sur réquisitions a pris le pas sur le service courant traditionnel.
La dérive constatée dans l’emploi de la Gendarmerie explique la crainte, exprimée à plusieurs reprises par le commandement entre 1942 et 1944, de voir l’institution perdre la confiance des populations voire même d’en subir l’hostilité. Le colonel commandant la 15e légion, au cours du premier trimestre de l’année 1943, évoque les conséquences néfastes pour la Gendarmerie du rôle qu’on lui assigne dans la recherche des réfractaires au S.T.O. et auparavant des travailleurs désignés pour la relève :
« On ne saurait trop souligner, écrit-il, que pour la bonne exécution des missions qui lui sont confiées et dont dépend la paix publique, il est essentiel que la Gendarmerie jouisse du respect et de l’estime des populations. Il ne faut pas se le dissimuler les arrestations d’ouvriers dans leurs familles ont créé, dans ses rapports avec elle, un malaise qu’il serait dangereux d’aggraver. »
Le directeur général sait bien aussi que certaines missions entament le crédit de la Gendarmerie. Le 23 octobre 1943, à la suite de la publication par l’Office français d’information, dans un quotidien, du jugement et de l’exécution par les autorités allemandes de 25 « terroristes » français armés, capturés après un combat par les gendarmes français, il adresse des représentations au secrétaire général de l’information :
« S’il est particulièrement souhaitable de donner une publicité étendue à la répression du terrorisme, je crois préférable que cette publication soit faite sous une forme ne risquant pas de provoquer, contre la Gendarmerie, dont la tâche devient de plus en plus délicate et difficile, les réactions d’une opinion publique poussée, par une propagande néfaste, à la partialité et à l’injustice. C’est pourquoi, je vous serais obligé de vouloir bien donner des instructions à vos services pour qu’ils évitent, dans les publications de presse ou radiophoniques toute allusion de nature à rendre plus difficile l’exécution des missions confiées à la Gendarmerie. »
L’emploi dans ces conditions de la Gendarmerie explique, pour une bonne part, les haines ou rancœurs qui se donnent libre cours et l’inquiétude légitime ressentie par les personnels au moment de la Libération.
La collaboration du régime avec la puissance occupante place la Gendarmerie dans une situation d’otage. Les gendarmes perdent leur liberté d’action. Tous ne l’acceptent pas. Ceci influe sur la cohésion qui n’est que de façade. Des lézardes de plus en plus profondes apparaissent dans l’édifice. On ne peut ignorer ce facteur qui a pesé sur le fonctionnement de l’institution avant de la conduire à l’éclatement.
L’idée émise par quelques-uns d’après laquelle la direction aurait pu préparer, au moment opportun, un retournement contre l’ennemi et le régime, comme le démontrent les événements, relève de la fiction. Tout s’y opposait : la dispersion des unités sur l’ensemble du territoire, les courants contradictoires qui séparaient les hommes, l’étroite surveillance de l’occupant et le sacro-saint devoir d’obéissance profondément ancré dans les mentalités. D’ailleurs, pas plus que la Gendarmerie d’autres institutions comme l’armée, la Police, la magistrature, l’administration préfectorale et pénitentiaire ne sont entrées en rébellion contre le pouvoir établi ou l’occupant.
Parfaitement conscient du statut délicat des personnels de la Gendarmerie pendant l’Occupation le Gouvernement provisoire, au moment où commence l’épuration administrative, décide de prendre cet élément en considération. Le 29 octobre 1944, le général Tamisier, directeur des personnels de l’armée de Terre, le confirme dans une directive particulière :
« La Gendarmerie faisant partie intégrante de l’armée est soumise (en matière d’épuration) aux mêmes règles de base que tous les autres personnels de l’armée de Terre. Par contre, sa situation spéciale, sous l’occupation, a retenu toute l’attention des autorités responsables et le personnel de la Gendarmerie doit attendre, en toute confiance, les décisions qui seront prises ; toutes les garanties lui sont accordées. D’autre part, la place prise par l’Arme dans la Résistance assure à l’ensemble de son personnel la plus grande bienveillance. »
Avant que la Commission d’épuration et de réintégration des personnels militaires ne se prononce sur les dossiers des officiers et des sous-officiers de l’Arme qui lui seront soumis, le ministre prévoit qu’un officier de Gendarmerie, ayant vécu dans la métropole et ayant connu par conséquent les conditions tragiques dans lesquelles la Gendarmerie a travaillé entre 1940 et 1944, donnera un avis définitif au vu duquel seront prises les décisions.
Quant au devenir de l’institution, on remarque à la Libération que le Gouvernement provisoire de la République ne remet pas en cause son existence. Malgré des griefs formulés contre elle il n’y a pas de phénomène de rejet la concernant. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi tout au long de son histoire. Dans la tourmente révolutionnaire, en novembre 1789, Mirabeau à la tribune de l’Assemblée nationale demande sa suppression pure et simple alléguant de sa collaboration avec le despotisme.
À la fin de l’été 1944, toutes les forces du Maintien de l’ordre ne jouissent pas du même privilège. Les G.M.R., créés par Vichy, sont en butte à l’hostilité quasi générale des organisations de résistance. On ne leur pardonne pas d’avoir été le fer de lance du Gouvernement dans la lutte contre les maquis. Leur dissolution, par décret du 8 septembre, n’a en réalité qu’une portée symbolique.
Le Gouvernement a besoin d’un appareil policier fort pour maintenir l’ordre public menacé par le déchaînement des passions suscitées par les années de servitude.
Les policiers improvisés, membres des F.F.I. ou des Milices patriotiques, malgré leur bonne volonté, ne présentent pas les garanties requises de compétence et de fiabilité pour accomplir des missions habituellement dévolues à des professionnels.
Le 8 septembre, à peine supprimés, les G.M.R. renaissent sous la nouvelle étiquette de C.R.S. (compagnies républicaines de sécurité). Dans les jours suivants, le ministère de l’Intérieur remet sur pied une soixantaine de compagnies.
Aux blâmes, qui s’élèvent de toute part, succède rapidement l’apaisement des esprits. Le renouvellement des cadres compromis, la modification des conditions de recrutement, l’aménagement des structures internes, le changement de leur aspect extérieur par l’adoption d’un nouvel uniforme met un terme aux critiques.
La Garde n’échappe pas aux sanctions. Celles-ci prennent un caractère local. À Toulouse, le 24 août, Ravanel, commissaire régional des F.F.I., dissout le 6e régiment dont les escadrons sont répartis dans la région. Dans un communiqué il demande aux gardes de « s’engager dans les unités des Forces françaises de l’Intérieur pour combattre les ennemis de la France aux côtés des soldats de la Libération. »
La Gendarmerie, en définitive, ne connaît pas de tels déboires. D’ailleurs, il n’a jamais été question pour le Comité français de libération nationale, siégeant à Alger pendant l’Occupation, de la supprimer ou de la transformer. Au contraire, ses membres prennent dès le printemps 1944 toutes les dispositions nécessaires pour qu’elle puisse assurer la continuité de son action en métropole au fur et à mesure que le Gouvernement de la République retrouvera le plein exercice de sa souveraineté.
Autre élément intéressant à noter : à partir de 1943, les autorités allemandes et françaises mettent en doute l’efficacité de la Gendarmerie. On se méfie d’elle. Les indices ne manquent pas qui traduisent la « tiédeur » des personnels. Plusieurs préfets, à l’issue de la réorganisation des forces de Police en octobre 1943, déplorent ouvertement dans des rapports qu’elle est trop proche des populations, que son état d’esprit et ses traditions ne lui permettent pas de répondre aux situations et aux missions du moment. Le préfet régional de Dijon l’accuse « de mener une politique particulière et de ne pas suivre les ordres gouvernementaux, de marchander constamment son concours aux autorités administratives, de ne pas agir contre le terrorisme et d’avoir des compromissions avec la Résistance. »
La complaisance fréquente des gendarmes en faveur des maquisards fait naître la suspicion. L’intendant du Maintien de l’ordre de Montpellier, Pierre Marty, dénonce leur inaction dans un rapport du 22 mars 1944 adressé à Darnand. Ce document dresse le bilan d’une opération de police infructueuse exécutée par les G.M.R. le 21 mars, à Saint-Victor et au Viale-du-Tarn, dans la région de Saint-Afrique (Aveyron) :
« Les maquisards profitent de la complicité quasi générale et il n’est pas douteux que la Gendarmerie pourrait rendre de précieux services, si elle le voulait. Qu’elle n’ait pas eu, dans le cas qui nous a occupé, connaissance du maquis de Poulquière est encore chose possible, mais qu’elle ait ignoré l’existence de celui du Sucaillou composé de douze hommes armés, installés au beau milieu d’un village d’une dizaine de foyers, à proximité d’un barrage très important, est une chose vraiment impensable. »
Le 12 juin, le général Martin rend compte à Darnand du passage dans la dissidence des légions de l’Est et de l’Ile-de-France. Un des collaborateurs du secrétaire général au M.O. mentionne en marge du rapport du directeur : « Nous avions raison quand nous disions au général Martin que sa Gendarmerie n’était pas sûre. »
Ce jugement traduit bien le sentiment de défiance que lui porte le pouvoir.
Bien que considérée comme suspecte, la Gendarmerie n’en a pas pour autant basculé dans la Résistance. Des personnels continuent d’appliquer à la lettre des instructions gouvernementales préjudiciables aux intérêts français et alliés.
Lors de son procès à Paris en 1954, le colonel S.S. Helmuth Knochen, second d’Oberg, déclare :
« Ce n’est pas avec 2 000 agents, seules forces dont je disposais, que j’aurai pu tenir la France entière. C’est parce que, une partie de la Police, de la Gendarmerie et de la justice française m’ont aidé que j’ai accompli la tâche qui m’avait été fixée. »
Pour mettre le pays au pas, c’est vrai, la Police allemande s’est appuyée sur des auxiliaires français. En vérité, peu de gendarmes ont accepté de se mettre au service des nazis sinon quelques brebis galeuses qui ont payé le prix de leur forfaiture.
Knochen, ne l’oublions pas, est en situation d’accusé lorsqu’il dénonce la collusion d’une partie de la Gendarmerie avec ses services. Aussi essaye-t-il, par tous les moyens, d’atténuer sa responsabilité en désignant d’autres coupables. C’est pourquoi il convient de corriger son propos.
* *
*
Le second aspect du bilan se rapporte aux hommes. En qualité d’agents d’exécution de l’État, garants du bon ordre dans le pays, la tâche des gendarmes devient singulièrement délicate à partir du moment où les gouvernants n’agissent plus en pleine indépendance, soumis qu’ils sont à l’autorité d’une puissance étrangère. Concilier, dans ce contexte, le devoir d’état avec l’exigence patriotique ne va pas de soi.
L’Occupation entraîne dans le pays une fracture qui affecte tous les corps de l’État. Dans la Gendarmerie, d’une brigade à l’autre, et même à l’intérieur de chaque brigade, gradés et gendarmes ne partagent pas forcément le même point de vue sur l’attitude à adopter. Comme en service ils agissent toujours par deux, il faut qu’ils soient vraiment d’accord entre eux pour prendre des initiatives contraires aux instructions en vigueur. D’où l’extrême prudence des uns et des autres.
Le double jeu, auquel se livre des cadres, acquis à la Résistance, ne clarifie pas la situation. Leur position dans la hiérarchie les conduit à donner des ordres et à répercuter des instructions de la direction dans la ligne des directives gouvernementales. Selon que les subordonnés savent lire entre les lignes ou qu’il se précipitent, tête baissée, dans l’application littérale d’une note de service, le sort des personnes recherchées en dépend. En mai 1943, un commandant de section transmet à ses commandants de brigade une directive préfectorale sur la recherche des défaillants au S.T.O. Il conclut par ces termes :
« Je vous préviens que je sévirais avec la dernière vigueur s’il se créait, dans la circonscription, des repaires de réfractaires comme cela s’est produit à la limite de la Haute-Loire. C’est à la Gendarmerie qu’il appartient de veiller. »
Quinze jours avant l’envoi de cet ordre à ses unités ce même officier alertait un groupe de maquisards de l’imminence d’une opération de police contre leur refuge.
Alors que la majorité des Français se contente de suivre le cours des événements, sans prendre parti ouvertement parce que rien ne l’y oblige, le gendarme en service qui dispose rarement de tous les éléments d’appréciations est amené à constater des atteintes à la sécurité publique et de ce fait à prendre, sur le champ, de graves décisions : usage des armes, arrestations, etc. Autant il est aisé pour lui de déterminer l’origine d’un sabotage, d’un attentat contre un milicien, autant il est difficile de discerner, d’emblée, si un vol de tabac, de carburant, de produits alimentaires est l’œuvre de résistants ou de malfaiteurs de droit commun.
Des drames surviennent. L’on déplore des victimes aussi bien du côté des gendarmes que des patriotes. Le 24 mars 1943, six individus armés attaquent le commissariat de Police de Beuvry (Nord). Il s’agit de F.T.P. qui ont l’intention de se procurer des cachets officiels et des cartes d’alimentation. L’adjudant S…, commandant la brigade, se trouve fortuitement, au moment de l’attaque, de passage aux abords des locaux de la Police. Il se lance à la poursuite des agresseurs. Une fusillade s’ensuit au cours de laquelle il est mortellement blessé.
Placé en permanence sous le regard de la population, surveillé par l’occupant, épié par les collaborateurs, le gendarme qui par surcroît porte un uniforme et vit en famille en caserne ne peut agir ouvertement en faveur de la Résistance. S’il y adhère, il doit cacher son jeu pour ne pas se faire repérer.
Enfin, si la résignation habite bon nombre de gendarmes pendant une partie de l’Occupation on ne doit pas s’en étonner. Ils n’ont pas été préparés à affronter les problèmes résultant de l’occupation du territoire par une puissance étrangère. Laissés à eux-mêmes, sans un minimum de repères, il n’était pas facile pour eux de se déterminer.
Face à toutes ces entraves, quelle attitude adoptent les gendarmes entre 1940 et 1944 ? On peut semble-t-il dresser une typologie des personnels.
Affirmer qu’ils se sont illustrés par un éclatant refus de l’occupant, en se dressant massivement contre lui, serait inexact. Il le serait tout autant de proclamer que tous on failli en manifestant une dégradante complicité. La réalité est plus complexe. La position qu’ils prennent, loin d’être uniforme, varie en fonction du moment, du lieu, des événements et de leur personnalité. Après l’invasion de la zone sud, en novembre 1942, leur comportement évolue dans le sens d’une hostilité croissante à l’occupant et au régime de Vichy. Jusqu’en novembre 1942, il est certain que l’état d’esprit diffère notablement d’une zone à l’autre. En zone libre ils ne subissent pas encore l’emprise directe des autorités allemandes à l’exception des contrôles périodiques des commissions d’armistice.
Au lendemain de la défaite de 1940, rares sont ceux qui contestent la légitimité du vainqueur de Verdun et de son Gouvernement. Au fur et à mesure que la compromission du pouvoir avec l’occupant s’étale au grand jour, la prudence s’installe. Vient ensuite le doute avec les persécutions raciales, l’instauration du S.T.O., la recherche des réfractaires, la chasse aux patriotes. Les yeux se dessillent. Des clivages se produisent.
Les collaborateurs, dans la Gendarmerie, ne représentent qu’une partie tout à fait insignifiante des effectifs. De façon avérée ou occulte, ils s’efforcent de nuire à la Résistance par tous les moyens. Complices délibérés des nazis, la Résistance les connaît et n’hésite pas à les désigner à la vindicte publique. Leurs noms figurent sur les listes noires publiées par la presse clandestine, comme en font foi divers spécimens. Le 21 décembre 1943, Libération dénonce le capitaine de Gendarmerie Q…, caserne Exelmans à Paris, « collaborateur acharné qui excite ses hommes à la recherche des réfractaires ». Le 12 octobre, Libération signale encore « E… de la Gendarmerie de A… qui a assassiné un patriote ». En juin 1943 une autre liste met en accusation « le capitaine N… à L…-le-S… dont les sentiments pro-allemands sont notoires ». Sur les ondes de la B.B.C. les Français libres lancent également des avertissements. Le gendarme B…, de la brigade de Vassy (Calvados), fait l’objet, en fin d’année 1943, d’une mise en garde dont il ne tient pas compte. Quelques mois plus tard, le 15 mars 1944, deux F.T.P., après l’avoir maîtrisé et désarmé l’abattent de neuf balles de pistolet. De même, la radio de Londres avertit solennellement un officier, le capitaine V… et deux gendarmes affectés à la garde du camp de Drancy « qu’ils seraient exécutés pour s’être faits des instruments dociles des nazis. »
Plusieurs officiers et sous-officiers, soupçonnés ou accusés de collaboration, tombent victimes de l’épuration sauvage alors que le territoire n’est pas encore libéré. Mi-juin 1944, les F.T.P. du Lot arrêtent le gendarme B…, de la brigade de Gramat. Le 8 juin, ce militaire juché sur un blindé de la division « Das Reich » guide une colonne de répression sur le centre de Gabaudet où se rassemblent, après le débarquement, les hommes de la région qui gagnent le maquis. Parmi eux, une quinzaine de gendarmes. La trahison de ce sous-officier se solde par une vingtaine de morts et plusieurs prisonniers. Dans cette tragédie disparaissent les gendarmes Lascombe, Balland, Maury, Crémoux et Forestier. Au nombre des prisonniers figurent les gendarmes Valadie, Bertrand, Gicard, Beaussel, Pitoizet et l’adjudant Burg blessé. Le traître avoue son forfait aux maquisards qui le passent par les armes.
À Thorens (Haute-Savoie), le 1er octobre 1943, la Résistance exécute le capitaine V…, commandant la section d’Annecy. Malgré des mises en demeure répétées l’officier continue de traquer les patriotes. Le commandant de section de Saint-Julien-en-Genevois subit le même sort quelques mois après.
Sur l’ensemble du territoire, la Résistance élimine plusieurs dizaines de militaires de la Gendarmerie. Des innocents payent parfois de leur vie cette répression brutale. Après le débarquement, la Police du maquis, dans le Lot, arrête les gendarmes P… et L… suspectés d’être des collaborateurs. Traduits devant le tribunal du maquis siégeant au château de Gluges, commune de Montvallent, ils sont condamnés à mort. L’exécution a lieu le jour de la sentence. En 1946, à la suite de la demande de réhabilitation présentée par leurs familles, la Commission d’enquête chargée d’examiner la requête ne trouve aucun témoignage ni aucune pièce d’archives lui permettant de déterminer le ou les motifs de leur condamnation. Au contraire, plusieurs témoins s’accordent à déclarer que les victimes n’avaient pas eu d’attitude défavorable à la Résistance.
Le 25 septembre 1944, des maquisards exécutent le chef F…, de la brigade de Gémonac (Charente). Ce gradé, accusé de collaboration, a en fait été victime d’une vengeance étrangère aux événements de l’Occupation.
Aucun jugement ne précède l’exécution de l’adjudant M…, dans l’Ardèche, le 14 août 1944. Selon Henri Amouroux on lui reprochait « d’avoir été gendarme dans une région où, pour certains, il s’agissait de faire basculer le pouvoir en place en éliminant tous ceux qui détenaient encore une partie d’autorité. »
L’exécution, le 9 juin 1944, du capitaine B…, commandant la section d’Issoudun, semble fortuite. Ce jour-là, l’officier se rend à la brigade de Saint-Christophe-en-Bazeilles pour enquêter sur l’absence irrégulière de plusieurs gendarmes. Son arrivée coïncide avec celle d’un groupe d’une trentaine de maquisards dans l’agglomération. Après l’investissement de la caserne, l’un des assaillants somme le capitaine de remettre son arme et d’accompagner le détachement. À toutes les injonctions, le commandant de section oppose un refus ferme. Néanmoins, sous la contrainte, il suit le groupe lorsque crépite une rafale de mitraillette qui l’atteint dans le dos. Il s’effondre sur la chaussée. Un des maquisards lui donne le coup de grâce. Au moment de ses obsèques célébrées le lendemain, juste après la cérémonie religieuse, les maquisards en armes lui rendent les honneurs.
Les Cours de justice, créées par ordonnance du 26 juin 1944 pour juger les auteurs de faits de collaboration, commencent à siéger courant octobre 1944. Les militaires de la Gendarmerie « ayant favorisé les entreprises de l’ennemi » sont déférés devant ces juridictions. Si les informations judiciaires ouvertes contre des gendarmes, devant ces tribunaux, aboutissent dans une proportion relativement importante à des arrêts de non-lieu, quelques-unes, en revanche, entraînent leur comparution et par la suite des sanctions sévères.
La justice ne tranche pas immédiatement le sort du directeur général de la Gendarmerie suspendu de ses fonctions par un arrêté du commissaire à la Guerre du 25 septembre 1944. Sa révocation intervient le 16 juin 1945. Ce n’est que le 21 février 1947 qu’il comparaît devant la Cour de Justice de la Seine. Les juges le condamnent à un an de prison et à la dégradation nationale. Gracié cinq mois plus tard par le général de Gaulle il recouvre la liberté.
Une justice plus implacable frappe le lieutenant Roger Fleurose, de la légion de Champagne, condamné à mort et fusillé. Commandant la section de Lens en 1942, il s’acharne dans la chasse aux Résistants. Entre les mois de janvier et d’avril 1942 il démantèle, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, l’essentiel des réseaux de l’organisation armée du Parti communiste désignée en zone nord sous l’appellation d’O.S. (organisation spéciale). Son zèle entraîne l’arrestation d’une centaine de militants actifs de l’ex-Parti communiste.
L’intervention le 9 avril 1942 du préfet du Pas-de-Calais, auprès du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, pour plaider son inscription à titre exceptionnel au tableau d’avancement, le conforte dans sa détermination. La direction de la Gendarmerie ne donne pas de suite aux sollicitations dont elle est l’objet. L’État français reconnaît et encourage « les mérites » de l’officier en l’inscrivant, fin décembre 1943, au tableau spécial de la Légion d’honneur.
En Lozère, le chef d’escadron Bruguière, commandant la compagnie, comparaît devant la Cour martiale de Mende le 23 septembre 1944. On lui reproche d’avoir signalé aux autorités l’emplacement du maquis Bir-Hakeim, à la Parade (Lozère), décimé par les troupes d’opérations en mai 1944. Ironie du sort, parmi les juges figure un gendarme de la légion d’Auvergne, capitaine des F.F.I. au maquis de Haute-Lozère. Il doit sa désignation au refus de siéger à la Cour martiale d’un autre militaire de la Gendarmerie. En effet, quelques jours avant le procès, le colonel Peytavin, chef départemental des F.F.I. convoque le chef Cazals alors lieutenant des F.F.I. Il lui annonce l’imminence du jugement du chef d’escadron Bruguière et le sollicite pour siéger en qualité de juge. Pour l’ancien subordonné du commandant de compagnie de la Lozère, c’est l’étonnement, pour ne pas dire la stupéfaction. Sa réponse est immédiate et sans ambiguïté :
« Mon colonel, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez mais je pense que ce serait une mauvaise action de participer au jugement d’un supérieur sous les ordres duquel j’ai servi pendant deux ans. »
Le chef départemental des F.F.I. partage son point de vue et le remplace par un autre gendarme. Pourtant, le chef Cazals ne sera pas absent du procès. Les autorités le chargent d’assurer l’ordre et la sécurité à l’extérieur et à l’intérieur de la salle d’audience avec un détachement des F.F.I. de la garnison de Mende. Le 23 septembre, il se trouve aux abords du tribunal lorsqu’arrive la voiture cellulaire emmenant le chef d’escadron Bruguière devant ses juges. Le chef Cazals le salue une dernière fois. L’officier lui tend la main en disant : « Vous avez choisi le bon chemin ».
Le verdict de la Cour martiale tombe le 25 septembre : le préfet de la Lozère et le commandant de Gendarmerie sont condamnés à mort. Devant le peloton d’exécution, le 28, l’officier a une attitude courageuse qui ne surprend pas ceux qui le connaissaient. Après avoir distribué des cigarettes à tous les F.T.P. composant le peloton d’exécution, il prononce ces paroles : « Mes enfants, vous allez voir comment sait mourir un officier de Gendarmerie français. Allons-y ». Le commandant se met au garde-à-vous, salue et crie « Vive la France ». Il meurt le sourire aux lèvres, ce qui frappe profondément l’officier F.T.P. et ses hommes.
Quinze jours plus tard, le lieutenant Sorrant et le chef Bretou, impliqués comme complices dans le drame de La Parade, sont condamnés à leur tour à la peine capitale. Le premier est exécuté. Le second voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité.
L’attachement au devoir d’état, plus que la volonté délibérée d’accomplir des actes anti-nationaux, conduit une autre catégorie de gendarmes à appliquer les ordres à la lettre. Quelques-uns font preuve de zèle en prenant des initiatives personnelles exagérées. Ils devront rendre des comptes. La crainte de perdre une situation ou une pension, bref un souci de sécurité, en dissuade d’autres de franchir le Rubicon de la désobéissance.
Au cours d’une opération de police, dans la région de Valence, en 1943, les G.M.R. arrêtent deux hommes et une femme chargés du fonctionnement d’une imprimerie clandestine.
Pendant quelques instants la jeune résistante se retrouve sous la surveillance d’un gendarme de la brigade de Tain-l’Ermitage (Drôme) momentanément seul. Elle essaye d’obtenir son aide : « Nous sommes des résistants, laissez-nous filer ! » Le gendarme lui répond : « J’ai quinze ans de service et cinq enfants. »
L’esprit de discipline constitue en règle générale le frein le plus puissant à la désobéissance. Tout commande aux gendarmes d’obéir : la fonction qu’ils exercent, le serment professionnel prêté solennellement au moment de leur admission, leur appartenance au milieu militaire. Le règlement de discipline générale dans les armées ne leur impose-t-il pas « d’exécuter les ordres littéralement, sans hésitation ni murmure » ? Le subordonné n’a la possibilité de réclamer que lorsqu’il a obéi.
La réaction du gendarme T…, arrêté à la Libération et détenu à la maison d’arrêt de Mende pour avoir interpellé, pendant l’Occupation, trois réfractaires au S.T.O. et un jeune homme qui sera par la suite fusillé par les Allemands, s’inscrit dans cette ligne. « Je ne me sens pas coupable, écrit-il à sa femme ; sur le premier point, je n’ai fait qu’obéir et sur le second, il s’agit d’une arrestation de droit commun. »
Aux collaborateurs, manifestement marginaux au sein de l’institution, et aux personnels, dont le nombre est plus important, soumis aux ordres par devoir ou souci de sécurité, s’ajoutent les gendarmes qui se dressent contre l’occupant. La phalange des militaires dont l’engagement dans la Résistance est total représente un effectif appréciable. Pourtant, après la signature de l’armistice, ils ne sont qu’une poignée, en zone nord, qui se signalent par des actes remarquables de courage et de foi. Progressivement d’autres surgissent qui viennent grossir leurs rangs.
Le Gouvernement de la République, à la Libération, témoigne sa reconnaissance aux personnels de l’Arme qui, en maintes circonstances, ont rendu des services éminents au pays et accompli leur devoir avec un sens patriotique et humain poussé parfois jusqu’au sacrifice.
Le général de Gaulle admet dans l’ordre prestigieux de la Libération trois officiers : les chefs d’escadron Guillaudot, Colonna d’Istria et le capitaine d’Hers, héros de la Résistance en Indochine.
Créée par l’ordonnance n° 7 du Comité national français du 16 novembre 1940, la Croix de la Libération récompense « les personnes, collectivités militaires ou civiles qui se sont signalées d’une manière exceptionnelle dans l’œuvre de Libération de la France et de son Empire. »
L’ordre comprend 1 059 membres « Compagnons » dont 238 à titre posthume et des collectivités civiles et militaires. Ces quelques repères donnent une indication sur la qualité de l’engagement des membres de la Gendarmerie qui en font partie.
La médaille de la Résistance décernée « aux personnes et collectivités qui ont pris une part spécialement active, depuis le 18 juin 1940, à la résistance contre les puissances de l’Axe et leurs complices sur le sol national ou le territoire relevant de la souveraineté française » sanctionne le comportement remarquable de 360 militaires de la Gendarmerie. Un décret du 14 juin 1946 porte attribution de cette décoration à la brigade de La-Chapelle-en-Vercors. Au total, après la guerre, le Gouvernement décernera à des personnes, et plus rarement à des collectivités militaires, 48 000 médailles.
Des actions de bravoure, pendant les combats de la Libération, et des faits de résistance valent encore à des personnels de la Gendarmerie 4 852 citations accompagnées de 351 nominations ou promotions dans l’ordre de la Légion d’honneur ainsi que 1 060 médailles militaires.
Ces chiffres ne rendent compte qu’imparfaitement des réalités. Pour différentes raisons, des gendarmes pourtant méritants, qui se sont distingués dans le combat pour la liberté, ne peuvent se prévaloir d’un titre de reconnaissance. Rémi Bailly, gendarme dans le Lot en 1943, rapporte les propos tenus à ce sujet par l’officier commandant la 2 340e compagnie F.T.P. à laquelle il appartenait :
« J’ai six médailles militaires à attribuer dans mon unité (90 hommes), la médaille militaire, tu l’auras de toute façon au cours de ta carrière, alors, celle-là, je la ferai attribuer à un de nos compagnons civils qui ne pourrait jamais l’avoir autrement. »
Ce cas n’est pas isolé. D’autres témoignages corroborent celui de ce sous-officier.
On ne peut ignorer, à côté des résistants reconnus, la masse des gendarmes anonymes et obscurs qui ont, tôt pour les uns, tard pour les autres, opté pour une attitude de raison et se sont efforcés, en toutes circonstances, de concilier l’intérêt supérieur du pays avec leur devoir d’état. Le courage et la chance aidant, ils y parviennent. Pour ce faire ils s’accommodent de la présence des résistants, ferment les yeux sur leurs activités, transgressent les ordres de Vichy qui prescrivent des actes contraires aux libertés essentielles des citoyens, diffèrent la transmission des renseignements susceptibles d’entraîner des arrestations et des saisies d’armes, sabotent les enquêtes en matière de recherches (réfractaires au S.T.O., communistes, Juifs, travailleurs étrangers), n’appliquent pas les textes qui réglementent l’ouverture du feu.
En refusant d’exécuter aveuglément les ordres du Gouvernement et de la hiérarchie, de même qu’en s’opposant aux exigences de l’ennemi et de ses satellites, ces gendarmes ont apporté une contribution indéniable à la cause de la Résistance. Il est juste de leur rendre l’hommage qui leur est dû et qu’ils n’ont jamais réclamé.
Un aspect essentiel du bilan reste à présenter qui donne la mesure des sacrifices consentis par les personnels entre juillet 1940 et la Libération. Le tribut du sang qu’ils ont payé, durant cette période, s’élève à 973 tués, non compris les militaires emportés dans la tourmente de l’épuration sauvage et judiciaire dont le nombre n’a jamais été publié. On peut estimer, à la suite de recoupements, qu’il se rapproche de la cinquantaine.
Déduction faite des personnels de la Garde « extériorisée » de la Gendarmerie, de l’armistice à la Libération, d’après les tables alphabétiques établies par la direction de l’Arme, 689 officiers et sous-officiers ont été victimes des Allemands. Il se répartissent ainsi : 260 tués au cours d’actions de résistance et d’incidents divers avec l’occupant, 171 militaires fusillés, 258 décédés en déportation sur un total de 1 319 déportés. Le martyrologe des gendarmes est comparable sinon supérieur à celui de la plupart des autres catégories socioprofessionnelles, c’est dire la part qu’ils ont prises dans le combat pour la liberté.
Au bilan des pertes s’ajoute, d’autre part, les personnels tués en service commandé à la suite d’attentats, d’accrochages avec des résistants, d’agressions par des malfaiteurs de droit commun, de bombardements. Le Livre d’Or de la Gendarmerie des années 1940 à 1945 mentionne ainsi les noms des 284 militaires tombés à l’occasion de l’exécution du service spécial.
Malgré la diversité des comportements, dans la vérité comme dans l’erreur, un dénominateur commun rapproche tous ces acteurs de notre histoire : l’uniforme qu’ils portaient et le sang versé. Le même sacrifice les réunit, qu’ils soient tombés face à l’ennemi sur le champ de bataille, devant un peloton d’exécution, dans l’enfer des camps de concentration ou qu’ils soient morts victimes des dissensions franco-françaises.
Les bûchers ne sont jamais éteints. De la braise qui couve sous la cendre, à nouveau, peuvent jaillir demain des flammes dévastatrices.
Pour permettre aux exécutants de se déterminer en toute connaissance de cause, face à une situation donnée, lorsque le principe de discipline s’oppose à des valeurs essentielles, le Gouvernement a modifié par décret du 12 juillet 1982, le règlement de discipline générale dans les armées. L’exécutant qui accomplit « un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international régulièrement ratifiées ou approuvées » engage pleinement sa responsabilité disciplinaire et pénale. Ces nouvelles dispositions excluent donc l’obéissance passive et laissent place à l’appréciation des faits. Se conformer aux ordres reçus reste le premier devoir certes, mais il n’y a plus, comme par le passé, une subordination absolue et formelle à l’autorité des chefs. Les fonctionnaires de Police sont assujettis à une réglementation comparable. L’article 17 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la Police nationale justifie la désobéissance à un ordre illégal.
Les événements de l’Occupation, comme d’ailleurs ceux de l’Algérie entre 1954 et 1962, sont indiscutablement à l’origine de l’évolution du concept de discipline. D’un point de vue plus général, l’obéissance, contrairement aux idées reçues, ne constitue pas une fin en soi. Elle n’est qu’un moyen de servir. Dans l’accomplissement de son devoir d’état, lorsque les circonstances l’exigent, l’exécutant doit choisir seul sa ligne de conduite sans se soucier de savoir s’il désobéit ou se montre respectueux de l’autorité. La décision qu’il prend se fonde alors nécessairement sur la seule morale individuelle et le respect des principes inaliénables qui transcendent la loi.
Arrivant au bout du chemin que nous nous étions assigné, il convient de s’interroger, pour en éclairer la perspective, à seule fin de savoir comment les résistants jugent l’action des gendarmes pendant l’Occupation. Même s’il émettent des critiques justifiées, la plupart s’accordent pour reconnaître que dans une forte proportion ils se sont conduits avec dignité.
La voix autorisée d’Henri Noguères que l’ont ne peut suspecter de complaisance – il s’est montré particulièrement sévère à l’encontre de ceux qui se sont discrédités – exprime et résume parfaitement le sentiment de bienveillance qui prévaut :
« On peut affirmer sans risque d’erreur, écrit-il, que dans leur très grande majorité ils ont eu une attitude irréprochable. »
En définitive, si pendant les années noires décrites par François Bedana comme « des années de feu et de cendre, de honte et de gloires entrecroisées, synonyme pour les uns de sacrifice, de larmes et de sang, pour les autres de lâche soulagement et d’égoïsme recroquevillé », la Gendarmerie n’a pas perdu son âme, elle le doit précisément à ces hommes, officiers et sous-officiers, qui ont su apprécier avec lucidité les enjeux et adopter une conduite digne, conforme à leurs convictions et à l’intérêt de la France.
REMERCIEMENTS
L’auteur exprime tout particulièrement sa profonde gratitude au général Sérignan. Ce dernier non seulement lui a prodigué de chaleureux encouragements lorsqu’il a eu connaissance de son projet, mais encore n’a cessé, pendant son élaboration, de lui apporter son aide. Ainsi lui-a- t-il confié sa mémoire des années difficiles passées à la tête de la section Gendarmerie des territoires occupés. Il a mis à sa disposition ses archives personnelles acceptant, en outre, de relire le manuscrit et de faire part de ses remarques. Ce fut un dialogue fructueux et amical. Aussi il revenait au général Sérignan de présenter ce livre qui est aussi le sien.
Ce travail n’aurait pu être mené à bien sans la confiance qu’ont accordé à l’auteur les militaires de la Gendarmerie témoins et acteurs des événements qui ont marqué l’institution entre 1940 et 1945. Ils ont bien voulu apporter leur témoignage, répondre à ses questionnaires, lui communiquer des documents personnels tout à fait inédits. La majorité d’entre eux a voulu rester anonyme. Qu’ils sachent tous que leur contribution a rendu possible une entreprise qui ne fut pas toujours facile. De nombreuses portes ne se sont jamais ouvertes.
L’auteur tient enfin à adresser ses vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, à des titres divers, lui ont apporté leur aide pour réaliser cet ouvrage :
à Madame Agnès Abadie, veuve du colonel Alexandre Abadie, au colonel Léon Abadie, à l’adjudant-chef Azaïs, au gendarme Bonnin, au gendarme Brige, à Monsieur Vincent Delobelle, à Madame Demettre, veuve du général Demettre, à l’adjudant Duplan, à l’adjudant-chef Fonmartin, à Madame Foulcras, secrétaire de mairie, au lieutenant-colonel Gandon, à Monsieur Julien Helfgott, à Madame Claude Laude, du centre de documentation Benjamin Franklin, au colonel Lachaud, à Madame Marinne Lenormand, conservateur adjoint du Musée de l’Ordre de la Libération, à l’adjudant-chef Lepape, à Madame Sarah Mimoun, du Centre de Documentation Juive Contemporaine, au colonel Paillole, au lieutenant-colonel Peuget, à Madame Agnès Paterson, Hoover Institution Archives, à Monsieur Jacques Revise, directeur de l’Essor de la Gendarmerie nationale, au général (C.R.) Sanvoisin, à l’adjudant-chef Suberbielle, à Maître François Saint-Pierre.
SOURCES
ARCHIVES
– Centre de Documentation Juive Contemporaine. Paris.
– Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Standford. California.
– Centre National Jean Moulin. Bordeaux.
– Musée de la Gendarmerie. Melun.
– Musée de l’Ordre de la Libération. Paris.
– Archives privées.
PUBLICATIONS DIVERSES
– Journal officiel de l’État français (1940-1944).
– Journal officiel de la République française (1944-1947).
– La Dépêche, journal de la Démocratie (1944).
– Mémorial de la Gendarmerie (1939-1946).
– Mémorial de la Gendarmerie. Livre d’Or (1941-1945).
– Encyclopédie des Règlements en usage dans la Gendarmerie. Décrets annotés (organisation et service). Éditions La Baule.
– Bulletins d’études et d’informations de la Gendarmerie (1944).
– Annales de la Gendarmerie (1945).
– Revues d’études et d’informations de la Gendarmerie (1949-1991).
– L’Essor de la Gendarmerie nationale (collection).
– Revue Historique des Armées (n° 4, 1991 et n° 2, 1993).
– D’où viennent les gendarmes. Historia n° 128, juillet 1987.
– Vivre en Rouergue. Spécial Histoire Gendarmerie – 1978.
– Revue du Centre de Documentation Juive Contemporaine. « Le Monde Juif » (collection)
– Revue Résistance R4 – 1977-1980.
– Brochures de la Commission départementale de l’information historique pour la Paix. Aspects de la Résistance en Haute-Garonne – 1984.
– Mémorial du Rouergue en résistance – 1991.
– Livre d’Or de l’école de la Garde.
– Les cahiers de la Résistance Vosgienne par René Grillot.
OUVRAGES
– Amouroux (Henri). La Grande Histoire des Français sous l’Occupation. 8 tomes parus depuis 1970. Robert Laffont.
– Angelini (Jean, Victor). Tonnerre sur la Corse 1939-1945. Éditions Maritimes d’Outre-Mer. 1985.
– Arbaumont (Jean) colonel. Entre Glières et Vercors. Vie et mort du capitaine Bulle. Éditions Garnet. 1972.
– Aubrac (Lucie). Nous partirons dans l’ivresse. Seuil. 1984.
– Bacelon (Jacques). Dans les dossiers de la Gestapo. Jacques Granger. 1988.
– Bailly (Jacques, Augustin). La Libération confisquée. Albin Michel. 1993.
– Barre de Nanteuil, général. Historique des unités combattantes de la Résistance 1940-1944. S.H.A.T. 1979.
– Bart (Jean). Histoire d’un groupe Franc. Éditions Pierre Fanlac. 1945.
– Besson (A). Les maquis de Franche-Comté. France Empire. 1978.
– Besson (Jean) général et Rozières (Pierre). Gendarmerie nationale. Xavier Richer. 1982.
– Bodin (Jérôme). Les officiers. Grandeur et misère. Librairie Académique Perrin 1992.
– Bourdrel (Philippe). L’épuration sauvage. 2 tomes. Librairie Académique Perrin. 1988 et 1991.
– Bruge (Roger). Fautes sauter la ligne Maginot. Fayard. 1973.
– Cabanel (P.), Poujol (J), Joutard (P). Cévennes, Terre de refuge. 1940-1944. Presse du Languedoc. Club Cévenol. 1987.
– Cazals (Marcellin) Adjudant-chef (E.R.). Journal de marche d’un gendarme. Non publié.
– Chauvy (Gérard). Lyon 40-44. Plon. 1985.
– Cordesse (Henri). Histoire de la Résistance en Lozère. Imprimerie J. Reschly. 1974.
– Couvreur (Colette) et Descamp (Pierre). Vie et mort du chef d’escadron Descamp, héros et martyr de la Résistance française. Privat. 1986.
– Crémieux (Francis). La vérité sur la Libération de Paris. Belfond. 1971.
– Dainville (A. de) colonel. L’O.R.A. La Résistance de l’Armée, guerre 1939-1945. Lavauzelle. 1974.
– Delarue (Jacques). Histoire de la Gestapo. Fayard. 1962.
– Devigny (André). Je fus ce condamné. Presses de la Cité. 1978.
– Delperrié de Bayac (Jacques). Histoire de la Milice. Fayard. 1969.
– Echeynne (Émilienne). Les Pyrénées de la Liberté. France-Empire. 1984. Montagnards de la Liberté. Éditions Milan. 1984. Les fougères de la Liberté. Éditions Milan. 1987.
– Favre (Pierre). Histoire d’un militaire peu ordinaire. L’Harmattan. 1992.
– Faucon (Martial). Francs-tireurs et Partisans français en Dordogne. Éditions Maugen. 1990.
– Fournier (Raymond). Terre de combat. Maury imprimeur. 1973.
– Frenay (Henri). La nuit finira. Robert Laffont. 1973.
– Galliet (Pierre), Helfgott (Julien), Jourdan (Louis). Glières, Haute-Savoie première bataille de la Résistance. Association des rescapés des Glières. 1967.
– Gambiez (Fernand) général. La libération de la Corse. Hachette 1973.
– Gazagnaire (Louis). Dans la nuit des prisons. Éditions Sociales. 1973.
– Georges (André Noireaux) colonel. Le temps des partisans. Flammarion. 1978.
– Germain (Michel). Histoire de la Résistance en Haute-Savoie. 3 tomes déjà parus. La Fontaine de Siloé. 1988, 1992.
– Gilbert (Charles). Soldats bleus dans l’ombre. Le Cercle d’Or. 1977. La montagne héroïque. Le Cercle d’Or. 1980. La montagne libérée. Le Cercle d’Or. 1981.
– Giraud général. Un seul but, la Victoire. Julliard. 1949.
– Gmeline (Patrick de). Le lieutenant-colonel Jean Vérines, gendarme, garde républicain, soldat de l’ombre. Lavauzelle. 1985.
– Groussard (Joseph) colonel. Service secret 1940-1945. Plon. 1957.
– Guillaudot (Maurice) général. Souvenirs de Résistance. Non publié.
– Guingouin (Georges) colonel. Quatre ans de lutte sur le sol Limousin. Hachette. 1978.
– Hoover Institute. La vie en France sous l’Occupation 1940-1944. Plon. 1957.
– Jaffre (Yves, Frédéric). Les tribunaux d’exception 1940-1962. Nouvelle éditions latines. 1962.
– Klarsfeld (Serge). Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question Juive en France. 2 tomes. Fayard. 1983, 1985.
– Lacan (Gilbert). Figeac en Quercy sous la terreur allemande. Imprimerie Sandrée. 1945.
– Lecornu (Bernard). Un préfet sous l’occupation allemande Châteaubriand, Saint-Nazaire, Tulle. France-Empire. 1984.
– Lévy (Gilles) général et Cordet (Pierre). À nous Auvergne !. Presses de la Cité. 1974.
– Lévy (Claude) et Tillard (Paul). La grande rafle du Vel d’Hiv. Laffont. 1975.
– Longuechaud (Henri). Conformément à l’ordre de nos chefs. Le drame des forces de l’ordre sous l’Occupation 1940-1944. Plon. 1985.
– Martin (Jean, Augustin) général. Relation sur Gendarmerie pendant l’occupation. Hoover war library. 1952.
– Miquel (Pierre). Histoires vécues de la Seconde Guerre mondiale. Fayard. 1988. Les gendarmes. Olivier Orban. 1990.
– Michelet (Raymond). Rue de la Liberté. Le Seuil. 1973.
– Musard (Francis). Les Glières. Laffont. 1965.
– Navarre (Henri) général. Les services de renseignements 1871-1944. Plon. 1978.
– Noguères (Henri). Histoire de la Résistance en France. 5 tomes. 1967-1981. La vie quotidienne des Résistants de l’Armistice à la Libération. Hachette. 1984.
– Omnès (René) général. Pourquoi as-tu fait cela mon fils. La Musse. 1991.
– Paillole (Paul). Services Spéciaux 1935-1945. Robert Laffont. 1985.
– Paillat (Claude). L’Occupation. Le pillage de la France. Laffont. 1987. La France dans la guerre américaine. Laffont. 1989. La nuit sur la France. Laffont. 1992.
– Penaud (Guy). Histoire de la Résistance en Périgord. Fanlac. 1985.
– Puthoste (Daniel) général. Au service de l’Etat-Nation. La Musse. 1985.
– Rajsfus (Maurice). Drancy. Un camp de concentration très ordinaire. Mania. 1991.
– Rémy colonel. Morhange. Les chasseurs de traîtres. Flammarion. 1975.
– Restany (Joseph). Une entreprise clandestine sous l’occupation allemande. Lavauzelle. 1948.
– Saint-Pierre (François) avocat au Barreau de Lyon. Discours de rentrée du stage du Barreau de Lyon du 12 décembre 1986. Les tribunaux spéciaux de Vichy. Lyon 1943-1944.
– Sanvoisin (Adrien) général. Les gendarmes du groupe France de l’Armée secrète de la Loire. Chez l’auteur. 1984.
– Saurel (Louis). Peines et Gloires des gendarmes. Lavauzelle. 1973.
– Sérézat (André). Et les Bourbonnais se levèrent. Créer, Nouette. 1985.
– Slitinsky (Michel). L’affaire Papon. Alain Moreau. 1983. Le pouvoir préfectoral lavaliste à Bordeaux. Wallada. 1988.
– Témoignage collectif. Maquis de Corrèze. Éditions Sociales. 1971.
– Trouillé (Pierre). Journal d’un préfet pendant l’occupation. Gallimard. 1964.
– Vérines (Guy) colonel. Mes souvenirs du réseau Saint-Jacques. Lavauzelle. 1990.

